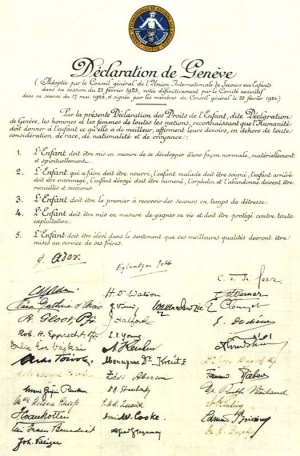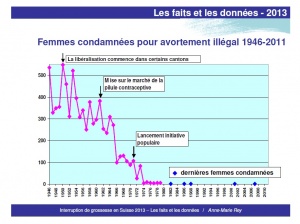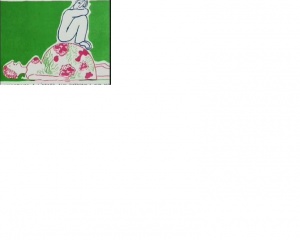Histoire des droits de la personne: entre luttes des usagers et politiques institutionnelles 1960-1980
Histoire des droits de la personne: entre luttes des usagers et politiques institutionnelles 1960-1980
Introduction
Les années 1960-1980 sont des années de grandes transformations culturelles et sociales avec 1968, une année charnière qui deviendra l'emblème de la contestation portant les valeurs d'une génération, celle du baby-boom. Aujourd'hui l'histoire de cette contestation demande à être comprise dans un temps plus vaste d'un avant, pendant et après Mai 68. Certes, on peut faire remonter la question des droits de la personne à la Déclaration des droits de l'hommes et du citoyen comme une matrice générative d'autres conventions, déclarations et droits. Or, il semblerait que le mouvement de contestation des années 1960-1980 ait poussé plus loin l'exigence démocratique en partant de revendication de populations, elles-mêmes, se sentant non respectées comme des personnes ; notamment les femmes, les détenus, les patients psychiatriques ("Loi Basaglia"), les handicapés (charte de l'ONU datant de 1975) et les enfants (Convention relative aux droits de l’enfant). De nouveaux droits liés à l'éthique se sont développés dès les années 1970 autour du respect de la volonté des mourants, avec la pratique des directives anticipées, et plus largement des droits des patients à être traités dans la dignité.
Certes, on pourrait rattacher cette histoire à une pré-histoire reliée à d'autres courants comme, par exemple pour les enfants celui de l'éducation nouvelle dont le pédagogue Célestin Freinet en est l'un des fondateurs, et des expériences pédagogiques démocratiques comme celles des écoles nouvelles à la campagne, communautés d'enfants (république d'enfants, Cité d'enfants, village d'enfants). Summerhill incontestablement sera LE modèle de la seconde moitié du 20e siècle, mais aussi l'expérience de Fernand Deligny et de communautés thérapeutiques telles que Boulens en Suisse romande [[1]]. Des racines ainsi plus lointaines peuvent être vues dans la "protection de l'enfance" qui voit déjà en 1924 une convention, la "Convention de Genève" dite prémice lointaine de la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Il en va de même avec l'histoire des femmes qui revendiquent le droit de vote depuis le 19e siècle (les suffragettes). Or, nous nous attacherons essentiellement à circonscrire une histoire se déroulant pendant une vingtaine d'années autour de nouvelles revendications qui ont pu porter sur des micro-éléments ("petits trucs", "micro-conflictualités", petits événements de la vie quotidienne, cas particulier), mais qui sont à rattacher à un "esprit d'un temps" contestataire de la hiérarchie, des pouvoirs constitués (des patrons, des médecins, des "supposés savoirs" notamment) dans une perspective libertaire (liberté de sortir de l'hôpital psychiatrique, liberté d'user de son corps, liberté de sexualité en prison, liberté de parole, de choix, de décision...) et d'exigence de sa réalisation (utopique?) par des actions et manifestations politiques face aux violences institutionnelles (portes fermées, nudité imposée, horaire imposé, cure de sommeil et électrochocs imposés, contention, viol, avortement clandestin, etc.). Peut-on alors y voir une expression de revendication des droits de la personne (autodétermination, autonomie, intégrité, dignité) qui sous-tendrait des droits portant sur un objet particulier (à l'instruction, au salaire égal, à l'avortement, à une "vie comme tout le monde", à consulter son dossier individuel, aux parloirs sexuels, etc.) ? Ce sera une des questions auxquelles cherchera à répondre cet ouvrage.
Un certain nombre de notions et de valeurs démocratiques et libertaires semblent parcourir une histoire longue (du 18e au 21e siècle) avec des incarnations plus ou moins denses selon les périodes. Celles envisagées dans les droits de la personnes pendant la période 1960-1980 s'incarnent dans la liberté certes (valeur première de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), mais aussi la créativité, l'innovation, la contestation valorisant l'individu et son autonomie, mais aussi le collectif comme matrice créatrice, avec un souci du respect de la différence (une reconnaissance) mais aussi du groupe comme porteur de revendications, un ancrage dans la vie quotidienne et une volonté d'universalisme. La culture contestataire est-elle monolithique ou multiple? Est-elle aussi traversée par des contradictions, des paradoxes: on prône une liberté individuelle dans un carcan idéologique, la lutte est collective pour des droits individuels?
La recherche a abouti à l'écriture de six articles, introduits et conclus par des textes rédigés en communs, qui tous viseront à mieux saisir qui sont les acteurs/trices (intégrés dans un mouvement de revendication ou un courant idéologique contestataire), leurs actions dans l'expérience quotidienne de leurs luttes pour les droits de l'individu et/ou de la personne, les valeurs prônées, les objectifs atteints ou non pour faire valoir les droits des personnes placées dans des institutions dites alors "totalitaires", tout en cherchant à mieux définir ce que signifient ces droits dans le quotidien institutionnel et personnel.
Le travail de cette "communauté de recherche" vise aussi à repérer les ouvrages de références qui ont marqué les acteurs/trices de cette période, des intellectuels (Basaglia, Foucault, Illitch, Goffman) entre autres penseurs, parfois utopistes voir visionnaires, ainsi que, suivant la méthode prônée par Michel Foucault dans son ouvrage Histoire de la clinique notamment, à questionner les faits, à interroger le système, autrement dit à "déconstruire" la réalité pour comprendre les enjeux du pouvoir qui ont traversé les luttes de promotion des droits de la personne dans des champs différents, mais relevant tous d'un rapport entre un pouvoir qui désigne et un individu-objet dont on attend la soumission. Ces ouvrages montrent que les mouvements de contestation se font dans tous les pays ; par exemple, en ce qui concerne l'anti-psychiatrie, les critiques ont eu lieu en Italie avec Basaglia mais également aux États-Unis avec Goffman. Ainsi que ce soit le pédagogue et l'élève "difficile", déviant, handicapé, le médecin et le patient désigné, le juge qui désigne les degrés de culpabilité d'un "coupable" ou l’État qui décide de la responsabilité civique ou non des femmes (et des jeunes), partout se modèlent et se modulent des relations différentes à l'intérieur d'une structure hiérarchique.
Des acteurs/actrices seront interrogés afin de mieux saisir leur engagement, les valeurs qu'ils ont prônées, la conscience qu'ils ont eu de déstabiliser le pouvoir médical, l'institution totalitaire, pour des alternatives dont on interrogera leur devenir subversif: communautés d'enfants, communautés thérapeutiques en milieu psychiatrique, en milieu carcéral (notamment la Pâquerette à Genève) et plus généralement dans l'éducation spécialisée. Mais c'est fondamentalement la question de la revendication des droits de la personne qui sera l'objet de ce questionnement. Il s'agira dans un premier temps de mieux comprendre ce qui différencie les droits de la personne, des droits de l'homme érigés au 18e siècle, et de comprendre les enjeux des luttes pour voir émerger ces "nouveaux" droits et les formes qu'ils ont prises: droit à la parole, droit de sortie, droit à l'avortement, droit à consulter son dossier médical, etc...
Au moyen de cinq questions ouvertes, il s'agit de récolter leurs témoignages afin de mieux comprendre les ressorts de leur engagement (politique, idéologique, éthique), les événements qui ont marqué cette période 1960-1980, les mobiles des acteurs/trices.
Fondamentalement, c'est à une réflexion sur la construction de la réalité que cet ouvrage invite, celle de la maladie, de la déviance, de la différence, mais aussi à celle des relations entretenues avec des personnes qui sont stigmatisées (handicapées, psychiatrisées, détenues, patients) et/ou placées dans une catégorie sociale dépendante (la femme non-citoyenne, dépendante de l'homme, l'enfant de ses parents). L'institution réifie l'individu et lui fait perdre ses droits et c'est donc bien une volonté de récupérer une place d'acteur, de prendre la parole, de donner haut et fort son avis qui va mobiliser les acteurs des luttes, en particulier dans l'après 68.
C'est aussi in fine un questionnement sur l'histoire et ses changements, lesquels demandent à s'interroger sur la place accordée, dans le temps, aux personnes en difficultés quelles qu'elles soient et sur la nécessité dans le domaine des droits de la personne à rester vigilant afin de ne pas perdre ce qui a été acquis parfois de haute lutte et d'étendre encore les valeurs sur lesquelles ils reposent.
Revue de la littérature
La "matrice générative" des droits de la personne est bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : une "matrice" juridique à partir de laquelle vont se développer d'autres droits, règlementations et conventions. Pour couvrir les différents champs de la réalité sociale qui ont été touchés par la créativité des acteur/trice/s (qu'ils aient été des militant/e/s ou des réformateur/trice/s) particulièrement active dans les années 1960-1980 et les changements opérés, il est nécessaire de se référer aux auteur/e/s qui, autant dans le champ du handicap, des patients de l'hôpital, des usagers de la psychiatrie, des détenus, des enfants et des femmes, ont proposé des approches nouvelles, des concepts voire des pratiques novatrices.
Certes, il n'y a pas un moment particulier où commencerait une lutte pour les droits de la personne. Cette question s'inscrit dans une histoire longue de la constitution des droits, de la "fabrication" de l'individu, de la conception de la personne comme être sensible, consciente d'elle-même. Il en va de même pour des pratiques qui certes ont été promues pendant cette période comme, par exemple, les communautés de vie, mais il existe des traditions qui peuvent remonter bien avant les années 60. C'est le cas avec la communauté d'enfants de Summerhill en Angleterre créée par Alexander S. Neill. Dans son livre Libres enfants de Summerhill (Neill), on peut déceler la place centrale de la notion de liberté dans sa conception de l'éducation et de l'instruction des enfants. Selon cet auteur, on ne peut construire de collectif cohérent qu'en respectant la liberté des individus. Les violences, les incivilités ne sont pour lui que le produit des incohérences de la société, qui frustrent l'individu et qui, à vouloir trop l'uniformiser, en brisent les richesses.
Dans la fin des années soixante, la critique des institutions psychiatriques surgissent. Une mise en évidence des conditions de vie des patients psychiatriques se fait notamment par Basaglia en Italie. Ce qu'il rencontre dans cet univers le pousse à créer des lieux de vie plus accueillants où l'on donnerait plus de liberté à la personne psychiatrique ; c'est ce qu'il appelle les communautés thérapeutiques. Ces bâtiments ouverts sur l'extérieur et où la hiérarchie est horizontale favorise la mobilisation des personnes afin de lutter pour la liberté des droits de la personne, et surtout la liberté des droits de la personne psychiatrique. Basaglia est donc probablement l'un des auteurs de l'époque qui a influencé les acteurs/actrices que nous avons interrogés pour notre recherche. Un discours pareil est ténu par Goffman aux Etats-Unis. Dans son livre « Asiles, études sur la condition sociale des malades mentaux », l’auteur se penche sur le déroulement du quotidien des patients vivant dans ce qu’il appelle une « institution totalitaire ». Ces personnes, privées de tout droit, sont à la merci des médecins, du personnel soignant et du fonctionnement de l’hôpital qui est désormais leur lieu de vie. En effet, l’hôpital psychiatrique ne vise pas à soigner, mais à exclure de la société les personnes qui dérangent par leur comportement. Fondamentalement, la critique est politique, sociale, mais aussi épistémologique: on s'attaque à la réalité qui est un "construit" social. Ce qui explique aussi l'attention mise à la vie quotidienne (voire Goffman, mais aussi Lucien Lefebvre notamment). Le quotidien devenant matrice de la relation créative autant que de la subversion, dans une tradition qui s'inspire d'ailleurs des surréalistes des années 20 (voire notamment Georges Perec). L'approche constructionniste de Kenneth Gergen, aujourd'hui, poursuit cette tradition voyant dans la relation la matrice de cette construction de la réalité allant jusqu'à affirmer que l'individu n'existe pas en-dehors de la relation qui le "produit" [[2]]. Une autre manière de montrer, comme l'a fait Foucault, que l'individu est aussi une construction sociale.
Les droits de la personne: un concept complexe
La thématique des droits de la personne oblige à réfléchir sur le concept et à le relier ou détacher d'autres concepts: celui de l'individu, celui du sujet (de droit) et celui de l'humain.
La plupart des revendications peuvent être reliées aux "droits de la personne". Or ceux-ci sont rarement explicités. Lorsqu'ils le sont c'est en référence à la "liberté individuelle", au droit à la parole, au choix (de traitement notamment) et à la dignité. Souvent, ce sont des valeurs individualistes qui sont prônées même si elles le sont par un collectif (association, comité, mouvement contestataire manifestant collectivement dans la rue) et qui fondent un certain "esprit" du droit de la personne. C'est par le regroupement de plusieurs personnes qui ont des valeurs communes (telles que le libre choix,l'intégrité physique) que le changement peut s'opérer. En effet, à travers notre recherche nous avons pu voir que, qu'il s'agisse des droits des prisonniers, des droits des patients à l'hôpital, des droits des patients psychiatriques ou des droits des femmes, les changements constatés se sont fait par l'intermédiaire de mouvements, d'associations, de fondations... On peut noter la particularité du champ des droits des personnes en situation en handicap, des droits des patients en psychiatrie ou même en partie ceux des enfants, par le fait que ces personnes ne disposent elles-mêmes pas des facultés à défendre leurs propres droits. Il revient alors à leur entourage, aux professionnels, et enfin à la société toute entière, de se porter garante du respect de ces droits. La société en protégeant ces personnes, en les considérant comme faisant partie intégrante des individus qui la composent, effectue alors un grand pas dans les valeurs qu'elle véhicule. L'idéologie en effet, doit être collective, pour prendre du sens pour tous. Mais les actes permettant cette évolution, restent bien souvent le fait d'individus, qui, plus que d'autres, poussés par un idéal, portent des actions progressistes.
Le terme personne est à distinguer d'individu (voire de "cas") en ce qui laisse entendre une capacité de droit et une place comme partenaire dans la relation (éducative, thérapeutique notamment) et les échanges de communication. Ceci peut s'incarner dans des pratiques sociales élémentaires comme de désigner la personne par son nom, la vouvoyer (en langue française en particulier!), jusqu'à la fermeture des hôpitaux psychiatriques par exemple. Mais c'est surtout sur le plan juridique, de ses droits civils et politiques, que les luttes ont été menées: de l'admission volontaire au droit de sortie pour les patients psychiatrique par exemple. Du côté des prisons, les revendications touchent aussi l'individu dans son corps et son esprit: droit à l'intégrité physique et morale, le droit à des conditions de vie appropriées, ou encore le droit à la santé. C'est donc au nom du respect de la personne en tant qu'être humain que les différentes organisations ont milité, bien que ceci n'ait pas été et ne soit toujours pas quelque chose de facile. En effet, la prison demeure un lieu où l’on a de la difficulté à considérer les criminels comme des êtres humains. De ce fait, la population ne semble pas être en mesure de concevoir que ces personnes possèdent également des droits. Pour changer les mentalités, nous pourrions poser le problème de la réinsertion. En effet, si l'on ôte tout droit aux prisonniers, comment espérer les réinsérer dans la société. Peut-on véritablement rendre un Homme "meilleur" en lui enlevant toute dignité?
Du côté des enfants, le droit s'est surtout construit à partir de la considération de l'enfant plus seulement comme un adulte en devenir, mais en tant qu'individu ayant des droits propres, notamment liés à la protection, à la parole et l'écoute, mais également aux autres besoins fondamentaux qu'il peut présenter. En fait, la reconnaissance des droits de l'enfant lui ont conféré peu à peu un rôle plus actif dans sa propre existence, comme par exemple par une considération plus importante de ses opinions dans les choix qui le concerne. Du coté des femmes, les contestations se font sur plusieurs plans, mais ce qui est surtout recherché c'est l'égalité avec les hommes. Cette égalité passe donc par la ré-appropriation de leur corps, la liberté de choisir une contraception et la liberté de penser différemment. En ce qui concerne les droits des patients psychiatriques, l’on peut remarquer que la lutte vise une revendication juridique en passant à travers l’humanisation de cette population. En effet, la conception de ce que l’on appelle aujourd’hui les troubles psychiques, est en constante évolution, influencée par les croyances et les valeurs de la société. La reconnaissance des droits des patients psychiatriques vise la reconnaissance de ces personnes comme étant des êtres humains, l’égalité de traitements face à la loi et l’autodétermination ainsi que la liberté d’être tous égaux dans nos diversités. Nous pouvons donc rapprocher ces faits au droit du consentement de la personne et de l'intégrité physique. Ces droits et les droits d'être informé touchent d'ailleurs le quotidien médical et la lutte pour les droits des patients. Les droits des patients touchent la sphère politique et juridique où une bataille s'est générée contre la liberté thérapeutique des médecins considérés comme subordonnés au droit d'autodétermination du patient. Valoriser le rôle des patients en tant que partenaires critiques des médecins, du personnel médical ou encore de les responsabiliser pour éviter des difficultés lors de leur traitement permettraient d'améliorer la qualité des soins dans le domaine de la santé du patient.
Paradoxalement ce sont des luttes (collectives, pour la communauté) qui ont ainsi contribué à construire la notion de personne comme corps, identité physique, morale, psychologique.
En outre, concernant les droits des patients (à l'hôpital) et les droits des patients psychiatriques, il est à remarquer que ces droits peuvent rapidement se révéler ambigus. En effet, la légitimité du secret médical, de l'asymétrie de l'expertise médicale, peuvent davantage protéger le médecin que le patient. Nous avons relevé par exemple des cas où ce sont les patients qui ont dû subir des conséquences, tant au niveau de leur reconnaissance, en tant que victimes, qu'au niveau économique, car ils n'ont pas pu prouver que le médecin qui leur avait causé du tort était véridiquement coupable d'expériences illicites sur eux. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure ces droits permettent, intelligemment, à la médecine d'opacifier la recherche médicale et par la même la problématique du patient-cobaye. Problématique qui est de nos jours, une contrainte pour faire avancer la science en toute légalité. Finalement, il faudrait se demander si l'être humain dépend d'expériences faites sur un groupe restreint de personnes. La réponse est oui, passablement des expériences se font avec très peu de personnes pour appliquer les résultats à grande échelle. Par exemple, cela s'est observé avec la morphine concernant le traitement des douleurs. Un médecin, un jour ou l'autre, s'est de toute façon risqué, initialement, à injecter dans un corps appartenant à une personne, cette substance considérée comme stupéfiant auparavant. Une autre expérience de ce même type, à hôpital de Saint-Gall en Suisse, était l'application d'ampoules bleues de méthylène dans le ventre des patients non-informés. Ils essayaient de soigner, par ce biais, leurs occlusions gastriques qui a fini par les tuer.
Méthode
La récolte d'un récit personnel, afin d'approcher l'histoire d'une période et de constituer une archive orale, a une tradition en sciences humaine et sociale. L'ouvrage "Le cheval d'orgueil" de Pierre Jakez Hélias paru en 1975 est souvent présenté comme un détonateur de l'usage des récits de vie pour décrire la réalité sociale et culturelle.
Diverses disciplines ont intégré la narration comme un moyen d'approcher la réalité vue à travers un individu ou un groupe, que cela soit en sociologie, en histoire, en médecine, en sciences de l'éducation, en ethnologie et même en littérature.
Les travaux de Philippe Lejeune ont contribué à collecter des récits sous formes notamment autobiographiques qui sont déposés à l'Association pour l'autobiographie près de Lyon.
La démarche effectuée dans le cadre de cette recherche d'intelligence collective relève de la collecte de récits. La personne interviewée est considérée comme un témoin de son temps. L'histoire se construit dans l'échange grâce aux questions posées, lesquelles doivent donner lieu à une narration libre, reliée aux souvenirs de la personne. Il s'agit d'être dans une écoute bienveillante d'un récit narré afin de venir combler l'intérêt des étudiant/e/s qui sont les récepteur/trice/s respectueux et curieux de cette histoire. Même si pour certains étudiants, relancer ces questions a permis à l'interviewé de se recentrer sur le sujet. Lors de l'interview et comme étape préalable à l'introduction de ces questions, l'explication de cette recherche collective a fait comprendre à certains interviewés l'importance de leurs témoignages.
La démarche de "biographies narratives", telle qu'elle devrait être développée dans cette démarche citoyenne, relève de compétences relationnelles, humaines, particulièrement formatrices aux métiers de l'humain. Elle demande du tact, de l'écoute, de la curiosité intelligente (capacité de s'adapter dans le cadre de l'entretien). Il s'agit de laisser de l'espace et de la liberté aux personnes interviewées. Par conséquent, seules des questions générales et ouvertes assureront la liberté de narrer. Les méthodes d'entretien se distinguent par la mise en œuvre des processus fondamentaux de communication et d'interaction humaine. Ces processus permettent au chercheur de retirer de ses entretiens des informations et éléments de réflexion riches en nuances. Nous accorderons un long temps de réponse, afin de laisser à la personne la possibilité de se souvenir et de raconter l'histoire et son histoire, tout en restant attentive qu'elle ne se perde pas dans des chemins trop éloignés. Elle ne relève pas d'une "conduite d'entretien" particulière, comme l'a développée par exemple Boutin (2006), mais elle relève sans aucun doute d'une approche qualitative.
Dans la plupart des cas, les étudiants n'ont pas transmis au préalable les questions qui allaient être abordées dans l'entretien à leur témoin. Pourtant, il est possible que cette démarche donne la possibilité aux personnes interviewées de prendre du temps pour récupérer leurs souvenirs en mémoire et ainsi construire un récit plus riche que lors d'une réponse spontanée. Toutefois, cette démarche peut également faire perdre quelque peu aux intervieweurs/euses le contrôle de l'entretien, avec un témoin qui se raconte, sans un réel cadre établi, puisqu'il sait sur quels chemins on va l'amener. Ainsi, le cadrage de l'entretien est d'autant moins aisé, car l’intervieweur perd un peu son contrôle sur celui-ci, qu'il aurait pu exercer notamment par la succession des questions.
Pour d'autres étudiants, la transmission des questions préalablement a permis aux interviewés d'affiner leur mémoire en développant leurs réponses pour que leur récit soit accompagné par des souvenirs marquants. Ils ont d'ailleurs fait appel aux gestes pour appuyer leurs témoignages en laissant entendre à leurs interlocuteurs que leur lutte ne cessait pas.
Les réactions (y compris non verbales) encouragent un récit qui se construit dans la relation. Celui-ci devrait être, par définition, original (même si certain/e témoins racontent pour la Xème fois leur "histoire", leur "légende"), puisqu'il est raconté à de nouvelles personnes. L'attitude du/des collecteur/trice/s de récits favorise (ou non) l'expression (et ce jusqu'à la confidence) et permet, qui sait, aux témoins d'innover, de se déplacer dans leur narration, de raconter une histoire nouvelle, vraiment originale.
Critique de la méthode
A travers cette expérience, nous avons en tant "qu'apprentis chercheurs" appris à mener un entretien semi-directif. Malgré le fait que nous avions beau imaginer le déroulement de notre entretien, nous avons rencontré quelques difficultés lors de la passation de ceux-ci. Tout d'abord, il a fallu faire face au personnage que nous avions en face de nous. En effet, comme nous l'avons expliqué, ces personnes ont, pour la plupart, été des militants en faveur des droits de la personne. Parfois, leur engagement a été tellement fort, qu'elles sont devenues des "icônes" dans le combat de ces droits. Nous avons donc dû faire face à leur agacement et leur lassitude face à nos questions qui pouvaient certes être considérées comme trop larges. Ceci nous amène donc à penser que le choix de faire des questions ouvertes, pour que chacun puisse raconter ce dont il a envie, n'était peut-être pas judicieux pour toutes les personnes que nous avons interviewées. Par contre, pour d'autres "icônes" habituées à discuter, même au parlement, ces questions étaient importantes à partir du moment où on allait les analyser par la suite au sein d'une recherche et ils ont répondu le plus précisément possible. Lorsqu'on a présenté ces questions au sein d'une recherche pour un cours universitaire, elles ont été prises sérieusement, sans nous faire remarquer de près le type de question ou les liens entre elles.
De plus, il s'est avéré que pour certains témoins, les questions étaient peu adéquates puisqu'elles positionnaient cette personne en tant que "militante" peut-être trop directement. De même, le mot "droit" se trouvait être un peu fort pour parler de certains engagements, qui ont probablement contribué ou du moins retracent les changements de ces droits, certes, mais ne se positionnaient pas à la base comme des engagements pour les droits d'une population. C'est pourquoi, pour certaines questions, nous avons utilisé d'autres termes (moins forts) ou nous les avons posées différemment, tout en respectant l'idée fondamentale de celles-ci. Cependant, le fait de faire des questions différentes et précises pour chacun des acteurs, nous aurait fortement contraints pour l'analyse transversale des entretiens.
De plus, lors de certains entretiens, les acteurs se sont laissés emporter par leurs émotions. Il n'était donc pas évident de gérer les pleurs rencontrés.
Un cas de figure était, pour ceux qui ont eu l'occasion de faire deux interviews, la position de collecteur/trice/s au niveau générationnel, à savoir faire face à une génération plus âgée, était enveloppée, pour les deux cas, d'une écoute éveillée peut-être parce que leurs récits nous touchaient de près ou parce de la sagesse émanait de certains interviewés. Pour l'un des interviewés, il a suscité en nous un rappel vers les droits de nos proches et, pour l'autre, il nous a sensibilisé vers une menace toujours présente des droits de la personne dans le pays où nous séjournons, la Suisse. Même si l'un des ces interviewés était une personnalité fédérale, le reflet de son authenticité nous a fait croire à son récit et il nous a appris plus sur les droits de la personne, qui sont par ailleurs également "nos droits". Le rapport entre les interlocuteurs a pu être franc et nous avons ressentis que l'un des interviewés nous avait confié une mission, celle de divulguer des faits. C'était pour certains collecteur/trice/s un moment très intense, de vérité et jamais oublié.
Parfois, nous avons pu nous confronter à la difficulté de recentrer la discussion vers les sujets qui nous intéressent. Comme tout un chacun, les acteurs peuvent certes parler du passé, mais en tant que militants ils auront, si leur combat est toujours vivant, tendance à parler plus du présent, et de ce qu'il reste à faire. Pour que nous soyons aussi amenés à prendre la relève. Il faut alors savoir "lire entre les paroles", pour récolter des informations sur la période qui nous intéresse.
Il aurait peut-être été profitable de mettre à disposition de tous les acteurs les questions de l'entretien à l'avance. Cela aurait permis de recentrer le débat, de rappeler plus facilement les questions de recherche. Un cas de figure était pour ceux qui l'on fait et qui ont reçu, en tant que collecteur/trice/s spontanément et préalablement à l'interview tête à tête, des réponses écrites aux questions, de la part des interviewés. Ces réponses ont permis de mieux connaître l'interviewé, son parcours, ses valeurs, son engagement pour les droits de la personne. La pré-analyse de ces réponses par écrit a permis entre autres de revenir encore une fois sur les questions et de solliciter l'interviewé en confiance pour continuer à expliciter certains souvenirs marquants et enrichissants pour cette recherche. Pour les collecteur/trice/s ce va-et-vient entre les réponses écrites à l'avance et la poursuite du récit a engendré une appropriation du sujet, bénéficiant ainsi la cohérence et la compréhension pour eux-mêmes. Toutefois, nous avons également relevé plus haut que cette démarche peut au contraire compliquer le guidage de l'entretien dans certains cas.
Autrement, une des questions qui permettrait de situer l'interviewé sur le passé sans revenir immédiatement dans son discours sur le présent est la question 2. Elle aurait pu être formulée ainsi : Y a-t-il un événement originel durant la période de votre engagement ? Pourriez-vous revenir sur le passé et nous raconter un ou des événements marquants que vous avez menés ou qui vous ont frappés durant une certaine période en faveur de ces droits ? Sinon la question 5 fait l'effet contraire en revenant sur le pas d'aujourd'hui comme conséquence du passé : Qu'en est-il aujourd'hui de cette lutte et des acquis et des risques de retour en arrière? Sur quoi faudrait-il continuer de se battre de lutter? Continuez-vous aujourd'hui à vous engager et sur quoi? Donc, il n'est pas étonnant d'entendre les interviewés parler sur leur présent et ainsi, pourquoi ne serait-il pas envisageable de leur demander : Est-ce que l'un des sujets de votre engagement pour les droits de la personne (patient, enfant, prisonnier...) continue à être d'actualité aujourd'hui ? Lequel ? Pourriez-vous nous l'expliciter s'il vous plaît ?
Quant aux valeurs des témoins, ces dernières ont été évoquées suite à la question formulée qui a engendré aussi des souvenirs vers un événement marquant lié à leurs valeurs et pour la lutte des droits de la personne.
En outre, peut-être peut-on reprocher aussi le manque de temps pour chaque entretien. Au vu de la méthodologie d'entretien semi-directif et biographique, des entretiens d'1h30 ne permettent pas toujours des digressions chronophages. Des entretiens plus longs, dont on aurait pu ressortir la quintessence auraient pu être bénéfiques.
Enfin, la relation biographique n'a pas toujours permis que les questions soient posées comme souhaitées et prises dans l'échange. L'entretien a pu prendre la forme d'une discussion à bâtons rompus en un dialogue qui finalement a échappé aux récolteurs/teuses de récits. En effet, il a parfois été difficile pour certains interviewers de ne pas intervenir dans l'échange ou poser davantage de questions étant donné leur intérêt pour les propos et le parcours de vie de leur témoin. De plus, certains entretiens se sont déroulés en présence de deux témoins, ce qui peut changer la dynamique de celui-ci en amenant plus de tours de parole. On peut noter, par ailleurs, que la distance générationnelle entre les récolteurs/teuses et l'interviewé a pu donner à ce dernier/ère l'envie de transmettre le passé, mais surtout d'avertir et de former pour aujourd'hui. Le retour sur des faits historiques n'est pas chose aisée à réaliser.
Certains ont dû faire face à des difficultés techniques concernant l'enregistrement de l'interview. En effet, l'appareil enregistreur est tombé en panne. Heureusement, que nous avions un autre enregistreur qui a pris le relais immédiatement car la prise de note n'aurait fait que retarder l'interview.
Quoi qu'il en soit neuf entretiens ont été effectués, lesquels ont permis de construire une histoire qui s'est étendue entre les années 1960 (engagement de Mme Amélia Christinat) et aujourd'hui (engagement de Mme Margrit Kessler, conseillère nationale de Saint-Gall).
Des thématiques (problématiques) plus fines ont pu être définies à partir des récits récoltés. Soit:
– le droit des enfants à travers le prisme de l'éducation
– le droit des femmes pour la liberté de leur corps (l'intégrité physique), et plus généralement pour le droit à leur autonomie
– le droit à l'intégrité physique et morale des détenus en Suisse.
– la lutte contre les abus de la psychiatrie
– la prise en compte des personnes en situation de handicap dans ce champ
– le droit à être informé pour que les patients ne deviennent pas les cobayes, des expériences scientifiques
L'analyse sera alors traversante permettant de mieux comprendre ce temps de l'innovation, de la contestation, de la réforme des grandes institutions qui structurent le social et la culture occidentale depuis le 19e siècle: l'hôpital, l'hôpital psychiatrique, l'école, le tribunal, la prison, le code civil, les institutions spécialisées: qui sont ces acteur/trice/s engagés, quelles ont été leurs idées et leurs valeurs, quelles ont été leurs actions et leurs victoires, leurs échecs aussi?
Introduction
Les droits de l'enfant visant la protection des mineurs évoluent au cours des décennies. Les prémices du XXe siècle les plus connues sont bien évidemment la Déclaration de Genève (1924), la déclaration des Droits de l'Enfant (1959) et enfin le texte de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989. Ce dernier “ratifié d’une manière quasi universelle (193 États sur 195) en fait un texte hors norme de part sa portée dans l’espace et de par l’enthousiasme spontané qu’ [il] a suscité.”<ref>Zermatten, J., Stoecklin D. 2009. Le droit des enfants de participer. Norme juridique et réalité pratique: contribution à un nouveau contrat social. Suisse: Institut International des Droits de l'Enfant., p.7 </ref> Ce parcours historique est une partie importante de l’histoire qu’on écrit aujourd’hui.
On peut remarquer que le premier pas vers l'individualisation de l'enfant datant de 1924, pointe le bout de son nez quelques années après la fin de la première guerre mondiale. Le deuxième est marqué par la Déclaration de Droits de l'Enfant de 1959, donc à l’image de la précédente, elle date des années après la seconde guerre mais est également un point de départ menant vers la Convention de 1989.
Le long chemin vers une telle reconnaissance était en grande partie marqué par la création, un peu partout en Europe, des communautés d'enfants. Leur rôle n'est pas négligeable. La définition de ces communautés d'enfants est donné à Trogen en juillet 1948 et semble préciser un peu plus les besoins de l'enfant en tant que personne. Ce sont: "les organisations éducatives ou rééducatives à caractère permanent, fondées sur la participation active des enfants ou adolescents à la vie de la communauté, dans le cadre des méthodes d’éducation et d’instruction modernes – et dans lesquelles la vie de famille se combine de diverses façons aux modalités de la vie de collectivité".<ref>Cours de M.Ruchat: L’éducation spéciale du XVIIIe au XXe siècles: L’éducation, les normes et l’individu, Université de Genève, 2013</ref>
Dans l’esprit de la reconnaissance d’un enfant à part entière avec le respect de sa liberté, Alexander Sutherland Neill crée son école de Summerhill en 1921, une école qui encore de nos jours suscite beaucoup de discussions et polémiques. Dans le cadre de cet atelier d’intelligence collective nous avons procédé à une comparaison des idées de Neill décrites dans son livre "Libres enfants de Summerhill" (1960) avec la Convention relative aux Droits de l’Enfant de 1989 avec un constat tout à fait surprenant.
Historique des droits de l'enfant
« L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur » Déclaration de Genève sur les Droits de l’Enfant, 1924
Il est important de signaler qu'avant même l'intérêt qui s'est peu à peu développé quant aux droits de l'enfant, il a d'abord fallu que la société prenne
conscience du statut particulier de l'enfant, avec ses spécificités, et bien plus encore d'être humain digne de droits propres : “L’adulte a longtemps cru que c’était lui-même qui devait animer l’enfant par ses soins et son assistance. Il pensait que son rôle était de façonner l’enfant, de construire sa vie psychique pour que l’enfant devienne peu à peu comme lui. L’enfant était un objet d’assistance, un adulte en devenir (certains disent même "en miniature") et non une personne humaine à part entière. Petit, faible, pauvre, dépendant, il n’était qu’un citoyen potentiel qui ne sera homme ou femme que demain. Il ne devenait une personne humaine, sujet de droits, qu’à partir du moment où il atteignait l’âge adulte. C’est à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, notamment après la Première Guerre mondiale, que le concept de droits de l’enfant apparaît.” <ref>Dhellemmes V. ,2010. La dignité et les droits de l'enfant : vingt ans d'avancées sur le plan international. In. Transversalités, 2010/3 N° 115, p. 99-110.</ref>
Quand on fait une recherche sur des droits de l’enfant à travers les documents écrits en l'espace de plus de cent ans, du début du XXème siècle jusqu’à aujourd’hui, on retrouve les noms de deux précurseurs qui ont marqué le cours de l’histoire. Il s’agit de Britannique Eglantyne Jebb (1876-1928) et du polonais Henryk Goldzmit (1878–1942) connu sous le nom de Janusz Korczak.
Ce dernier, pédiatre et éducateur qui a tant "aimé et défendu" les enfants, ne voulant pas les laisser seuls, s'est laissé emmener avec eux à Treblinka où il est mort dans une chambre à gaz.<ref>Korczak J. Le droit de l’enfant au respect. L’héritage de Janusz Korczak. Conférences sur les enjeux actuels pour l’enfance. In. http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/themes/Children/PublicationKorczak_fr.pdf</ref>
Korczak, l'inspirateur des droits de l'enfant est bien, d'abord, un insurgé, comme toute son œuvre en témoigne. C'est un homme qui ne supporte pas la violence faite à l'enfance : la violence physique, bien sûr, la violence psychologique également, mais aussi la violence des institutions qui prétendent œuvrer pour "son bien".<ref>Meirieu P. 2002. Le pédagogue et les droits de l’enfant : histoire d’un malentendu ?. Editions du Tricorne et Association suisse des Amis du Dr Korczak. p.4</ref>
“Janusz Korczak, premier défenseur des droits de l’enfant et le plus radical, a été déçu en découvrant la Déclaration des droits de l’enfant adoptée par la Société des Nations en 1924, pas assez claire à son goût et plus implorante que contraignante. Il voulait des droits et non la charité, immédiatement et non dans un avenir lointain.” <ref>Korczak J. Le droit de l’enfant au respect. L’héritage de Janusz Korczak. Conférences sur les enjeux actuels pour l’enfance. In. http://www.coe.int/t/commissioner/Activities/themes/Children/PublicationKorczak_fr.pdf p.7). </ref>
Le travail d'Eglantyne Jebb qui a élaboré et rédigé la Déclaration de Genève a été important. Elle l’a présenté le 26 septembre 1923 et le 28 février 1924 le Ve Congrès général de la Société de Nations qui l'a alors ratifié. C'est le premier texte énonçant des droits fondamentaux des enfants ainsi que la responsabilité des adultes à leur égard. Il est constitué de cinq articles.
Déjà dans le préambule on peut lire que « L’humanité doit donner à l’enfant ce qu’elle a de meilleur.» On peut y voir également que c’est la protection physique qui est mise en avant en soutenant l'idée de venir en aide en cas de détresse ainsi que celle de combattre la faim et l'exploitation (articles 2, 3, 4). En parallèle la notion de développement spirituel n’est pas omis (article 1) de même que le fait que “l’enfant doit être élevé dans le sentiment que ses meilleures qualités devront être mises au service de ses frères”(article 5). Ce texte d'après première guerre mondiale est aussi une contribution à un monde de paix s'étayant sur les enfants qui forment l'avenir, un avenir que les promoteurs des droits de l'enfant voudraient dans la paix.
Déclaration des Droits de l’Enfant, 1959
Après la seconde guerre mondiale, l'ONU est créée. Elle va s'intéresser aux droits de l'enfant et révéler l'insuffisance de la Déclaration de Genève. En effet, suite à l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (1948) et à l'évolution du droit durant cette période, on pense nécessaire d'approfondir cette question des droits de l'enfant. Plusieurs pays membres de l'ONU réclament une convention, c'est-à-dire un instrument international contraignant qui engage les états qui l'ont ratifié. Mais cette proposition est refusée. Le choix se porte alors sur une seconde Déclaration des droits de l'enfant qui reprend l'idée selon laquelle l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. La déclaration des Droits de l'Enfant est adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies à l'unanimité (70 pays membres), le 20 novembre 1959. Cette date est depuis lors officiellement la journée des droits de l'enfant. La déclaration contient 10 principes fondateurs (elle double donc ceux de 1924!) avec des droits concrets comme par exemple le droit à un nom, à une nationalité ou à un enseignement gratuit au niveau élémentaire.
Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant, 1989
Le 20 novembre 1989, la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette Convention a pour but de reconnaître et protéger les droits spécifiques de l'enfant. Elle est composée de 54 articles (elle quintuple le nombre de 1959!) autour des orientations principales suivantes:
- la non - discrimination
- l'intérêt supérieur de l'enfant
- le droit à la vie, la survie et le développement
- les droits participatifs.
Les Etats ayant ratifiés cette Convention se doivent de respecter ces articles et de mettre en place les mesures législatives pour protéger les droits de l'enfant.
La CIDE est une déclinaison des droits de l'homme exprimés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) et pose que l’enfant est sujet de droit. Elle accorde aux enfants des droits propres et expose leurs droits économiques, sociaux, civils, culturels et politiques.
En effet, cette Convention est le texte concernant les droits de l'homme qui a été le plus rapidement accepté au cours de l'histoire, et a été ratifié par le plus d'Etats. Seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l'ont pas encore ratifiée aujourd'hui: Les Etats-Unis pratiquent encore la peine de mort pour les enfants dans certains Etats, or cela serait contraire au droit à la vie de l'enfant promulgué dans la CIDE, tandis que la Somalie ne possède pas de gouvernement reconnu pour la ratifier à cause des troubles politiques dans le pays.
Droits de l'enfant - droits de la personne
"L'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur, affirmer leurs devoirs, en dehors de toute considération de race, de nationalité et de croyance" - ce sont les prémices officielles de la reconnaissance de l'enfant de 1924. C'était un début, suivi, comme nous avons décrit plus haut, par la Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959 et par La Convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989.
Il faut ici souligner que “jusqu'à l’adoption de la Convention en 1989, les enfants ne vivaient pas dans les limbes juridiques internationales. Il était au contraire admis qu’ils jouissent de garanties offertes par les instruments internationaux précédents, tels que les pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme (que la Suisse a récemment ratifiés), à l'exclusion bien entendu des droits liés directement à la condition de l’adulte (droit de se marier, de fonder une famille, assurance-vieillesse ou maternité). L’année internationale de l’enfant a conduit la communauté internationale à préciser le statut des enfants en confirmant leur particularité en tant qu'êtres à la fois vulnérables (Préambules de la Convention, par exemple pp. 5, 6, 12) et appelés “à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre”.<ref>Lücker-Babel M-F, Droits de l'enfant: idéologies et réalités. In. Ratifier en Suisse. La Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant?. N° 26, Novembre 1992. p. 43</ref>
L'enfant est donc considéré peu à peu comme un être de droit au cours du XXe siècle, ce que l'on peut voir notamment à travers les différents textes codifiant les droits de l'enfant à cette époque. L'enfant est alors une personne a qui on confère des droits propres.
Tout d'abord, en 1924, le premier texte international au sujet des droits de l'enfant (Déclaration de Genève) attribut à celui-ci des droits primaires, comme lui permettre de se développer normalement sur le plan matériel et spirituel, de gagner sa vie sans être exploité, être nourri, soigné, recueilli et secouru, ainsi que d'être élever dans l'esprit que ses qualités devront pourvoir à la société. On voit dans ce texte que les droits dotés à l'enfant amorce une idée de soin et de protection de l'enfant dans l'évocation du secours qui doit lui être porté, et démontre aussi un intérêt pour son bon développement. Toutefois, ces articles restent assez pauvres quant aux droits qui leurs sont accordés et l'on voit que le travail de l'enfant reste de mise.
La Déclaration des Droits de l'Enfant de 1959 va plus loin. Ce texte insiste d'avantage sur la protection qui doit être accordée à l'enfant qui n'est plus seulement suggérée sous le terme "secours". Ici, son développement ne doit plus uniquement être normal, mais également sain sur le plan, cette fois-ci moral, spirituel, physique, intellectuel et social. On ajoute que l'enfant doit pouvoir se développer dans la liberté et la dignité.
Il est important de voir que certains principes sont totalement nouveaux comme par exemple, le droit de posséder une nationalité et un nom. On y parle aussi de sécurité non seulement sociale pour l'enfant et sa mère, mais également de sécurité morale.
Dans ce texte, on voit apparaître l'importance accordée à l'affection envers l'enfant, qui est pour lui un besoin. De plus, il est indiqué que la séparation du petit enfant et de sa mère doit être éviter autant que possible. Si l'enfant n'a pas de famille, il est déclaré que c'est alors aux pouvoirs publics et à la société d'en prendre soin, de même pour les enfants n'ayant pas les moyens nécessaires d’existence.
A noter également, l'entrée de l'éducation comme étant un droit pour l'enfant: "une éducation gratuite et obligatoire au moins au niveau élémentaire" (principe 7). Les loisirs sont incorporés dans ce principe comme éléments importants. Il est indiqué que l'enfant a en effet le droit de jouer.
En 1959 est présente l'idée de l'apport des qualités de l'enfant pour les autres membres de la société. Cette idée est accompagnée de celle du devoir de le protéger contre la discrimination, et de l'élever dans un esprit de compréhension, de paix et de tolérance. De plus, on peut remarquer une évolution en ce qui concerne le travail des enfants. En effet, le principe 9 pose clairement des limites à son employabilité; outre la protection de son développement moral, physique ou mental, sa santé ou son éducation, on parle d'âge minimum approprié pour l'emploi. Toutefois, celui-ci n'est pas spécifié. La notion d'intérêt supérieur de l'enfant fait son apparition dans cet écrit.
La Convention relative aux Droits de l'Enfant de 1989 est le texte relevant des droits de l'enfant le plus abouti. En effet, on peut déjà noter la différence en termes de nombres d'articles de ces textes: 1924, La Déclaration de Genève compte 5 articles, on passe à 10 principes en 1959 et à 54 articles dans la Convention relative aux Droits de l'Enfant en 1989. Cette convention reprend les droits exprimés dans les textes précédents, notamment les fondamentaux: droit à l'identité, à la santé, à l'éducation et à la protection et ajoute également bons nombres d'autres considérations. Notamment, un nouveau droit fondamental est inclus dès lors: le droit à la participation.
Pour conclure, en suivant le parcours de l'enfant en tant que personne à part entière, on constate qu'il évolue au cours du XXe siècle. À partir des informations publiées sur le site de l'Unicef on peut retracer les éléments marquants de ce changement en vue de la reconnaissance internationale et de l’importance de l’enfance.
Les droits de l'enfant en Suisse
Le 24 février 1997, la Suisse a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant. Le conseil fédéral a constaté que dans l'ensemble l'ordre juridique suisse était en accord avec les principes de la convention. Néanmoins, il a émis des réserves dans plusieurs domaines où cet ordre juridique n'est pas encore en totale adéquation avec les dispositions de la convention: le droit de l'enfant à une nationalité, le regroupement familial, la séparation des jeunes et des adultes en cas de détention, les procédures pénales impliquant des mineurs.
Par ailleurs, il y a beaucoup de différences entre les divers cantons à propos de la mise en œuvre des droits. Tout ceci doit encore être amélioré.
La Convention est entrée en vigueur le 26 mars 1997 en Suisse.
Il faut ajouter que le pays a ratifié le protocole facultatif au sujet de l'implication des enfants dans les conflits armés le 26 juillet 2002. Ce protocole, afin d'augmenter la protection des enfants et adolescents, a élevé l'âge minimum requis prévu dans la convention sur l’engagement volontaire et l’enrôlement obligatoire dans les forces armées.
En Suisse, le deuxième protocole facultatif qui concerne la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants afin de mieux les protéger de l'exploitation sexuelle est entré en vigueur le 19 octobre 2006.
Une nouveauté visant la reconnaissance d'un mineur est son droit de vote. Il s'agit d'un sujet d'actualité qui prouve que celui des droits de l'enfant commencé le siècle dernier continue. Il faut savoir que les Constitutions et les législations en Suisse divergent en fonction du canton. D’une manière générale le droit de vote au niveau fédéral et cantonal est accordé aux ressortissants suisses ayant 18 ans révolus. Néanmoins certaines cantons suisses ont débuté une démarche visant à accorder le doit de vote au niveau cantonal dès l’âge de 16 ans.
Les citoyens ont pu s’exprimer sur l'abaissement de l'âge du droit de vote à 16 ans dans plusieurs cantons suisses tels que par exemple le canton de Berne, de Neuchâtel ou de Glaris. Celui-ci, en 2010, est le premier a avoir accepté d'accorder ce droit aux jeunes à partir de 16 ans. Comme on peut le lire dans l’article de RTS paru le 28 juin 2010 “beaucoup de jeunes entrent dans la vie active à 16 ans. Ils pourront désormais aussi s'exprimer sur des sujets qui les concernent directement, comme l'école ou l'apprentissage”.
Retour et analyse de l'entretien
Nous avons interviewé Monsieur Jean-Pierre Audéoud, accompagné de sa femme Colette, le 4 décembre 2013. Cet homme, au parcours professionnel d'une grande richesse a oscillé entre le droit et l'éducation. En effet, après des études de droit à l'université de Genève, il a fait une école d'éducateurs au sud de la France (1958-1960). Diplôme en poche, il est revenu en Suisse où lui et sa femme, éducatrice également, ont repris la direction de Serix, une maison d'éducation à Oron-Palézieux. Ils y ont travaillé 10 ans (1963-1973). Ensuite, Monsieur Audéoud a officié en tant que président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud et ce jusqu'en 1995, date officielle de sa retraite. Il s'est ensuite engagé auprès des personnes handicapées en tant que président bénévole de la fondation Espérance.
Le Tribunal des mineurs
M. Jean-Pierre Audéoud, nous a expliqué durant l' interview que son expérience dans le domaine du social lui a permis de mieux appréhender les tâches auprès du Tribunal des mineurs. L’engagement tout à fait remarquable de cet homme est mis en avant durant l’entretien:
“en choisissant le droit j’avais déjà une arrière pensée, je ne pensais pas être juriste dans un bureau ou faire avocat, quelque chose comme ça. C’est… c’était… alors c’est déjà une orientation si vous voulez, c’est-à-dire que je me suis déjà engagé en commençant le droit mais pas d’une manière précise, pas un moment « tac » voilà. Alors bon je sais pas si c’est à prendre en considération. Mais ça c’est affiné si vous voulez… non puis alors l’engagement véritable c’est quand je suis parti à Montpellier, c’est le choix de cette école d’éducateurs où je voulais compléter ma formation de juriste pour pouvoir à l’occasion revenir dans la juridiction des mineurs.”
Il faut souligner ici que le Tribunal des mineurs, cette instance pour laquelle a travaillé Monsieur Jean-Pierre Audéoud, tient une place importante dans le champ des droits de l'enfant. En outre le rôle du juge des mineurs est primordial, car c'est lui qui va s'occuper d'instruire la cause, prendre les décisions quand un délit est commis par un enfant et s'occuper de son exécution.
Une recherche menée à ce sujet nous a permis de voir qu'il existe plusieurs types de sanctions:
- Les "peines prévues par le droit des mineurs :
réprimande ; prestation personnelle (travail d’intérêt général ou séance de sensibilisation) ; amende ; privation de liberté".
- Les "mesures de protection prévues par le droit des mineurs :
surveillance (droit de regard et d'information sur la prise en charge éducative ou thérapeutique du mineur par ses parents) ; assistance personnelle (désignation d’une personne pour seconder les parents et assister le mineur) ; traitement ambulatoire (en cas de troubles psychiques, du développement de la personnalité, de toxicodépendance ou d’autre addiction) ; placement (si l’éducation et le traitement de l’état du mineur ne peuvent être assurés autrement)." <ref>http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Penal_7_web.pdf</ref>
La page web officielle de la République et du canton de Genève, indique que "le Tribunal des mineurs est l’autorité pénale compétente pour poursuivre et juger les infractions commises par les mineurs âgés de dix à dix-huit ans au moment de l'acte. Il est également l'autorité d'exécution des peines et mesures prononcées, ces dernières pouvant durer jusqu'à l'âge de 22 ans." <ref>https://ge.ch/justice/tribunal-des-mineurs</ref>
Les droits de l'enfant à travers le prisme de l'éducation
Il est important de souligner qu'avant de rencontrer notre témoin, nous n'avions que peu d'informations sur son parcours professionnel et de vie. Nous nous sommes rendues compte en menant l'entretien qu'il n'était pas dans des revendications, dans une lutte en faveur des droits de l'enfant au sens strict. Mais il a, de part son métier d'éducateur et ses actions concrètes, participé à l'évolution d'une individualisation de l'enfant; son but étant de faire grandir, évoluer des jeunes pour qu'ils reprennent le droit chemin, tout en respectant leurs besoins. Ainsi, il se trouve un certain décalage entre nos chapitres précédents concernant les droits de l'enfant au sens strict et celui-ci qui traite d'aspects éducatifs à travers une expérience de vie. Néanmoins, nous avons pu faire différents liens entre cette expérience et les droits en tant que tels.
L'entretien avec M. et Mme Audéoud nous a permis de mettre en avant divers aspects reliés aux changements quant au travail d'éducateur durant la période des années 60-80. Ils ont, comme énoncé plus haut, travaillé durant 10 ans (1963-1973) en tant que couple-directeur à la colonie de Serix. Cette maison d'éducation pour jeunes délinquants accueillait à l'époque 40 jeunes enfants et adolescents (uniquement des garçons) placés soit par une instance civile, soit par le service de protection de la jeunesse, ou encore par le tribunal des mineurs. Durant ces 10 années, ils ont initié et participé à de nombreux changements concrets au sein de leur institution. Ces changements reflètent grandement l'évolution du regard porté sur l'enfant à l'époque. Avec la mise en place de cultes le dimanche où les gens des villages alentours se réunissaient au sein même de l'institution ou encore la création d'un jardin d'enfants pour les enfants du personnel, la création d'un parc de jeux par de jeunes scouts, il y a cette volonté d'ouvrir l'institution pour que d'une part les jeunes puissent avoir des contacts avec l'extérieur, mais également pour que les gens de l'extérieur puissent avoir un regard différent sur ce lieu et ses résidents. Les Audéoud vont encore plus loin en créant un foyer d'habitation dépendant de Serix, en intégrant des jeunes dans les écoles des alentours, en leur organisant des vacances ou la possibilité de rentrer dans leur famille le week-end. Cette ouverture vers l'extérieur était vraiment quelque chose de nouveau car durant des années Serix était un lieu très fermé ou rien de filtrait.
Un élément marquant constaté par le couple Audéoud à travers leurs années à Serix est l'évolution du statut d'éducateur. En effet, ils voient se créer des associations professionnelles comme "la conférence romande de directeurs d'institution" ou "l'association romande des éducateurs spécialisés". Se crée aussi durant cette période les syndicats, les conventions collectives. On aspire également à ce que les éducateurs soient mieux formés, soient soutenus dans leur métier. On voit par exemple apparaître des séances de trainings de groupe, des supervisions collectives et individuelles, ce qui était totalement nouveau pour l'époque. Ainsi, dans ces années apparaît une valorisation de cette profession ainsi qu' une prise en compte de la parole des éducateurs et de leurs besoins et souhaits. Il est vrai qu'avant, ces gens se consacraient entièrement à leur métier, jour et nuit; ils ne comptaient pas leurs heures. Ils remplaçaient, comme le dit monsieur Audéoud, la famille de ces jeunes avec tout ce que ça implique. On voit alors petit à petit se créer un structure autour de ce métier, on met en place des horaires, des salaires, etc. On est attentif à leurs revendications, comme par exemple dans le cas de Serix, le fait de pouvoir habiter à l'extérieur de la colonie. Fort est de constater qu'à cette période, il semble y avoir une vraie évolution dans la prise en compte de la personne et de ses besoins. Cette reconnaissance de la profession d'éducateurs a sûrement eu des impacts positifs sur la prise en charge des enfants. On peut finalement dire que l'évolution des mentalités va dans le même sens pour ces deux catégories de personnes.
Cet entretien a mis également en lumière l'évolution de la reconnaissance de l'enfant et de ses droits. En effet, les droits de l'enfant sont des droits de la personne avant tout. L'entretien a par exemple souligné l'importance de l'écoute de l'enfant et son droit à la parole. Ainsi, M. Audéoud nous a expliqué qu'au Tribunal des mineurs le président se doit d'écouter le mineur accusé et ses responsables légaux. D'ailleurs, le but du juge pour enfant selon notre témoin est de choisir la sanction appropriée au mineur particulier, éduquer ou punir : travaux d'intérêts généraux, amande ou encore le placement dans un établissement d'éducation. Il se mêle alors des aspects juridiques à des aspects éducatifs et l'on tente de déterminer ce qui est le mieux pour le jeune et non réellement selon le délit commis.
Il s'agit là d'un changement conséquent, car dans les années 60, M. Audéoud nous a fait part que dans son poste de directeur à Serix, les besoins des jeunes étaient définis par les adultes, qui décidaient pour les jeunes par rapport à ce qu'ils pensaient être bien pour eux, mais sans leur demander leur avis. On n'était pas encore dans une réelle prise en compte de la parole de l'enfant à l'époque. Une évolution sur le plan de l'individualisation de l'enfant et de la prise en compte de ses besoins est visible. En effet, aujourd'hui on entend plus l'enfant, on tente de connaître ce qu'il désire et on regarde si on peut y accommoder. Avant, l'enfant se devait de s'accommoder lui à ce qu'on lui imposait. De même, à Serix les colloques concernant les enfants se déroulaient sans l'intéressé et ses parents, mais seulement avec les éducateurs et autres professionnels entourant le jeune. Petit à petit, les éducateurs ont changé de manière de faire, en imposant moins de choses supposées pour le bien des enfants et adolescents. Dans cet ordre d'idée, on retrouve les points fondamentaux de la Constitution de 1989, du droit à la participation ainsi que la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc, entre les années 60 et 80, le domaine de l'éducation a évolué dans la place attribuée au mineur dans les choix et sujets le concernant, l'écoute qu'on lui accorde et le droit de parole de celui-ci. De plus, les changements sont aussi visibles dans la prise en compte plus aboutie des besoins de l'enfant, notamment par l'expression de ses désirs et ressentis. Mme Audéoud souligne également le recours progressif à l'individualisation de la démarche envers le jeune dans le milieu éducatif de Serix. Ainsi les jeunes ne sont plus approchés collectivement et on tient davantage compte de leur individualité dans les démarches entreprises à leur égard.
Par rapport à la question des valeurs portées par ces deux personnes, on retrouve celles de donner une structure à l'enfant de manière attentionnée, de donner de l'affection à ces jeunes qui souvent en manquait, ainsi que de la reconnaissance. Valoriser l'enfant, le protéger, lui manifester de l'intérêt, mais aussi l'aider à développer ses capacités d'un point de vue cognitif, social et affectif, voilà ce en quoi croyait ce couple. Leurs convictions et ils l'évoquent eux-mêmes répondent toutes aux différents besoins que l'enfant a pour se développer harmonieusement. En cela, on retrouve les fondements de base des droits internationaux des enfants, car on y parle également de protection de l'enfant ainsi que la nécessité de permettre son développement harmonieux.
Finalement, il semblerait légitime de penser que la promotion des droits de l'enfant dans les années 60-80 sont en lien avec les changements dans le travail éducatif de nos témoins et l'évolution de leur regard sur l'enfant.
Conclusions
Les droits de l’enfant, comme nous les avons présenté, ont évolué au cours de décennies du XXème siècle. L’histoire de cette période nous témoigne de leur importance, de leur rôle prépondérant dans la vie d’un être humain. Ceci ne signifie pas que l’on n’a rien de plus à accomplir, bien au contraire. Les préoccupations quant aux conditions de vie des enfants dans le monde sont encore d'actualité au XXIème sciècle. L'enfant est une personne à part entière ce qui ne fait aucune doute et la complexité du concept des droits de la personne abordée dans notre article renvoie justement à la liberté, à l'intégrité, à la sûreté. Mais surtout qu’importe d'où l’on vient et ce qu’on fait, nous avons le droit à la vie.
Les femmes, les prisonniers, les patients, les personnes en situation de handicap, chaque individu a ce droit pour lequel certains se battent encore aujourd'hui.
L’enfance lie les individus qu’importe leur appartenance. Cette période de la vie qui nous est commune prend une dimension à part tout simplement parce que dans chaque enfant émerge l’avenir, notre avenir. Les adultes ont pour but de comprendre les enfants, de les respecter en tant que personnes et de protéger leurs droits.
Avec le temps, l'enfant a peu à peu existé comme personne à part entière. Il n'est plus seulement un "homme en devenir", mais bien un enfant avec ses particularités et besoins spécifiques. De plus, l'intérêt qu'on lui a porté a amené à une prise de conscience de l'importance de lui donner la parole, de respecter ses désirs, intérêts, ainsi que de ses besoins, comme lui les définit. On a ainsi vu à travers notre entretien que d'une définition des besoins de l'enfant par l'adulte durant les années 60 dans les milieux éducatifs en Suisse, on est passé vers une prise en compte plus réelle des besoins de l'enfant en s'adressent directement à celui-ci et en l'écoutant davantage. La protection de l'enfant est une notion importante dans la construction de ses droits.
Comme nous l'avons écrit auparavant, son droit à la vie est signifié dans les textes internationaux. De prime abord, le droit à la vie de tout être humain ainsi que le droit à être protégé nous paraît naturel, mais on voit que cela ne va pas de soi. La reconnaissance du droit et besoin de protection de l'enfant est essentielle, car il s'agit d'un être vulnérable et dépendant, soumis au bon vouloir des parents. Cette relation dominant-dominé, où l'un possède un certain pouvoir sur l'autre se retrouve dans bien d'autres populations. Ainsi, d'autres droits développés à partir du milieu du XXe siècle, comme le droits des femmes, des patients psychiatriques, des patients hospitaliers, des personnes en situation de handicap ou encore des prisonniers vont dans ce sens. Ce sont toutes des populations sous la domination d'autrui pour lesquelles des luttes se sont développées afin de faire valoir leurs droits, en particulier de parole, écoute, autodétermination, etc. La préoccupation de l'enfant va sans doute de paire avec la conscience de la société de cet enfant comme devenir de cette société. En effet, en désirant une société de bons citoyens, épanouis et travailleurs, il faut avant tout s'occuper des conditions et favoriser au mieux le développement harmonieux des enfants. On peut ainsi rapprocher cette volonté d'améliorer la société par le soucis de l'enfant avec l'apparition de l'obligation scolaire pour tous. L'instauration des droits de l'enfant va cependant plus loin, car elle touche à bien d'autres domaines que l'instruction.
Pour finir, on peut voir que ces droits reconnus internationalement doivent tout de même continué à être l'objet d'un travail constant, car entre la théorie et la pratique, il y a de grandes différences, même dans nos pays développés. Ainsi, il importe de faire connaître leurs droits aux enfants, de les faire respecter, notamment à travers des instances et sanctions juridiques à cet égard.
Bibliographie / Webographie
- Droux J.,2011. L'internationalisation de la protection de l'enfance : acteurs, concurrences et projets transnationaux (1900-1925). In. Critique internationale, 2011/3 n° 52, p. 17-33
- Martinetti, F. 2002. Les Droits de l'enfant. Librio
- http://cofrade.fr/
- http://www.humanium.org/fr/
- http://www.netzwerk-kinderrechte.ch/
Notes et références
<references/>
Auteurs du chapitre
- Claire Bourgeois Dubois-Ferriere
- Katarzyna Milena Fratczak
- Victoria Salomon
Introduction
Actuellement, le droit à l'avortement pour les femmes est encore un sujet à contestations et même à une offensive de remise en question: pouvons nous encore le qualifier comme un droit de la femme s'interrogent certains ? Tout au long de cette analyse, nous nous centrerons sur le droit à l'avortement pour les femmes depuis 1970. En effet, les mouvements féministes sont présents depuis longtemps dans l'histoire des droits des personnes. Dans la période de l'après guerre, les femmes se sont mobilisées plus fortement pour acquérir des droits identiques à ceux des hommes. C'est par la lutte pour le droit à un travail rémunéré que les mouvements prennent de l'ampleur : "L'essort du féminisme dans cette période serait intimement lié à celui du travail salarié" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. La question de la procréation est aussi au cœur de leur mouvement, puisqu'il est question de "repeupler" des pays détruits : "Après l'hécatombe de la guerre, jusqu'alors la plus meurtrière, il est nécessaire, plus que jamais de "remplir les berceaux vides"" <ref>Riot-Sarcey, M., 2008, Histoire du féminisme, Paris, La Découvertes, Repères. p. 73 </ref>. Il ne faut pas non plus oublier leur luttes pour l'accès à la politique : plus précisément le droit de vote pour les femmes, qui prend de l'ampleur bien avant la guerre. C'est dans ce contexte d'après guerre, que les femmes réapparaissent pour tenter de faire valoir des droits égalitaires et propres à leur vie.
Cet article est fondé à la fois sur une recherche documentaire et sur la récolte de témoignages de deux personnes pionnières dans l'avancée du droit des femmes à l'avortement. L'article présentera également les différents mouvements féministes conduits dans les années 1970 sur le droit à l'avortement.Ceci nous montrera que la Suisse n’a pas été la première à lutter pour le droit à l’avortement, mais que le phénomène est mondial. Les États-Unis ont sans aucun doute été les précurseurs, mais la lutte s'est largement diffusée et reproduite dans différents pays du monde amenant à des dates différentes sur l'accès à l’avortement. L'article se construira à partir de la lutte des femmes en Suisse et des différentes lois qui en sont ressorties et cherchera à comprendre le rôle qu’ont joué les deux témoins interrogées dans cette récente histoire(1970 à aujourd'hui).
Pour ce faire, nous avons constitué une bibliographie, à partir d’ouvrages sur les mouvements féministes en général, sur la chronologie des contestations. Nous avons lu des articles scientifiques qui présentent la situation en Suisse, épluché les informations sur les deux témoins qui ont été interrogées et consulté les archives contestataires à Carouge.
Nous avons également pu rencontrer deux femmes militantes à Genève sur ce thème. Nous avons donc effectué deux entretiens audio avec Madame Amélia Christinat et Madame Rina Nissim pour obtenir leurs témoignages sur l’histoire des mouvements féministes des années 1960 à 1980, principalement sur la question de l’avortement.
L'Histoire du droit des femmes
Actuellement, des auteures telles que Marcela Iacub et Judith Butler font de la problématique féministe une occasion de débattre de la question du genre, des identités sexuelles et des limites entre les sexes (intersexe, queer, etc), celle-ci peut nous aider à repenser la lutte féministe. Or, la lutte des années 70 (en amont en Suisse de l'accession des femmes à la citoyenneté) est celle d'une longue marche marquée par des féministes de l'après guerre comme Simone de Beauvoir avec sa formule historique "On ne naît pas femme on le devient", soulignant le déterminisme social de la féminité et la "fabrication" culturelle.
Pour tenter de comprendre ce qui s'est passé durant cette époque nous allons revenir sur les faits marquants. Pour la compréhension de ce qui va suivre nous vous conseillons de lire la frise chronologique des événements marquants pour le droit à l'avortement en Suisse.
Mouvements féministes : Buts et démarches
Ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXème siècle que le féminisme se démarque en tant que mouvement collectif de luttes de femmes. "Ces luttes reposent sur la reconnaissance des femmes comme spécifiquement et systématiquement opprimées, l'affirmation que les relations entre hommes et femmes ne sont pas inscrites dans la nature mais que la possibilité politique de leur transformation existe." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref>. En effet, les femmes ont dû faire face à de nombreuses inégalités et cela dans de nombreux domaines: le travail, la santé, la politique... Nous constatons encore aujourd'hui que de nombreuses inégalités persistent concernant le droit des femmes, mais elles sont moindres ou de nature différentes que dans les années 1960-80. Pour pouvoir entrer dans un processus de revendication politique du féminisme, il faut qu'il y ait une "relation avec une conceptualisation de droits humains universels; elle s'ancre dans les théories des droits de la personne dont les premières formulations juridiques sont issues des révolutions américaines puis françaises." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 225</ref> Il convient de faire une distinction entre les mouvements féministes et les mouvements populaires des femmes. En effet, les mouvements populaires des femmes ne mettent pas directement en avant l'exigence de droits spécifiques pour les femmes. C'est l'emploi du mot féministe qui va changer les représentations que l'on se fait à cette époque. Pour certains, les féministes sont "trop bourgeoises au XIXème siècle et au début du XXème siècle trop radicales et ennemies des hommes après les années 1970"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France., p. 126</ref>. Quant à l'expression "mouvement des femmes", elle est plus souvent utilisée comme raccourci pour mouvement de libération des femmes. Voilà pourquoi elle a pu être associée au féminisme le plus radical et explique la confusion entre les deux termes.
Lorsque nous parlons de "mouvements féministes" nous désignons sous une même dénomination "les diverses formes de mouvements de femmes, le féminisme libéral ou "bourgeois, le féminisme radical, les femmes marxistes ou socialistes, les femmes homosexuelles, les femmes noires et toutes les dimensions catégorielles des mouvements actuels"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 127</ref>. Dès lors, l'expression" mouvement des femmes " représente les mobilisations de femmes en Amérique Latine ou les mouvements pour la paix en Irlande ou au moyen-Orient"<ref>Hirata H, et al, 2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France., p.126</ref> Dans la littérature, deux types de mouvements féministes se démarquent. Une première vague a émergé dans la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est souvent représentée autour des revendications du droit de vote. Au début du XXème siècle, où les mouvements sont qualifiés de "néo féminisme", les exigences ne se fondent pas sur une seule exigence d'égalité mais sur une reconnaissance "de l'impossibilité sociale de fondé cette égalité dans un système patriarcal"<ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 126</ref>. Le féminisme des années 1970, se fait connaître par des mouvements anti-autoritaires, par des groupes de parole, il met en avant les formes les plus spontanées de manifestation et refuse toute organisation hiérarchique. " L'appartenance au mouvement représente la mise en acte d'une nouvelle idéologie, la recherche de sens et de valeurs communs." <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p.128</ref>. C'est entre la fin des années 1960 et le début des années 1970 que le féminisme connait une ampleur internationale. "L'onde de choc part des Etats-Unis et gagne très rapidement la Grande-Bretagne et l'Allemagne dans les années 60". Il faut ajouter qu'en "dépit de son caractère extra parlementaire, le mouvement de libération des femmes a la capacité de susciter de larges mobilisations auprès des femmes syndiquées, des femmes de partis de gauche et de droite ou des associations luttant pour les droits des femmes comme le planning familial. Ce sont d'abord les campagnes pour la liberté d'avorter qui constituent les événements les plus importants et les plus marquants <ref>Hirata H, et al,2000, Dictionnaire critique du féminisme, Paris : Presse Universitaires de France, p. 128</ref>.
En ce qui concerne la Suisse, c’est dans la continuité du mouvement de la jeunesse estudiantine de 1968 que naît le nouveau mouvement féministe. C’est à Zurich que se sont réunies des femmes de gauche, que l’on appellera «Frauenbefreiungsbewegung » ou plus communément le FBB. Elles critiquent le fait que les femmes sont oppressées et qu’il s’agit d’une « contradiction sociale fondamentale ». Le MLF, pour la Suisse romande et le MFT au Tessin vont très rapidement suivre la création du FBB, avec comme objectif commun de « récuser l’organisation hiérarchique des associations et de la politique traditionnelle » <ref>Commission fédérale, Femmes Pouvoir Histoire, 1.3, p. 1, consulté le 27 Novembre sur http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UpvKGVSBak0J:www.ekf.admin.ch/dokumentation/00444/00517/index.html%3Flang%3Dfr%26download%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdH58hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--+&cd=2&hl=fr&ct=clnk&gl=ch&client=firefox-a</ref> inspirés des mouvements français et américains préalablement abordés. Cependant, des divergences existent entre tous ces mouvements sur différentes questions telles que l’avortement ou encore la possibilité pour le sexe féminin de faire l’armée. Une chronologie a été rédigée dans l’article suivant : "Le nouveau mouvement féministe et les organisations féminines depuis 1968" de la Commission fédérale pour les questions féminines de la Confédération Suisse.
La période entre 1940-50 : une période restrictive
Pour comprendre la lutte pour l'avortement comme droit de la personne, il nous faut revenir sur le contexte de l'après guerre. Tout comme il a été expliqué dans le chapitre précédent, concernant les droits des enfants, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (1948) a influencée les mouvements des femmes. Nous allons, tout d'abord, revenir sur ce qui s'est passé avant cette date. En effet, nous savons que la législation Suisse sur l’avortement est l’une des plus restrictives d’Europe. Les premières dispositions du Code pénal suisse à ce sujet ont été définies en 1942 et prévoient, à cette époque, l’emprisonnement de la femme qui avorte, ainsi que de la personne qui l’aide à pratiquer cet acte. En revanche, une exception existe : si la grossesse comporte un danger pour la mère et que l’interruption de grossesse est pratiquée par un médecin, l'avis étant approuvé par un second médecin, l’avortement n’est alors pas punissable. On comprend alors que la conséquence a été un nombre considérable d’avortements illégaux. Cependant, la mise en place de dispositifs de préventions et d’une diffusion d’informations a contribué à faire diminuer le nombre d’avortements autant illégaux, que légaux. Par ailleurs, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a étendu la notion de « santé » en y insérant les dimensions de bien-être psychique et social : « la santé ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ; elle est un état de complet bien-être physique, mental et social. »<ref>Rey, A.-M., 2013, Tendance à la libéralisation, USPDA. Consulté le 7 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/liberal.htm</ref>. Ceci légalise aussi la pratique d’interruption de grossesse et écarte la menace d’emprisonnement. <ref>Rey, A.-M., 2013, L'ancienne législation de 1942, USPDA. Consulté le 7 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/loi_1942.htm</ref>
Cependant, cette législation attise la colère et entraine la montée d’une révolte. Au début du XXème siècle, nous voyons s’élever des mouvements, tels que les organisations ouvrières, pour lutter en faveur de la décriminalisation de l’avortement.
De plus, dans cette période, il existe une différence entre les législations cantonales sur l'avortement entrainant une inégalité entre les femmes. Ceci met donc les professionnels dans l'embarras puisqu'ils n'ont pas une pratique généralisée en Suisse. Des mesures fédérales strictes ont alors été prises pour tenter de généraliser les pratiques et s'accorder sur la pratique de l'avortement : « l’institutionnalisation juridique d’une interruption de grossesse pouvant être légalement pratiquée par un médecin sous haute surveillance de l’Etat : consultation obligatoire d’un second médecin, qui doit être un spécialiste et en plus agréé par les autorités cantonales compétentes, et qui doit donner par écrit un « avis conforme ». Il faut également le consentement écrit de la femme enceinte. ». Ainsi, à cette époque, nous constatons que les femmes n'ont pas la maîtrise de leur corps et par conséquent, la maternité ne peut se contrôler. Ce contexte illustre la réalité des femmes: soit elles ont la chance de pouvoir trouver deux médecins qui l'estiment en danger, soit elles décident de pratiquer un avortement illégal ce qui comporte de grands risques pour leur santé (hémorragie et infection qui peuvent entraîner la mort de la femme).
La période 1960-70 : les premiers changements
Le graphique ci-contre nous montre la condamnation des femmes en ce qui concerne l'avortement.<ref>Rey, A.-M., 2013, Interruption de grossesse en Suisse : les faits et les données, USPDA. Consulté le 18 Novembre sur http://www.svss-uspda.ch/pdf/faits-et-donnees.pdf </ref>
En effet, nous voyons que le pic le plus élevé se situe dans l'année 1950, avec 550 condamnées. Puis lors de la commercialisation de la pilule, l'emprisonnement des femmes diminue fortement. L'année suivante, passe d'environ 400 condamnations à 260 condamnations. De manière générale, ce graphique montre que les condamnations sur la période 1960-1980 n'ont cessé de baisser.
Les années 60 sont donc marquées par l'arrivée de la pilule contraceptive en Suisse. En effet, en 1961, la commercialisation de celle-ci fait reculer le nombre d'avortements pratiqués en Suisse puisque les femmes ont un contrôle sur leur reproductibilité. Malgré tout, la pilule contraceptive circule à l'époque discrètement, puisqu' aucune loi ne précise son autorisation. En 1965, la création du premier planning familial en Suisse au HUG permettra de conseiller les familles. L'établissement ouvrira donc un pôle dédié à l'information familiale et aux régulations des naissances.<ref>Fert-Bek, D., (s.d.), Historique, Le service du planning familial de Genève a 40 ans,Genève, HUG. Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://planning-familial.hug-ge.ch/nous/historique.html</ref> Dans cet établissement, les professionnels conseillent les parents sur la manière d'avoir un contrôle sur l'élargissement de leur famille. Ainsi, grâce à cette structure, la pilule contraceptive a pu circuler dans le territoire helvétique. La pilule était considérée pour certain comme un enjeux économique : elle permettait de contrôler les naissances et donc de préserver la richesse, et pour d'autres comme un moyen de débrider la sexualité des femmes<ref>L'illustré, (s.d.) La pilule qui a changé le monde, Archives, Consulté le 18 Novembre 2013 sur http://www.illustre.ch/la_pilule_qui_a_change_le_monde_45372_.html</ref>.
Le Mouvement de Libération des Femmes (MLF) a démarré aux Etats-Unis, et a encouragé les militants des autres pays à lutter pour améliorer les conditions féminines. Le MLF créé en 1969 à Zurich,que l'on retrouvait également dans d'autres cantons (Genève et Tessin par exemple) se base "sur les mouvements de libération du Tiers monde pour encourager les femmes à se libérer des contraintes inhérentes à la famille nucléaire (Rôle des sexes)." <ref>Jorris, E., 2009, Mouvement de libération des femmes (MLF). Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16504.php</ref>. Sur le canton de Genève plus précisément, des groupes de certains partis de gauche militaient en ces faveurs (ils étaient très hiérarchisés et ne plaisaient pas à toutes les femmes militantes). C'est donc principalement grâce à Madame Brodmann (qui a milité aux Etats-Unis) et Madame Gramoni qu'il y a eu dans un premier temps le front des Bonne-Femmes (où militait aussi Rina Nissim). Leur premier slogan a été "Femmes décolonisons-nous !" avec des affiches placardées sur les façades des grandes banques : les femmes insistaient donc pour la ré-appropriation de leur corps (avortement, pilule contraceptive, ...).<ref>Roussopoulos Carole, Debout ! Une histoire du mouvement des femmes 1970-80, 1999. Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://ballonsonde.org/wikiSonde/videos/Femmes_Debout.htm</ref>
Les femmes pensent donc vivre singulièrement des situations d'exclusions et d'injustices, cependant, en discutant ensemble, elles se rendent compte qu'elles vivent toutes ce genre de situation. Cette prise de conscience favorise donc la mobilisation des femmes pour combattre les injustices dont elles sont victimes. Les communautés ou ce que l'on pourrait appeler regroupements permettent donc aux femmes de prendre conscience mais aussi de prendre du pouvoir dans la société. L'effet de groupe a permis un rassemblement dans les rues de milliers de femmes pour manifester ensemble contre des inégalités entre sexe (MLF).
Dans le même temps, il ne faut pas oublier que les avortements illégaux continuent à être pratiqués à cette période. En effet, le nombre d'avortements, légaux et illégaux, est estimé à 50 000 en 1966. Les avortements légaux s'élevaient à environ 17 000 en 1966 (16 000 en 1978 et 1980, 14 000 en 1985, 13 000 en 1990, 12 000 en 1995, 13 000 en 1996 et 1998). Les avortements clandestins diminuèrent grâce :
- à la raréfaction avec l'élargissement des indications médicales dans les cantons libéraux (Zurich, Bâle-Ville, Berne, Vaud, Neuchâtel, Genève) dès les années 1950
- la libéralisation progressive dans d'autres cantons(Tessin dès les années 1970; Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Schaffhouse, Soleure, Jura au cours des années 1990)
- la généralisation des centres de planning familial, des cours d'éducation sexuelle, la diffusion de moyens de contraception sûrs dès les années 1960
- le remboursement de l'intervention par les caisses maladie).
On remarque également, que malgré les mesures juridiques fédérales restrictives, les cantons adoptent des pratiques très différentes les uns des autres. Ainsi, les dimensions d’ordre psychologiques et sociales sont incluses dans les indications médicales des cantons libéraux, alors que la pratique est seulement tolérée dans les cantons conservateurs catholiques. Face à cette inégalité juridique, les cantons libéraux accueillent des femmes vivant dans ces cantons restrictifs pour se faire avorter. On assiste à une forme de tourisme « gynécologique ». Cela amène les cantons à réfléchir sur ces pratiques. Notamment le canton de Neuchâtel, où plusieurs affaires d'avortements sont jugées.
La période 1970-1980 : La période clé
A la suite de ces scandales, le député radical Maurice Favre dépose en mars 1971 une motion en faveur d'une initiative cantonale demandant la suppression des articles 118 à 121 du CP.
Cette démarche est suivie du lancement, en juin de la même année, par un comité de cinq personnes, de l'initiative populaire fédérale pour la décriminalisation de l'avortement, largement soutenue notamment par le mouvement des femmes. En 1972, les milieux chrétiens conservateurs font circuler une pétition "Oui à la vie, non à l'avortement". A partir de ce moment-là, nous voyons apparaître les organisations et les mouvements féministes qui manifestent en faveur de l’interruption de grossesses libres et gratuites, ainsi que pour revendiquer la décriminalisation de l’avortement. Deux propositions sont donc faites : accorder un délai pour l'avortement (par exemple : les avortements pourront être légaux pendant les 10 premières semaines de grossesse) ou élargir les motifs pour l'avortement (par exemple : souffrances psychiques, douleurs physiques, ...)
C'est une lutte qui s'engage contre des mentalités traditionnelles où l'homme est dominant dans la société. La prise de conscience des femmes et de leurs conditions se fait petit-à-petit, en prenant plus d'ampleur au milieu des années 70. C'est la réunion de plusieurs milliers de femmes qui implique que l'on puisse qualifier le MLF de mouvement. Ce sont des femmes de tout âge qui se battent pour l'amélioration de leur conditions de vie. Ces mouvements veulent principalement lutter pour le droit du libre choix des femmes ou de manière générale à ce que l'on nomme "l'autonomie des femmes". A cette époque, il y a deux types de femmes : celles qui font des études mais qui restent à la maison pour materner, ou bien celles qui font des études et qui travaillent. Ces dernières se trouvent confrontées à la réalité sociale : avec le même titre professionnel, les femmes obtiennent des salaires bien inférieurs à ceux des hommes. Suite à cette prise de conscience face au Plafond de Verre, les femmes se réunissent pour échanger leurs histoires. Elles se mobilisent donc afin de pouvoir avoir le contrôle sur leur vie, et sur leur corps. L'une des grandes luttes se concentrer autour du contrôle de leurs corps : ce qu'elles nomment la mobilisation pour la ré-appropriation du corps. Il s'agit de donner aux femmes la possibilité de choisir leur maternité, leur contraception, et leur médicamentation. En 1978, sur le canton de Genève, l'ouverture du Dispensaire des femmes (par Rina Nissim) leur permet d'être accueillies dans un lieu où on leur donne des conseils, des listes de gynécologues tolérants face aux choix d'avorter ainsi que différentes méthodes pour soigner les maladies génitales, ... De plus, les femmes peuvent, si elles le veulent, accéder au groupe action Self-Help du MLF ; qui est un lieu où l'on échange sur son vécu, et où l'on pratique des examens concrets pour découvrir son corps. L'instruction, comme l'évoque Mme Christinat permet aux femmes de comprendre les injustices auxquelles elles sont confrontées et de se mobiliser pour que toutes les sociétés reconnaissent les femmes comme des "personnes avec un cerveau".
Dans le même temps, une nouvelle réglementation sur l’avortement est considérée par le Conseil fédéral, et trois variantes sont discutées : la première, appelée "solutions des indications" autorise l’avortement dans les situations où la grossesse menace la vie ou la santé de la femme, en cas de viol, ou encore si l’enfant présente un trouble ou une déficience physique et/ou mentale. Une autre variante est celle des « indications sociales » qui prend en compte la situation sociale précaire de la femme. Finalement, la troisième, « solution des délais », permet l’avortement pendant les douze premières semaines de grossesse. Il va sans dire que les partis politiques, les organisations et les cantons conservateurs catholiques sont en faveur de la solution la plus restrictive, alors que leurs rivaux refusent les trois types de variantes et revendiquent l’avortement libre et gratuit. Le Conseil fédéral rejette l’initiative pour la décriminalisation de l’avortement, mais opte finalement pour la solution des indications élargies, attisant ainsi le mécontentement des deux camps. Face au rejet de l’initiative populaire pour la décriminalisation de l’avortement, l’Union Suisse pour la Décriminalisation de l’Avortement (USPDA) (dont fait partie Amélia Christinat) propose un compromis et lance une initiative qui cette fois rejoint l’idée de la solution des délais. «L’initiative réclame la décriminalisation de l’avortement s’il est pratiqué par un médecin avec le consentement de la femme pendant les douze semaines qui suivent les dernières règles ». Cependant, celle-ci essuie à nouveau un échec : elle est rejetée par la majorité des cantons. Les années suivantes toutes les propositions d'initiatives, pour ou contre l'avortement, sont sans cesse rejetées. Mais les luttes féminines pour le droit à l'avortement s'amplifient durant cette période afin de faire changer les droits de la personne et principalement les droits de la femme. Ce n’est qu’en 1990, que l’idée d’une révision de la loi relative à l’avortement est remise sur le devant de la scène.
Nous constatons que cette période est riche pour la mobilisation des droits des femmes ; de multiples groupes se forment à l'intérieur du MLF, de nouveaux établissements pour les femmes se créent, les partis politiques se questionnent à nouveau, même Le Conseil d'Etat Vaudois, etc. Des femmes se mobilisent également pour d'autres causes qui ne les touchent pas particulièrement puisque nous verrons, dans le dernier chapitre de cet article, que plusieurs d'entres-elles se sont mobilisées pour le droit à l'autodétermination des patient des hôpitaux.
De manière générale, c'est surtout l'envie de faire changer la mentalité de la société pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, qui se fait ressentir. En 1791 en France, l'écrivaine http://fr.wikipedia.org/wiki/Olympe_de_Gouges propose la Déclaration des Droits de la Femme et de la Citoyenne se basant sur la version originale et dont le but était de montrer l'égalité juridique entre homme et femme.
Depuis 1990
Les différentes mobilisations des femmes soixanthuitardes ont permis la diminution d'une multitude d'inégalités pour lesquelles elles se mobilisaient.
Revenons tout d'abord, en 1994, où l'on constate un net recul du nombre d’avortements légaux. Ceci peut s’expliquer par une diffusion de l’information (éducation sexuelle) et la libre disposition de moyens contraceptifs. Ce phénomène vient appuyer l’idée que la libéralisation ne conduit pas à une augmentation des avortements, bien au contraire. Plusieurs services se sont donc installés suite aux manifestations des femmes dans les rues. A partir de là, les choses commencent à changer et vont en faveur de la décriminalisation de l’avortement. En effet, le Conseil National adopte en 1995 "la solution des délais". En 1996, la Commission des Affaires Juridiques du Conseil National ratifie un projet de loi qui prévoie la décriminalisation de l’avortement pendant les 14 premières semaines après les dernières règles. On voit même les femmes du parti démocratique-chrétien (PDC) aller en faveur du droit de la femme à l’autodétermination et pour "la solution des délais". De nombreuses organisations telles que la Fédération suisse des Eglises protestantes, les groupes des femmes radicales de Suisse, accueillent cette solution des délais comme un compromis tolérable. Toutefois, le Conseil Fédéral rejette une fois de plus la "solution du délai" en 1998. Nous constatons donc que les manifestations pendant plus de 15ans, ne suffisent pas pour que la Suisse autorise l'avortement. En France par exemple, la lutte des femmes a été moins longue en ce qui concerne le droit à l'avortement puisqu'il est autorisé depuis la Loi Veil de 1975 et suite aux manifestes des 343 de 1971.
Par ailleurs, la pilule abortive Mifegyne (RU 486) est admise et commercialisée en Suisse dès 1999. La notice d'utilisation explique son utilité : "Mifegyne est un médicament qui bloque l'action de la progestérone, une hormone nécessaire au maintien de la grossesse. Mifegyne peut donc provoquer une interruption de grossesse." Cependant cette méthode médicamenteuse est soumise aux mêmes dispositions pénales que l’avortement et est prescrite uniquement par le corps médical.
Finalement, le Parlement adopte la solution du délai en mars 2001 qui est rentré en vigueur en 2002. « Ainsi l’avortement n’est pas punissable pendant les 12 premières semaines de la grossesse à condition que la femme fasse valoir une situation de détresse. Les cantons doivent décider quels cabinets et établissement peuvent pratiquer l’intervention. » <ref>Rey, A.-M., 2013, Régime du délais, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/loi.htm</ref> De plus, Rey (2013), illustre les modifications entre l'ancienne et la nouvelle loi de 2002, relatif à l'avortement. <ref>Rey, A.-M., 2013, Comparaison ancienne et nouvelle législation, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/comparaison.htm </ref> Depuis ce jour, la femme est la seule personne qui ait le droit de choisir ou non l'avortement. En aucun cas, une personne tierce (et même si celle-ci a une blouse blanche) ne pourra refuser l'avortement d'une femme dans les douze premières semaines de grossesse.
Nous pouvons donc conclure que « les discussions provoquées en 1971 par l’initiative en faveur de la décriminalisation de l’avortement ont été à l’origine d’un changement des mentalités et d’une prise de conscience ».<ref>Rey, A.-M., 2013, Chronologie des événements dès 1970, USPDA. Consulté le 7 Décembre sur http://www.svss-uspda.ch/fr/suisse/chronologie.htm </ref> En effet, nous assistons à une diminution du nombre de condamnations et à une libéralisation de la pratique de l’avortement. Par ailleurs, on se rend compte qu’à travers la mise en place de centres de plannings familiaux et des dispositifs d’informations, comme l’éducation sexuelle, on parvient à lutter contre l’avortement. La prévention prévaut donc à la pénalisation.
Cependant on constate que la réglementation à ce sujet peut encore être modifiée, car ce droit à l’avortement est sans cesse remis en question. En effet, en 2010, le mouvement anti-avortement « Mamma », qui s'intitulait auparavant "Pour la mère en l’enfant" lance une initiative populaire : « Financer l’avortement est une affaire privée». Il s’agit d’une initiative qui demande que l’IVG ne soit plus prise en compte par les prestations de l’assurance maladie de base, et ce en invoquant l’idée qu’il s’agit d’une décision d’ordre privé, et que de ce fait le financement public n’a pas de sens. Cependant, on remarque que le droit à donner la vie est également de l’ordre du privé, et pourtant celui-ci n’est pas contesté. Rina Nissim, nous met en garde contre la tournure que prennent les événements d'aujourd'hui (concernant le financement de l'avortement). En effet, selon elle, nous serions en pleine régression concernant le libre choix de la femme. A contrario des générations d'après 70, il faut que les générations d'aujourd'hui se mobilisent pour faire en sorte de garder un droit durement acquis par les femmes soixanthuitardes. La votation de Février 2014 qui se prépare pourrait modifier les droits que nous avons jusqu'à présent, et pour lesquels les générations précédentes se sont battues. Si les générations actuelles et les suivantes veulent elles aussi avoir la possibilité de choisir si elles veulent devenir mère ou non, elles se doivent de s'impliquer pour faire en sorte de ne pas perdre les droits acquis.
Le droit à l'avortement est également contesté dans les autres pays Européens. En France par exemple, Marine Le Pen propose d’annuler le remboursement des IVG « de confort ». On remarque que cette terminologie n'est pas sans sous-entendu. En effet, celle-ci suggère que l’avortement soit bien devenu un moyen de contraception, tant sa pratique serait devenue répandue; et mettrait également en avant l’idée que cette pratique est une obligation et non un recours. L'Irlande et l'Espagne seraient les deux pays Européens les plus réactionnaires au droit à l'avortement. En effet, le premier ministre devrait sous peu, mettre en place une nouvelle loi sur ce sujet. L'avortement ne sera alors possible que dans l'une des trois conditions (viol, malformation du fœtus ou danger de la mère) et les personnes mineures devront avoir une autorisation des parents. <ref>Magnan, P., (2014) Avortement : le retour en arrière de l'Espagne, premier signe en Europe ?. consulté le 6 Janvier 2014 sur http://geopolis.francetvinfo.fr/avortement-le-retour-en-arriere-de-lespagne-un-premier-signe-en-europe-28245 </ref> Dans le cas de l'Espagne, ce projet de loi fait un retour en arrière dans l'histoire de droits des femmes puisqu'il s'agit de la loi d'il y a 30 ans<ref>"L'Espagne veut revenir à la loi d'il y a trente ans".Tribune de Genève, Avortement, 21-22 décembre 2013, p. 7.</ref>. La crise économique, comme nous l'avait précisé Rina Nissim, influencerait les multiples régressions concernant les droits des femmes ; dont celui de leur intégrité physique.
Liens avec l'Actualité
En lien avec l'actualité, nous pouvons constater qu'aujourd'hui ce droit est à nouveau remis en question. Le 9 février 2014 nous voterons pour l'initiative " Financer l'avortement est une affaire privée". Ces votations ne remettent pas directement en cause la possibilité d'avorter mais c'est sans doute un pas pour y aboutir et remettre en cause ce droit fondamental. Ce débat est d'une telle importance qu'il a fait l'objet de multiples débats ces dernières semaines. On comprend alors le rôle des futurs générations dans ce combat qui avait mené nos ainées à manifester dans les rues afin qu'on ne les désapproprient pas de leur corps...
Les témoins qui ont participé aux changements
Nous avons décidé d'interroger des personnes qui se sont mobilisées en Suisse pour le droit à l'avortement. Elles pourront donc partager des éléments personnels sur le contexte de l'époque, et les problèmes qu'elles ont pu rencontrer pour la mise en place de ce droit.
Nous avons dans un premier temps contacté Mme Christinat Amélia, avec qui l'une de nous avait déjà interviewé il y a quelques années dans un cours du Prof. d'histoire au Collège Voltaire Philippe Herren. Cette personne a donc accepté de participer à notre recherche en répondant à nos questions lors d'un entretien.
Dans un second temps, nous avons contacté Mme Wenger Salika, marraine de l'association "Ni pute, Ni soumise" qui est actuellement impliquée dans la politique sur Genève, puisqu'elle fait partie du Conseil Administratif de la ville de Genève. Deux d'entre nous l'ont connue lors de sa venue à l'émission télévisée Infrarouge (RTS) dédiée aux mouvements des Femens (novembre 2011). Après discussion téléphonique, nous avons eu des éléments pertinents qui pourraient nous intéresser pour notre recherche, cependant Mme Wenger, très occupée, n'a pas pu nous accorder un entretien avant Janvier 2014. C'est pourquoi après réflexion, nous avons décidé de contacter une troisième personne qui pourrait éventuellement être plus disponible : Mme Nissim Rina. Par l'intermédiaire de Mme Ruchat nous avons obtenu ses coordonnées téléphoniques et avons pu avoir un rendez vous rapidement.
Afin de leur éviter un quelconque déplacement,nous avons rencontré ces personnes à leur domicile. De plus, pour des raisons pratiques et également afin de ne pas abuser de leur hospitalité, nous avons décidé de mener ces entretiens par groupes de trois.
Nous proposerons aux différents acteurs de partager leurs souvenirs concernant les années 1970 à Genève, afin que nous comprenions la situation actuelle du droit à l'avortement.
Retour sur les entretiens
Entretien de Rina Nissim
Notre premier entretien s'est déroulé le mercredi 27 Novembre. Trois étudiantes se sont rendues au cabinet de Rina Nissim. L'entretien qui en découle nous a projeté dans un univers très différent du notre : où la femme n'avait que très peu de droits. C'est de par son discours, que la militante a partagé avec nous des informations sur l'ambiance, la mobilisation et la persévérance des actrices de cette époque. C'est par la prise de conscience de plusieurs injustices que les femmes se regroupent pour se mobiliser contre une société qui octroie peu de considération aux femmes. Le MLF, lutte donc de manière générale pour plusieurs droits (droit à l'égalité salariale, droit à la contraception, droit à l'avortement, ...).
Entretien d'Amélia Christinat
Le second entretien s'est déroulé le 5 décembre chez Christinat Amélia. A notre arrivée, nous lui avons dit que nous avions déjà des questions précises à lui poser et que ces questions seraient les mêmes pour tous les groupes. En effet, sachant que c'est une femme très bavarde nous avons préféré poser le cadre dès le départ. Nous avons pu constater en rentrant dans son salon qu'elle avait préparé différents articles concernant le droit à l'avortement - des articles qu'elle nous a présenté tout au long de l'interview -. C'est avec beaucoup d'émotion qu'elle a répondu à nos questions et qu'elle a raconté son combat pour les différents droit de la femme - droit de vote, droit à l'avortement etc.-. A travers ses propos nous avons vraiment ressenti, l'importance que ces combats ont eu pour elle.
Points communs entre les entretiens
Plusieurs points communs ressortent de ces deux entretiens.
Tout d'abord, nous constatons que le droit à la réappropriation du corps ou plutôt à l'autonomie des femmes, comme cité par Rina Nissim, représente l'un des combats des années 1960-80. Si les femmes, par leur combats, manifestations ont réussi à faire valoir leur droit à l'avortement, elles ont aussi lutté pour la mise en place d'autres valeurs telles que le droit à la contraception, le droit de vote, le droit d'accès aux études. Toutes ces luttes sont évoquées par les deux femmes interrogées.
Afin de parvenir à ces changements, il a fallu se réunir entre femmes. A partir du moment où nous souhaitons un changement important, il est nécessaire d'obtenir une mobilisation importante. Rina Nissim part d'un petit groupe, le MLF qui finalement va prendre une grande ampleur et Amélia Christianat s'impose dans la politique. Pour ces deux protagonistes, il paraît évident que pour espérer un changement, il faille se réunir en groupe. La notion de communauté prend donc toute son importance. La notion de communauté est définie comme étant un état de ce qui est commun à plusieurs personnes, similitudes, groupe constituant une société, mise en commun des biens entre époux. Au sens étymologique originel : cum munus. La communauté est donc un groupe de personnes (cum) qui partagent quelque chose ("munus")- un bien, une ressource, ou bien au contraire une obligation, une dette.
Même si le concept de communauté n'est pas cité explicitement dans nos entretiens, il apparaît tout au long, puisque chacune d'entre elles a rejoint un groupe dans lequel elle trouvait des intérêts communs. Chaque membre décide alors en quoi, comment et quand il contribuera à ce groupe. Dans ce cas, Rina Nissim et Amalia Cristinat en tant que féministe se sont engagées et ont lutté pour le droit des femmes.
Enfin, il est intéressant de constater que nos deux intervenantes tirent un bilan mitigé de ces luttes pour les droits des femmes. Amalia Cristinat dit :" Alors en fait tout changement, toute progression que l’on peut interpréter comme sociale n’est jamais définitivement acquise. Donc en fait, il faut veiller continuellement, défendre continuellement où que vous soyez et avec qui que vous soyez." Quant à Rina Nissim, elle dit :"Malheureusement dans la société c’est comme ça, il faut tout le temps se battre. Ça c’est un point sur lequel on est en recul." On est en plein recul. Donc y a un ou deux pays qui ont avancé, pour l’instant y en a douze qui ont régressé. Donc cela ne va pas du tout cette affaire, on a une très mauvaise posture." Ainsi, la question des droits pour la personne n'est jamais complètement acquise. Il faut sans arrêt se battre pour continuer à faire valoir ses droits en tant que personne."
Il convient à présent de reprendre l'ensemble des questions posées et d'en ressortir les éléments importants :
- Depuis quand et avec qui vous vous êtes engagée dans la lutte pour les droits de la femme et quel était à ce moment votre statut (ou fonction)? Dans quel contexte s'est inséré cette démarche ?
Les deux personnes interrogées ont un parcours différent et leur action ne s'est pas faite au même niveau. Rina Nissim, après son interruption de grossesse à 19 ans, trouve un tract dans un local d'anarchiste. C'est un tract du MLF qui invite des femmes à rejoindre leur groupe. Elle est intéressée et entre alors au MLF. Elle est alors la plus jeune de la "bande". Il n'y avait pas de statut en tant que tel mais chacune apportait ses connaissances et son envie de se battre pour obtenir plus de droit pour la femme. Quant à Amélia Christinat, elle agit plutôt à un niveau politique et va faire un long parcours en passant par le législatif, le cantonal puis le niveau national afin d'apporter des changements reconnus dans toute la Suisse.
- Y a-t-il eu un événement originel? Pourriez vous nous raconter un ou des événements marquant que vous avez mené ou qui vous ont frappé dans cette période en faveur de ces droits ?
L'un des droits qui a frappé Rina Nissim dans cette période est l'accès à l'avortement libre et gratuit ainsi que l'accès à la contraception. Elle explique que c'est l’accessibilité à l'avortement qui était problématique. Le planning familial a été une grande innovation, mais n'était pas encore présent dans les mentalités de tous, et ce, notamment chez les gynécologues qui n'acceptaient pas tous de donner la pilule. Le MLF faisait des listes des médecins qui étaient d'accord de prescrire cette pilule et dirigeaient les femmes au bon endroit. Cependant, elle ne nous décrit pas un événement très précis, une action qu'elle a effectuée qui a pu entraîner ces changements. C'est néanmoins des manifestations importantes et à plusieurs reprises qui ont permis ces évolutions. Amélia Christinat considère aussi que le droit à l'avortement est un événement phare de cette époque et ajoute que le droit de vote pour la femme est aussi l'un des événements marquants. Elle donne comme exemple les luttes ouvrières françaises qui allaient en Belgique pour se faire avorter parce que c'était défendu en France et qu'elles n'avaient pas d'argent. C'est un événement particulièrement marquant et touchant selon elle.
- Quels ont été les changements les plus importants auxquels vous ayez assistés ?
Rina Nissim évoque plusieurs changements auxquels elle a pu assister. Elle parle de la libération des femmes. C'est se considérer comme un individu à part entière, qui peut décider soi-même, d'être un vrai sujet dans leur vie, dans leur sexualité, dans leur contraception, dans leur choix professionnel. D'après elle, il y a donc eu plusieurs droits : celui de l'avortement avec pour commencer le remboursement par les caisses maladies en 81, le droit au divorce, le divorce. Amélia Christinat ajoute à l'ensemble de ces changements le droit de vote, en disant qu'à partir du moment où nous avons le bulletin, c'est quelque chose de très important puisque les femmes sont considérées comme une personne. Nous pouvons rattacher cela à l'ensemble de cette étude qui étudie le droit des personnes. Dans le cas des différentes luttes pour le droit des femmes, nous cherchons à mettre en avant qu'elles sont avant tout des personnes qui doivent avoir la liberté de choisir, de donner leur avis.
- Y a-t-il eu des valeurs que vous avez eu le sentiment d’avoir porter en avant et si oui lesquels ?
Différentes idéologies sont mises en avant par les deux femmes interrogées. C'est le féminisme, l'humanisme, le socialisme, l'anarchisme. De manière générale, la valeur dominante est l'autonomie des femmes, marquée par la réappropriation de son corps. Dans leurs discours, les deux femmes montrent bien qu'auparavant nous étions considérées comme femme de.., fille de... que les femmes ont toujours dû être meilleures que les hommes. Elles devaient tout faire. De ce fait, les femmes n'étaient pas des sujets en tant que tels. Ce n'est qu'après de nombreuses luttes que les femmes ont été considérées comme des personnes à part entière. Elles ont maintenant le même statut, les mêmes droits que les hommes. Bien que comme elles le relèvent toutes deux, cela n'est pas quelque chose d'acquis et cette évolution à tendance à reculer.
Mais qu’en est-il aujourd’hui de cette lutte et des acquis, et des risques de retour en arrière ?
Le maître-mot de ces deux femmes est que rien n'est acquis et que la lutte est permanente. Il faut toujours se battre parce que les choses ont tendance à régresser. Aujourd'hui le droit de vote, le droit d'accès aux études est l'un des points acquis. Cependant, la question de l'avortement est remise en cause et fait l'objet de tensions, puisqu'il est question de supprimer le remboursement des avortements. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles il faut continuer à se battre et faire valoir ses droits si l'on ne veut pas revenir en arrière.
Conclusion
Dans ce chapitre, nous nous sommes focalisées sur les droits des femmes à l'avortement. En effet, nous avons vu que ce droit n' a été que difficilement acquis après une forte mobilisation des femmes, de la fin des années soixante jusqu'à la fin des années nonante. Les deux actrices que nous avons eu la chance de pouvoir interroger, nous ont communiqué leur passion et leur investissement dans cette lutte qui reste quotidienne. En effet, toutes deux nous ont précisé que le contexte économique engendrait une régression des droits qu'elles avaient acquis auparavant. La lutte, doit continuer avec les nouvelles générations, si elles ne veulent pas perdre leurs droits. Nous avons vu que les femmes se sont impliquées pour revendiquer l'égalité avec les hommes. C'est une lutte pour le droit à l'autodétermination mais aussi à l'intégrité physique qui a été le plus revendiquée à travers le droit à l'avortement. La liberté de pouvoir choisir sa maternité était donc l'un des éléments pointés par nos actrices. Dans le chapitre suivant, concernant le droit des prisonniers nous verrons que les associations se sont également mobilisées pour donner ces droits aux prisonniers. De plus, nous voyons dans le cursus de notre formation que les personnes en situation de handicap subissent également des inégalités fréquentes. En effet, nous sommes sensibilisées par le fait que toute personne a le droit de choisir ce qui la concerne ; c'est ce que l'on nomme l'autodétermination. Plus largement, l'autodétermination faisait également partie des revendications concernant les patients à l'hôpital (puisque nous verrons qu'ils ont lutté pour ne plus être des cobayes) et les patients psychiatriques (puisque nous verrons que leurs luttes portaient sur des alternatives aux médicaments et de laisser le choix aux patients psychiatriques).
Références bibliographiques
<references/>
Vidéo :
- Roussopoulos Carole, Debout ! Une histoire du mouvement des femmes 1970-80, 1999. Consulté le 19 Novembre 2013 sur http://ballonsonde.org/wikiSonde/videos/Femmes_Debout.htm
Documents scannés :
Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF femme.pdf
Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90Fichier:MLF archives.pdf
Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF assez.pdf
Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF avorter.pdf
Archives contestataires de Genève, Mouvements de Liberté des Femmes : 1970-90 Fichier:MLF personne.pdf
Auteurs du chapitre
- Julie Petot
- Harmony Godin
- Nedjma Tabani
- Tamara Cifo Parra
- Estefania Medina Martinez
- Ramos Flores Véronique
Historique
Durant l'Antiquité et le Moyen-Âge, les sanctions pénales consistaient principalement en un châtiment corporel. La liberté n'était pas encore considérée comme un bien appartenant à l'individu. Par conséquent, les prisons n'étaient pas utilisées comme mode de punition, mais, elles permettaient, par exemple, de s'assurer qu'un condamné serait présent le jour de son procès.
Jusqu'au 17ème siècle, cette mentalité n'évoluera pas. Au siècle des lumières, apparaît alors la conception de la liberté. Celle-ci se révèle être le bien le plus précieux dont peut disposer un individu. Rapidement, l'idée d'utiliser la prison comme mesure punitive - car privative de liberté - est proposée : les peines ne s'appliquent plus au corps, mais à une valeur constitutive de l'individu: la liberté.<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève</ref>
La réforme pénale initiée par le texte de Cesare Beccaria, Des délits et des peines, paru en 1764, dénonce le recours à la torture comme moyen d'instruction, la cruauté totalement disproportionnée des châtiments, tels que la peine capitale, l'inégalité de traitement des condamnés en fonction de leur classe sociale ou encore l'arbitraire des juges dans la décision des peines. Il préconise alors la mise en œuvre d'un système de peines fixes garantissant l'égalité entre les condamnés et empêchant ainsi toute appréciation des juges.
John Howard, philanthrope britannique, est l'un des premier à s'intéresser au statut juridique des prisonniers. Son livre sur "L'État des prisons européennes" (1777) souligne la nécessité d'un traitement carcéral respectant les droits élémentaires de l'humanité. À la fin du 18ème siècle, Jeremy Bentham va plus loin et défend la position que les détenus doivent avoir exactement les mêmes droits que les personnes en liberté mis à part celui d'aller et venir<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève</ref>.
Il faut attendre le 19 ème siècle pour que l'on donne un autre but aux peines. « Le détenu devrait être complétement transformé, tant dans son corps et ses habitudes que dans son esprit et sa volonté. La volonté d'améliorer le détenu durant sa détention ou l'idée d'une réinsertion possible dans la société transparaissent en filigrane » <ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève. Page 14</ref>. On passe à une pénalité de la détention. Michel Foucault analyse ce nouvel "art de punir" à travers ce qu'il appelle une micro-physique du pouvoir permettant une constante soumission de l'individu au regard des gardiens. La justice moderne va alors chercher à transmettre l'idée que l'essentiel n'est pas de punir, mais de redresser. Ce que l'on vise désormais, c'est la liberté de l'individu. Par exemple, avec l'introduction de la notion de "circonstances atténuantes", on fait entrer dans le verdict une appréciation portée sur le criminel et sur ce que l'on peut attendre de lui dans l'avenir. « Trouver pour un crime le châtiment qui convient, c'est trouver le désavantage dont l'idée soit telle qu'elle rende définitivement sans attrait l'idée d'un méfait »<ref>Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.</ref>.
Le 19ème siècle apporte son lot de réformes. Des mécanismes de réduction de peines apparaissent et surtout, la libération conditionnelle et le régime du sursis sont instaurés, respectivement en 1885 et 1891 en France.<ref>Favard, J. (1994). Les prisons. Flammarion : France.</ref>
Jusqu’en 1945, la condamnation à une peine de prison correspond encore à la perte des droits individuels, mais, après la Seconde Guerre Mondiale, une volonté d’humaniser les prisons apparait en même temps qu'une volonté de reconnaissance des droits des personnes détenues. Malgré ce mouvement, l’incarcération reste encore, à ce moment-là, assimilée à un châtiment.
Il faut alors attendre les années 1970 pour considérer que les détenus restent, malgré leur privation de liberté, des sujets détenteurs de droits.
Les années 1970 sont déterminantes dans le débat sur les droits des prisonniers
Comme nous l'explique le texte de l'ENA (l'école nationale d'administration), «Ce n’est qu’à partir des années 1970 qu’il est admis que la qualité de détenu n’exclut pas celle de sujet détenteur de droits, évolution résumée par la formule « la prison, c’est la privation d’aller et venir et rien d’autre » prononcée par le Président de la République Valéry Giscard d’Estaing. Des droits sont progressivement reconnus aux personnes détenues, les dotant d’un statut juridique qui reste cependant partiel car un écart perdure entre la capacité de jouissance et la capacité d’exercice des droits dont les détenus sont titulaires.»
En effet, en 1975, les détenus récupèrent leur droit de vote, en 1983, ils sont autorisés à porter des vêtements civils, en 1985, la télévision est autorisée dans les cellules et ainsi de suite. Ce processus de reconnaissance comme des sujets à part entière, détenteurs de droits perdure pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à la mise en place de la loi du 24 novembre 2009 qui introduit, entre autres, un chapitre consacré aux droits et devoirs des personnes détenues et s'inscrit ainsi dans l’amélioration de l’accès aux droits des personnes détenues et du développement des contrôles externes. De plus, cette loi opère "un renversement symbolique des missions qui sont assignées à l’administration pénitentiaire, la réinsertion du détenu étant énoncée avant l’exigence de sécurité".<ref>ENA. (2011). L'administration pénitentiaire et les droits des personnes détenues. Lettre de mission - Groupe 9. Page 7.</ref>
Droit à l’intégrité physique et morale
La prison a donc beaucoup changé au cours du temps et, avec cette évolution, l'ont été ses valeurs et les droits des prisonniers, à savoir: le droit à des conditions de vie appropriées, le droit à la santé mais également le droit à l'intégrité physique et morale. C'est d'ailleurs sur ce dernier point que nous avons choisi de développer dans le prolongement de l'intérêt pour l'évolution de la nature des sanctions et des peines dans l'histoire des prisons.
« Par le prononcé d'une peine privative de liberté à son égard, l'individu purgeant cette peine est privé de l'un de ses principaux attributs, il perd sa liberté. Le problème majeur réside dans le fait de savoir s'il s'agit d'une perte de liberté ou des libertés et dans quelle mesure cette privation est compatible avec les droits et libertés de l'individu. »<ref>Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève. Page 17.</ref>
Les individus qui sont détenus conservent tous leurs droits sauf ceux dont la perte est une conséquence directe de la privation des libertés. L’interdiction universelle des actes de torture et des mauvais traitements trouve sa source dans la dignité inhérente à la personne humaine. Les prisonniers et détenus doivent être traités en toute circonstance de façon humaine et digne et ce du jour de leur admission jusqu'au jour de leur libération. Ainsi tout acte de torture ou de traitement inhumain ou dégradant est interdit et impardonnable. L'interdiction de la torture a force de loi. Cette interdiction trouve sa source dans la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dont l'article 5 stipule que : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »<ref>Les droits de l'homme et les prisons. (2004). Manuel de formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel pénitentiaire. Série sur la formation professionnelle n°11. NATIONS UNIES, New York et Genève. Page 38.</ref>. Ainsi le paragraphe 1 de l’article premier de la Convention contre la torture et autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant définit la torture comme : « Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ».<ref>Les droits de l'homme et les prisons. (2004). Manuel de formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel pénitentiaire. Série sur la formation professionnelle n°11. NATIONS UNIES, New York et Genève. Page 38.</ref>
De même, lorsqu'une personne détenue ou emprisonnée disparaît ou décède, il faut que la cause de cette disparition ou de ce décès fasse l’objet d’une enquête indépendante. Le principe 34 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement prévoit que :
« Si une personne détenue ou emprisonnée vient à décéder ou à disparaître pendant la période de sa détention ou de son emprisonnement, une autorité judiciaire ou autre ordonnera une enquête sur les causes du décès ou de la disparition, soit de sa propre initiative, soit à la requête d’un membre de la famille de cette personne ou de toute personne qui a connaissance de l’affaire...»<ref>Les droits de l'homme et les prisons. (2004). Manuel de formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel pénitentiaire. Série sur la formation professionnelle n°11. NATIONS UNIES, New York et Genève. Page 41.</ref>
Prenons l’exemple des conditions de détention dans une prison genevoise : Champ-Dollon qui ouvre ses portes en 1977. Déjà au centre de l’actualité à cause de sa surpopulation, cette prison préventive de Genève a fait la une, en avril 2006, pour de toutes autres raisons. En effet, 200 détenus ont signé une lettre dénonçant l’emploi disproportionné de la force policière et des détentions préventives excédant les peines prononcées. Suite aux protestations de 2006, les rapports ont mis en évidence en évidence des violations des droits humains au sein de la prison (allégations de pratiques d’immersion de la tête sous l’eau) par la suite confirmées. Malgré cela, en 2007, toujours pas de réaction des autorités.<ref>Plateforme d'information humanrights.ch sous http://www.humanrights.ch/fr/Suisse/interieure/Poursuite/Detention/idart_4174-content.html</ref>
Pour la Ligue Suisse des Droits de l'Homme (LSDH), qui a présenté son rapport le 16 avril 2007, les droits fondamentaux des détenus ne sont pas respectés dans la prison genevoise de Champ-Dollon. De même, le rapport de la commission d'experts du Grand Conseil genevois, présenté le 18 avril 2007, a été très sévère envers les pratiques de la police et de la justice.<ref>Plateforme d'information humanrights.ch sous http://www.humanrights.ch/fr/Suisse/interieure/Poursuite/Detention/idart_4174-content.html</ref>
Les experts de la commission ont auditionné 125 détenus et ils ont eu accès aux données de la police judiciaire et de la justice. 30% des détenus auditionnés (soit 38 sur les 125) se sont plaints de mauvais traitements physiques et de propos racistes, voire de rançons; dans 14 des cas, des lésions ont été constatées par les médecins. Les brutalités ont consisté en coups de pieds à terre, tête frappée contre le mur, gifles, coups lors de l'interrogatoire, et un mineur a raconté avoir subit le sous-marin (tête dans l'eau).
Dû à la surpopulation, certaines conditions de détention deviennent inacceptables. Le rapport de la LSDH a confirmé certains problèmes, comme un accès restreint aux soins, aux parloirs, à la formation ou aux places de travail. Les experts ont confirmé la promiscuité, la mixité, le mélange de détenus (p.ex avec des détenus perturbés) et certaines restrictions.<ref>Plateforme d'information humanrights.ch sous http://www.humanrights.ch/fr/Suisse/interieure/Poursuite/Detention/idart_4174-content.html</ref>
Lors d'une conférence de presse le 3 mai 2007, les autorités ont exprimé leur inquiétude tout en relativisant les allégations. Le ministre genevois en charge de la police, Laurent Moutinot, a pointé le fait que les allégations de détenus n'avaient pas fait l'objet de vérification et que les policiers accusés n'avaient pas été entendus. Toutefois, les autorités ont présenté un plan de réformes de la police censé mettre un frein à ces dysfonctionnements. Le plan d'action comprenait l'amélioration de la formation des policier, la réunion en un seul corps de la gendarmerie et de la police de sécurité internationale, une nouvelle répartition des compétences, des caméras de surveillance (y compris dans les postes de police et les salles d'interrogatoires), la réforme des procédures disciplinaires et la création d'une police des polices intercantonale.<ref>Plateforme d'information humanrights.ch sous http://www.humanrights.ch/fr/Suisse/interieure/Poursuite/Detention/idart_4174-content.html</ref>
Bien qu'on puisse la croire disparue des prisons, la violence envers les détenus est toujours présente. Il est certain que c'est un point particulièrement important dans le respect du droits à l'intégrité physique et morale des détenus. Mais il y en a d'autres, en apparence moins importants, mais pour qui il est justifier de se battre. Lors des entretien effectués avec Mesdames Testuz et Bercher, apparaît l'importance des liens avec l'extérieur. En effet, pour Mme Bercher, le détenu n'existe que par ce qu'il entend de l'extérieur. Si l'on souhaite respecter le droit à l'intégrité morale, il faut donc mettre en place des moyens permettant cet accès. Un problème surgit immédiatement : la punition du détenu est justement celle d'être mis de côté, coupé du monde. Quel sens y aurait-il à le mettre en contact avec l'extérieur? Il faudrait ici aussi distinguer la prison préventive lors de laquelle les détenus en attente du procès ne peuvent être en lien avec l'extérieur pour des raisons de collusion de la prison de détention où il purge sa peine.
Nous pouvons avancer trois réponses à ceux qui soulèvent cette question. Dans un premier temps, en reprenant la citation en début de chapitre, nous appuyons le fait que la prison consiste en une perte d'un droit, celui d'aller et venir où bon nous semble, et non de tous les droits. Cela n'est donc pas incompatible avec la possibilité d'être en contact avec l'extérieur. Ensuite, il convient de définir le but de la prison. Si ce dernier est bien de permettre un jour la réintégration de ses détenus, alors les détenus doivent pouvoir se tenir au courant de se qu'il s'y passe. Enfin, tout simplement parce que les détenus ont droit à leur intégrité physique et morale et qu'en les coupant de leur famille, de l'information, des moyens de communication, on viole ce droit.
Finalement, les grands victoires de ces dernières années ne sont peut-être pas celles qui ont fait le plus de bruit. Pour nous, il est par exemple difficile d'imaginer l'importance d'avoir deux heures de parloir par semaine au lieu d'une. Mais pour les détenus c'est une victoire. En tant que militant pour les droits de détenus, il fallait se battre pour ces "petites choses" comme le dit Muriel Testuz: les parloirs intimes, le courrier, la télévision, internet, ... Car chacune d'elles permettaient d'améliorer l'intégrité physique et morale des détenus.
Institutions et associations défendant le droit des prisonniers
Le GAP
Le Groupe Action Prison : GAP
Ce groupe a été créé, en 1975 par Michel Glardon, à la suite de la mort de Patrick Moll. Il militait au travers d’un journal, nommé Passe-Murailles, qui publiait des dossiers sur des « thèmes brulants ». Ce groupe avait la volonté de créer une profonde modification de la détention préventive. Il a énormément lutté « pour briser l’isolement dans les prisons et pour défendre un vrai salaire pour les prisonniers, supprimer la censure, soutenir les luttes »<ref>-, - (Hrsg.). (2006). Luttes au pied de la lettre, Editions d’en bas, Lausanne. pp 12-129</ref> dans différentes prisons suisses telles que Witzwil ou encore Saint-Antoine devenue Champ-Dollon.
Depuis 1986, le groupe Action Prison a disparu et a laissé la place à d’autres associations qui luttent pour le respect des prisonniers. Notamment, l’Association de Défense des Prisonniers en Suisse qui a vu le jour en 1986 et qui souhaitait « soutenir les luttes des prisonniers au niveau national et dénoncer l’ensemble du système carcéral ».<ref>-, - (Hrsg.). (2006). Luttes au pied de la lettre, Editions d’en bas, Lausanne. pp 12-129</ref>
ADPS (Association de défense des prisonniers de Suisse)
Un syndicat de prisonniers, appelé l’Association de Défense des Prisonniers de Suisse, s’est crée en 1986 et prit, ainsi, le relais du Groupe Action Prison. Dans son live Yvonne Bercher. (1995)<ref>Yvonne Bercher. (1995). Au-delà des murs: témoignage et recherche sur l’univers carcéral suisse romand, éditions d'en bas, Lausanne. pp 45-48</ref> retrace son histoire. C'est le 1er août que Jacques Fasel, le fondateur, dépose la demande de création de l’ADPS à la conseillère fédérale Elisabeth Kopp. L’Office fédéral de la justice ne s’y est pas opposé concrètement, mais a transmis le message suivant : « Rien n’empêche en principe des détenus de fonder une association. Toutefois la direction de l’établissement peut soumettre l’activité de ladite association à des conditions, voire la restreindre. »
Cette association était essentiellement composée de détenus et ne comprenait que quelques rares membres non incarcérés, ceux-ci servant de relais avec l’extérieur.
L’ADPS a évolué du simple syndicat de prisonniers à un groupe actif hors de l’enceinte des prisons. C’était les membres extérieurs à la prison qui recevaient les demandes d’aide des détenus et qui essaient de les traiter, sans toutefois y arriver au vu des nombreuses sollicitations. L’ADPS est alors perçue par les détenus comme inefficace et se voit discréditée. Il s’en est suivi le départ de Jacques Fasel qui a préféré œuvrer en solitaire.
Groupement Infosprisons
Le Groupe Infoprisons est un groupe de travail qui s'est créé après la fin tragique de Skander Vogt qui est survenue en mars 2010, suite à l’incendie de sa cellule dans le canton de Vaud. Cet événement a déclenché plusieurs interrogations sur le monde des prisons et à ce qui pouvait être fait afin d’éviter que ce type d'événement dramatique ne se reproduise. Le groupe info prison a décidé d’élaborer et de diffuser un bulletin électronique trimestriel avec pour objectif de permettre la prise de parole des détenus et la mobilisation des professionnels impliqués dans le système carcéral.
Le groupe se compose, d'une part, de plusieurs personnes chargées de la responsabilité principale de la rédaction, à savoir: Marie Bonnard (ancienne journaliste à Tout-Va-Bien et à l'Hebdo), Patricia Lin (assistante sociale en milieu carcéral durant de nombreuses années), Anne-Catherine Menétrey-Savary (ex-conseillère nationale) et Muriel Testuz (active déjà dans le Groupe Action Prison). D'autre part, Joëlle Pascale Ulrich, chargée de la relecture des bulletins. Tous ces acteurs travaillent bénévolement pour la rédactions des divers textes ainsi que la recherche d'informations.
Afin de recevoir les bulletins électroniques, il suffit de s'inscrire sur le site-web du Groupe Info Prisons.
AAFIP (Association des Amis de la Fraternité Internationale des Prisons)
"Partout dans le monde les prisons sont un enfer. Aidez-nous à en faire des lieux de résurrection"<ref>Site de l'AAFIP sous http://www.aafip.ch/fr/</ref>
L'AAFIP est une association suisse qui a été créée en 2005. Elle agit auprès des détenus, anciens détenus, victimes, enfants et familles touchées par le crime dans de nombreux pays parmi les plus défavorisés.
L'un de leurs axes prioritaires est la justice réparatrice qui a été une vision minoritaire au XXème siècle, au profit d'une justice rétributive ou répressive, mais qui revient en force actuellement. Car c'est ce type de justice qui est porteur d'espoir pour une réelle réinsertion des détenus au sein de la société. En effet, le crime ne se réduit pas à la transgression de la loi, mais il affecte aussi les relations entre les individus. Ainsi, ce n'est pas le fait de simplement appliquer des peines aux coupables qui compensera la souffrance des victimes, et cela peut même conduire à un désir de vengeance chez le coupable. Concrètement, la justice réparatrice aide donc le coupable à réparer ou tenter de réparer le mal qu'il a fait dans la mesure du possible.
Il y a 124 associations à travers le monde et toutes ont les mêmes objectifs : elles s'impliquent dans la visite des détenus, la formation professionnelle en prison, l’accompagnement des victimes, des familles et enfants de prisonniers, la mise en place de programmes de réinsertion Chronologieprofessionnelle et la promotion du concept de justice réparatrice.
Chronologie
Chronologie sur les droits des prionniers en France
Méthodologie
Afin d'étayer les apports de notre article, nous avons décidé d'interviewer deux personnes qui ont milité pour le droit des prisonniers. Pour ce faire, nous avons décidé d'adopter une posture semi-directive dans nos entretiens de recherche. L'objectif de ces entretiens était de "favoriser la production d’un discours de l’interviewé sur un thème défini dans le cadre d’une recherche"<ref>Blanchet A., et Al (1985). L'entretien dans les sciences sociales. Bordas, Paris. Page 7.</ref>, dans ce cas-ci il s'est agit pour les deux interviewés de partager leurs souvenirs et expériences afin que nous puissions mieux comprendre la situation passée et actuelle concernant la prison. A partir de ces témoignages, nous avons essayé de mieux comprendre grâce à leur récit notre sujet et le thème du droit à l'intégrité physique et morale des détenus en Suisse.
Questions d'entretiens
L'idée proposée et partagée était de laisser la personne raconter, ainsi nous voulions laisser de l'espace et de la liberté aux personnes interviewées. Par conséquent, nous n'avons pas posé de questions fermées mais des questions ouvertes et générales choisie en commun par la communauté de travail. Lors des deux entretiens, nous avons accorder un long temps de réponse afin de laisser à Muriel Testuz et Yvonne Bercher la possibilité de se souvenir et de raconter l'histoire et leur histoire, notre but étant de véritablement comprendre comment s'est construite la lutte pour les droits des détenus en Suisse.
Concernant l'entretien de Mme Bercher, nous nous sommes confrontés à quelques difficultés méthodologiques puisqu'il ne nous a pas été possible de poser nos questions d'entretiens telles quelles. En effet, il était parfois difficile de la recadrer, bien que nous ayons essayer. Néanmoins, tout au long de l'entretien, elle nous a apporté quelques éléments de réponses pour nous permettre de compléter chacune de nos questions. Nous avons donc choisi de ne pas poser les questions telles que nous les avions rédigées afin de ne pas enlever de la spontanéité aux réponses apportées par Mme Bercher. De plus, ayant déjà envoyé les questions par courriel à cette ancienne militante, cette dernière nous avait déjà apporté des informations pertinentes pour chacune de nos questions. A ce propos, nous pensons qu'il a été bénéfique d'envoyer les questions par avance, car ceci nous a permis de laisser une plus grande place à la spontanéité de Mme Bercher, ce qui a enrichi encore davantage l'entretien.
Les questions d'entretien étaient les suivantes : questions
Présentations des personnes interviewées
Les deux personnes interviewées ont été Madame Muriel Testuz et Madame Yvonne Bercher.
Pour la présentation des personnes interviewées, voir l'index
Retour sur les entretiens
Entretien avec Muriel Testuz -- Transcription
Entretien avec Yvonne Bercher -- Transcription
Mise en relation des deux entretiens
Depuis quand et avec qui (quel groupe) vous êtes-vous engagé/e dans la lutte pour les droits de la personne et quel était à ce moment votre statut (ou fonction)? Dans quel contexte s'est inséré cette démarche ?
Mme Testuz a initié son engagement en 1976 avec le Groupe Action Prison. Elle avait alors un statut «d'étudiante en rupture», pour reprendre ses propres mots, et était âgée de 19 ans. Elle parle aussi de Michel Glardon, « le fondateur des Editions d’En bas et qui va être le fer de lance du mouvement sur les prisons, l’intellectuel, le Foucault d’ici » avec qui elle va s'engager dans le combat pour le droit des prisonniers.
Concernant Mme Bercher, elle a répondu à cette première question dans le mail qu'elle nous avait envoyé : « De 1987 à 1991, j’ai milité à l’ADPS (Association de Défense des Prisonniers de Suisse), syndicat de détenus engagés dans la défense de leurs droits auxquels s’étaient adjoints des personnes sensibles à la question (médecins, juristes, proches de détenus). L’ADPS représentait l’héritier du GAP (Groupe Action Prison), groupe militant présidé par feu Michel Glardon, ancien président de la LDDH VD et fondateur des Editions d’En-Bas où ont été publiés Droit de révolte, de Jacques Fasel et Au-delà des murs d’Yvonne Bercher. Ces éditions critiques représentent un peu l’équivalent suisse des Editions Maspero en France.»
La période est similaire pour les deux femmes et on remarque aussi la présence des mêmes personnes, notamment Michel Glardon. Nous précisons ici que, bien qu'elles aient milités durant la même période et pour le même combat, elles ne se sont jamais rencontrées. Néanmoins, elles se connaissent de nom.
Il y a-t-il un événement originel? Pourriez vous nous raconter un ou des événement/s marquant/s que vous avez mené ou qui vous ont frappé dans cette période en faveur de ces droits ?
Les motivations de nos deux interlocutrices ont plusieurs points communs. Aussi bien Mme Bercher que Mme Testuz ont ressenti un sentiment d'injustice liée à la population carcérale qui les a poussé à se battre. On sent une colère, voire une honte, vis-à-vis du système et un besoin intarissable de militer pour le respect des personnes. Bien qu'elles énoncent différents éléments qui les ont poussés à se lancer dans le combat, on sent que c'est quelque chose qu'elles avaient en elles. Mme Bercher le dit :"vous savez le fait d’être militante, c’est quelque chose qu’on a ou qu’on a pas en soi, mais ce n’est pas un sacrifice".
Elles se rejoignent aussi lorsqu'elles évoquent leur entrée dans les associations militantes : "c'est par le bouche à oreilles, par certaines rencontres, fortuites ou non, qu'elles ont pu s'investir. Il existait un flou autour des acteurs du combat pour les droits des prisonniers." Daniel m’a présenté d’autres personnes qui m’en ont présentées d’autres ça été un jeu de l’avion si vous voulez..." (Mme Bercher). Mme Testuz, quant à elle, précise : "[...] qu'on n’entrait pas dans cette association action prison, d’autant plus qu’il se passait la même chose en France. Ce sont des gens qui se rencontraient et il y a eu à un moment donné une convergence."
Comme événement originel, Mme Testuz parle de l'affaire Skander Vogt et Mme Bercher parle de sa lecture du livre La bande à Fasel.
Quels ont été les changements les plus importantes auxquels vous avez assistés?
Mme Testuz, parle de sa victoire lors de la fermeture de la maison d'éducation de Vennes en 1979. Elle parle aussi de sa déception lorsqu'elle a appris sa réouverture au printemps prochain. Ainsi, elle identifie le retour en arrière que nous évoquons plus loin et qui est, sans doute, l'un des gros changements des ces dernières années.
Quant à Mme Bercher, elle nomme deux changements principaux: « L’irruption d’une population étrangère aux références culturelles complètement différentes des nôtres, ainsi que l’accroissement fulgurant de la population pénale représentent les deux éléments prégnants ». Ces deux points sont, eux aussi, de grands difficultés rencontrées aujourd'hui et qui mettent à mal le combat pour les droits des prisonniers.
Y a-t-il des valeurs que vous avez eu le sentiments d'avoir porté en avant et si oui, lesquelles étaient-elle?
Il n'a pas été facile à nos interlocutrices de répondre à cette question. Mme Testuz a proposé « Le respect des personnes. Il faut les considérer comme des personnes, car c’est quand même de la disqualification, ça, je ne peux pas, tout ce qui est l’humiliation, qu’on considère qu’il y a des gens qui ont moins de valeur, je ne peux pas ». Concernant Mme Bercher, elle a identifié « la transparence car nous nous sommes systématiquement appliqués à démontrer la fausseté du discours sur la réinsertion, notamment, ainsi que le fossé que l’on observe entre le faire et le dire. Débusquer les très nombreuses zones de non-droit a représenté un travail de titan (par exemple pourquoi les plaintes déposées par des détenus contre des brutalités n’aboutissent pratiquement jamais.)»
Qu'en est-il aujourd'hui de cette lutte et des acquis et des risques de retour en arrière? Sur quoi faudrait-il continuer de se battre de lutter? Est-ce que vous continuer aujourd'hui de vous engager et sur quoi?
Il ressort des ces deux entretiens que le monde de la prison, durant les années où Mme Bercher et Mme Testuz ont oeuvré, n’était pas le même qu'aujourd hui. En effet, Mme Testuz évoque le fait que : " Pour les moments de lutte, il y a des pics et après ça redescend. Faut réussir à maintenir. On voulait supprimer la prison à Genève. Aujourd’hui, on ne sait toujours pas quoi faire."
Elles parlent aussi d'un retour en arrière. Comme nous l'explique Mme Testuz avec l'exemple de la maison d'éducation de Vennes. Cette maison avait été fermée suite à une lutte acharnée du Groupe Action Prison et qui va réouvrir au printemps 2014. Ce retour en arrière est surtout dû selon Madame Testuz au fait qu': " Il n'y a pas de mémoire. Aujourd hui on ne pense que par le contrôle." En effet, nous pouvons voir qu'il n'y a plus de réflexion autour de ce sujet. C'est un milieu qui n'a pas évolué depuis plusieurs des années, alors que la société, elle se voit évoluer de manière fulgurante.
A cette perte de mémoire, nous pouvons lier le rôle de la presse qui a énormément évolué. Dans les années 1975-1985, il y avait une revue intitulée "Passe-Murailles" qui permettait de mettre en lumière ce qui se passait à l'intérieur des prisons, mais maintenant plus personne ne le fait réellement. Cette perte de mémoire peut être reliée aux changements de la société dans laquelle nous vivons. La "société permet moins les gens en marge. On nous met dans une case dès qu'on sort de la norme."
Ce sont principalement ces deux aspects qui ont été évoqués lors des entretiens.
Ci-dessous, sont listées d'autres thématiques que nous avons trouvé intéressantes
Objectifs du travail militant
Mme Bercher et Mme Testuz s'accordent sur le fait que leur travail consistait à rendre visible les prisons et à faire le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Mme Bercher, insiste plus sur ce qu'elle amenait de l'extérieur pour les prisonniers :"Le détenu, il existe qu’à travers ce qu’il va capter de l’extérieur, il en est complètement dépendant, il est dans un espace où il n’a plus de recul, où il est aux mains d’autrui. C’est un endroit très sonore la prison, vous avez tout le temps des bruits. Il faut comprendre ce que vivent les gens". Concernant Mme Testuz, c'est le mouvement inverse. Avec la revue "Passe-Murailles", elle tentait de transmettre au monde extérieur ce qu'il se passait à l'intérieur même des prisons.
Le but de leur travail était bien d'empêcher la prison de se renfermer sur elle-même. D'empêcher que le monde extérieur n'ait plus aucun regard sur ce qu'il s'y déroulait et d'empêcher les détenus de se sentir totalement abandonnés et évincés de la société. Elles se battaient pour que la prison et les prisonniers continuent à faire partie de la société, comme toute autre institution.
Enfin, leurs actions se devaient, non seulement, d'avoir un impact sur l'époque où elles prenaient place mais aussi, elles visaient à s'inscrire dans les mémoires afin que le combat ne soit pas fait en vain. Nous revenons sur ce point un peu plus loin.
Difficultés rencontrées
Parmi les difficultés rencontrées, mise à part les difficultés liées au militantisme - le fait de se heurter à des institutions qui refusent toute discussion, par exemple -, nous avons retenu celle liée directement aux prisonniers et à ce qu'il représente. Est-ce réellement une cause justifiable que celle de se battre pour des détenus? On peut imaginer les incompréhensions que cela peut générer pour l'entourage proche d'une personne militante mais aussi aux yeux de toute autre personne de la société. Mme Bercher répond parfaitement à cette problématique:"L’idée du peuple est qu’ils doivent être punis, c’est des salauds, donc il faut leur enlever des droits. Ce qui est une absence de réflexion, une vision à court terme. Tôt ou tard, ces gens vont sortir, en principe, et ils vont être appelés à se réinsérer et s’ils sortent dix fois plus révoltés qu’ils ne sont entrés, c’est dix fois plus nuisible. Personne n’a rien à gagner. Et moi, combien de fois j’ai fais signer des pétitions et les gens me disaient mais vous y pensez aux victimes? Et je leur répondais, mais justement Monsieur nous y pensons. Tout le monde a intérêt que ces gens soient pris en charge d’une manière ou d’une autre".
Réflexions sur la prison
La prison est un sujet délicat à traiter car il touche à des personnes qui sont enfermées dans des conditions pouvant se révéler très difficiles.
Lors de notre entretien avec Muriel Testuz, il est ressorti que pour elle :"Ce n’est pas un statut d’être détenu, c’est un statut administratif, mais ce n’est pas une identité contrairement à d’autres groupes sociaux victimes d’exclusions." Ceci nous amenant à nous poser la question du réel but de la prison.
En effet, il existe un paradoxe autour de la prison. Ceci vient du fait qu'il y ait d'un côté le souhait des gouvernements de réinsérer les prisonniers à leur sortie de prison (dans les dires) alors que rien n'est véritablement mis en place au sein des institutions carcérales pour leur permettre de se réinsérer (pas de formation). Ce paradoxe est parfaitement illustré dans le film Thorberg. Nous pouvons y voir l'un des détenus de la prison de Thorberg, Janis, qui dénonce "l'absurdité de la prison" en expliquant que cette dernière limite les possibilités des prisonniers tout en espérant qu'ils deviennent meilleures et se réinsèrent correctement dans la société.
Madame Testuz étaye ses propos en ajoutant : "On ne peut pas faire d’institutions coercitives sans qu’elles dégagent de la violence, de manière visible ou de manière beaucoup plus subtile, c’est propre à la prison. Tant qu’on n’aura pas une direction qui a une vision des détenus comme des personnes ayants le droit au respect".
Lors de l'entretien avec Yvonne Bercher, cette notion a elle aussi été mise en lumière. Elle nous a expliqué que : "Ce à quoi il faut être attentif, c’est que le discours et la pratique ne sont pas séparés par un fossé car on a une hypocrisie et un mensonge là-dedans. Si on dit, on est dans un état répressif ça fonctionne comme ça et qu’on l’annonce aux gens au moins ce n’est peut-être pas sympa mais ça a le mérite de l’honnêteté. Mais là, on a un discours suave dans les demies teintes à la Suisse et on a une pratique où on laisse moisir les gens pendant des années. On a toute une zone grise, si vous voulez, contre laquelle on luttait."
Nous en retirons le fait suivant : On espère qu'ils deviennent meilleurs sans leur en donner les moyens.
Conclusion
La prison fait aujourd’hui partie du paysage politique et médiatique et ce depuis plusieurs années. Nous avons pu constater à travers ce travail que de nombreux livres, brochures, rapports et autres textes tentent de dénoncer l’état du système carcéral. Cependant, nous avons pu remarquer qu’à ce jour, la véritable connaissance sur la prison par la population reste limitée et révèle une vision critique, libérale et intéressée. L’opinion publique reste très éloignée des problèmes pénitentiaires réels et prône la tolérance zéro quant à la nature des peines et à leurs modes d’exécution et d’aménagement. À travers les différentes étapes de la création de cet article, nous avons aussi pu voir que le droit des prisonniers n’était pas une cause facile à défendre. L’importance de cette lutte n’est pas encore très démocratisée et comprise par l’ensemble de la population. Ainsi, la prison demeure encore un lieu où l’on considère les êtres humains comme des individus morcelés et éclatés. Les détenus se sentent très souvent abandonnés et évincés de la société. Ils ont donc beaucoup de mal à exister comme des personnes à part entière. En effet, nous nous arrêtons souvent au crime commis et avons tendance à les stigmatiser, leur coller des étiquettes. L’humiliation et le non respect de la dignité sont toujours très présents en prison. De ce fait, nous pouvons alors nous demander quelle est la véritable place pour le droit de l'être humain dans un contexte déjà très difficile à vivre à la base.
En outre, au lendemain du procès de l'affaire Skander Vogt, nous pouvons constater que la peine attribuée est assez "légère". En effet, le tribunal a finalement condamné un seul des neuf prévenus. Il a retenu l'infraction de tentative d'exposition pour mise en danger de la vie uniquement contre le gardien sous-chef, qui a été condamné à 60 jours amende à 50 francs avec un sursis de deux ans. Aussi, nous pouvons remarquer que depuis la mort du jeune homme, certaines mesures de sécurité ont été prises dans les prisons cantonales depuis trois ans comme par exemple l'augmentation des effectifs, l'engagement de responsables-sécurité, du nouveau matériel d'intervention et de nouveaux équipements de ventilation. Nous constatons que le renforcement des mesures de sécurité répondent à des exigences et à des normes. Cela ne concernent pas directement le droit d'expression des détenus qui est bafoué et non respecté. Effectivement, de tels actes sont souvent commis par les prisonniers afin de se faire entendre ou d'exprimer et manifester un mécontentement. C'est pourquoi, nous pouvons encore constater aujourd'hui de nombreux incendies réguliers dans les cellules. Ce genre d'actions représente, parfois, l'unique moyen de questionner la société sur la façon de résoudre les graves problèmes rencontrés en prison par les autorités et les chef des milieux carcéraux.
« Mon désir n'est pas de créer l'ordre, mais le désordre au contraire au sein d'un ordre absurde, ni d'apporter la liberté, mais simplement de rendre la prison visible » Paul Claudel
Notre conclusion nous amène à réfléchir sur l'avenir : que faut-il faire maintenant pour améliorer le respect des droits des détenus? Les différents textes que nous avons avons lu ainsi que nos deux entretiens se rejoignent tous sur un point : il faut rendre la prison visible. Comment agir pour les détenus si personne ne sait exactement comment ils sont traités? Foucault, au travers de ses réflexions sur le système carcéral, parle de ce changement : « Le passage des supplices, avec leurs rituels éclatants, leur art art mêlé de la cérémonie de la souffrance, à des peines de prisons enfouies dans des architectures massives et gardées par le secret des administrations, n'est pas le passage à une pénalité indifférenciée, abstraite et confuse; c'est le passage d'un art de punir à un autre, non moins savant que lui. Mutation technique. De ce passage, un symptôme et un résumé : le remplacement, en 1837, de la chaîne des forçats par la voiture cellulaire. »<ref>Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard. Page 300</ref>. On est passé d'un régime de peines publiques, visibles et comme faisant partie intégrante de la société, à une logique du silence, de l'inconnu. La prison s'éloigne de plus en plus de la société. Muriel Testuz va aussi dans ce sens lorsqu'elle préconise qu'il faut continuer à lutter « pour que la prison ne se renferme pas sur elle-même ».
Philippe Combessie, dans son livre<ref>Combessie, P. (2001). Sociologie de la prison. Editions La Découverte & Syros, Paris : 2001.</ref>, en parle lui aussi. Il énonce même deux pistes d'actions afin de rendre la prison visible. Dans un premier temps, il faut diminuer le plus possible le recours à la prison afin de limiter ses dégâts collatéraux. Il faut en faire usage uniquement lorsque c'est indispensable à la sécurité publique. Ensuite, il faut diminuer la pénibilité de la prison.« Tout ce qui abaisse la dignité d'un homme rejaillit sur les individus qui y coopèrent, sur l'institution qui le tolère, et sur la société qui l'accepte et qui, pour ce faire, l'occulte. » (p. 109)
Mais le questionnement qui demeure est : avons-nous réellement envie de rendre la prison visible? Dans une démocratie, il revient au peuple de faire des choix quant aux droits et devoirs des citoyens qui la composent. Sommes-nous alors prêts à assumer notre responsabilité dans le traitement des personnes déviantes ? Ou préférons-nous occulter cette zone d'ombre de la société et l'enterrer au plus profond de nos esprits ?
Notes et références
<references/>
Bibliographie
- Bercher, Yvonne. (1995). Au-delà des murs: témoignage et recherche sur l’univers carcéral suisse romand, éditions d'en bas, Lausanne.
- Blanchet A., et Al (1985). L'entretien dans les sciences sociales. Bordas, Paris.
- Les droits de l'homme et les prisons. (2004). Manuel de formation aux droits de l'homme à l'intention du personnel pénitentiaire. Série sur la formation professionnelle n°11. NATIONS UNIES, New York et Genève.
- Emine Eylem Aksoy Rétornaz. (2011). La sauvegarde des droits de l'Homme dans l'exécution de la peine privative de liberté, notamment en Suisse et en Turquie. Schulthess Médias, Juridiques SA : Genève.
- ENA. (2011). L'administration pénitentiaire et les droits des personnes détenues. Lettre de mission - Groupe 9.
- Favard, J. (1994). Les prisons. Flammarion : France.
- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.
- -, - (Hrsg.). (2006). Luttes au pied de la lettre, Editions d’en bas, Lausanne.
Filmographie
Thorberg, DVD 1: Kinofilm, 104 Min., Untertitel: d/f/e/i, Trailer 2 Min., Untertitel d/f/e DVD 2: 18 filmische Kurzporträts über Insass en aus 12 Nationen, je ca. 8 Min. Untertitel d/f
Auteurs de ce chapitre
Daubord Alix
Grosjean Elodie
Martins Pinto Diana
Messina Stéphanie
Toninato Sebastien
Introduction
Cet article s’inscrit dans le cadre général des droits de la personne et des droits des patient en psychiatrie en particulier. Il s'agit dans ce chapitre de mieux comprendre comment les revendications des droits des patients psychiatriques relèvent des droits de la personne et d'arriver à expliquer ce que cela recouvre concrètement dans le quotidien en termes de pratiques, mais aussi de désignation.
Le paysage psychiatrique, au fil des années, a été modifié par l’influence et l’interaction de différents mouvements sociaux et des changements de lois. Cette recherche est une opportunité qui nous permet d’élaborer une réflexion autour de ces interactions et de mieux comprendre l’évolution de la terminologie et l’utilisation des divers moyens thérapeutiques, la mise en place d’un cadre légal préservant les droits des patients psychiatriques et les apports amenés à la société. Il semble que la critique des classifications nosographiques (les DSM) qui existe depuis les années 20 – lesquelles classifications n'ont été qu'en augmentation (en 1990, 400 classifications) ont visé à la fois le pouvoir qui désigne, mais aussi peut-être plus fondamentalement une manière de "donner sens" à un individu porteur de signes définis essentiellement par les médecins psychiatres. L'alternative serait de considérer la personne, sa parole, sa propre perception, sa conception aussi de la santé (et donc de la folie) dans une remise en question de la relation soignant-soigné. C'est aussi évidemment une remise en question de rapport norme/déviance, mais aussi plus fondamentalement de cette réalité "faussement" ou "artificiellement" construite (symboliquement) par ceux qui détiennent le pouvoir de nommer. Ainsi la critique sociale et politique des année 60-80 se double d'une critique de l'épistémologie du sujet pour mettre à la place une relation plus égalitaire et un respect de la personne.
Nous avons commencé par une brève présentation sur la maladie mental et le courant de l’antipsychiatrie, présentation qui nous aide à nous faire une image de ce que représentait pour la société une personne qui manifestait une maladie mentale, un hôpital psychiatrique et surtout ce qui voulait dire pour une personne d'être quelqu’un avec un trouble psychique au début du XXème siècle. La deuxième partie de l’article nous amène dans "la réalité des patients psychiatriques" contemporaine et nous découvrons les changements des lois et des droits pour ces patients. Pour pointer notre recherche, nous avons effectué un entretien avec M. Alain Riesen, militant de l’antipsychiatrie à Genève, entretien qui nous a permis de voir plus en détail et plus concrètement l’évolution des droits des patients en psychiatrie. Peut-être que cette évolution continuera dans ce vaste domaine, mais il faut souligner le fait que jusqu’au maintenant toutes les personnes qui présentent des troubles psychiques ont le droit aux meilleurs services médicaux et qu'aucune discrimination n’est admise, donc la santé est un segment d’insertion sociale qui place le patient dans la dimension d'être un citoyen.
Historique
Historique de la maladie mentale
Toute société se trouve confronté à des personnes qui sortent du fonctionnement ordinaire, qui ne vivent pas selon les normes en vigueur, allant jusqu'à perturber l’équilibre d'un groupe social (famille, classe, atelier, entreprise, institution, etc.).
En traversant les âges et les cultures, la maladie mentale a connu les définitions et les explications les plus variées. En effet, « puisque la folie plonge ses racines aux sources de la culture, être fous est différent selon le pays ou la région dont on est originaire » <ref> Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires,(p.13) </ref>.
En ce qui concerne l’Europe, Lesage De La Haye met en évidence comment à partir de l’Antiquité on s’est occupé du problème des personnes déviantes en les bannissant et en les excluant de la société. Durant le Moyen Âge, en particulier en France, l’exclusion de la société se faisait par exemple en mettant les personnes qui dérangeaient sur une barque et en les abandonnant sur une rivière. Au tour de l’année 1000, de l’exclusion et du bannissement en dehors des villes, il y a la mise en place d’un premier système d’enfermement. Dans les maladreries et les hostelleries (préludes des hôpitaux généraux), on commence à enfermer les malades mentaux avec tout sortes des personnes "marginales". La promiscuité, l'insalubrité, la surpopulation, ainsi que les maladies transformaient ces lieux en lieux d’extermination.
La religion avait une très grande influence durant toute cette période. La maladie mentale était interprétée comme la punition de Dieu en réponse à un péché. Le personne déviante était donc aussi enfermée pour protéger la société et pour qu’elle puisse faire amende honorable. Progressivement, mais surtout pendant le XIX, le pouvoir sur la maladie mentale passe entre les mains des médecins. En effet, ces derniers, écrit Lesage de la Haye « […] vont devenir les responsables du traitement des malades mentaux et mêmes les directeurs des asiles d’aliénés »<ref>Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires,(p.22)</ref>
L’intérêt pour les problèmes liés à la santé mentale surgit dans les années d’après-guerre à cause d’une forte augmentation des cas pris en charge. À partir des années 1970, sur la voie des protestations anticonformistes de Mai 1968 et sous l’influence et la pression des familles, on commence à dénoncer les conditions précaires des malades mentaux.
Mouvement de l'antipsychiatrie
Pendant les années 1960 apparaissait un nouveau courant qui a explosé dans plusieurs pays, l'Antipsychiatrie, qui prend le contre-pied de la psychiatrie. La critique vise à remettre en question non seulement la psychiatrie et la prise en charge des malades mentaux, mais aussi la société au sens large. Ce mouvement qui s'exprime sous différentes formes dans plusieurs pays, offre une nouvelle conception de la liberté aux patients psychiatriques en leur donnant la voix et le pouvoir de choisir leur parcours de soins, condamne la société capitaliste qui rejet tout individu non rentable et qui ne se conforme pas au règles de fonctionnement de la société. Les prisons et les hôpitaux psychiatriques sont l'expression de la mise à l'écart de toute personne qui affiche une différence trop importante face à la norme. Ce courant de pensé est très révolutionnaire et prône la liberté des individus.<ref>Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires</ref>
Selon, Lesage de la Haye, l'antipsychiatrie n'est pas un courant de pensée, c'est un vaste mouvement qui ne trouve pas une véritable unité concernant les théories et les pratiques des différents représentant.
Le terme «Antipsychiatrie» est utilisée pour la première fois par Cooper David Cooper en 1967 dans son ouvrage «Psychiatrie et antipsychiatrie»<ref>Cooper, D. (1970). Psychiatry et anti-Psychiatry. Paris: Edition du Seuil.</ref> et à travers ses expériences dans le "pavillon 21" à Kingsley Hall (Londres), il s'oppose au système hiérarchique et aliénant qui conduit à l’internement des personnes et en les rendant des malades chroniques. Ainsi, il propose d'étudier la personne dans son contexte de vie, en relativisant le diagnostic et l'étiquetage. Il est suivi par d’autres militants de ce courant idéologique, notamment par Aaron Esterson et Ronald David Laing. Tous les trois travaillent en Grande-Bretagne et offrent une réponse plus sociale et communautaire en s'opposant à la psychiatrie ordinaire, au diagnostic, à la pratique et à la politique en vigueur.<ref>Cooper, D. (1970). Psychiatry et anti-Psychiatry. Paris: Edition du Seuil</ref> Un exemple intéressant est le livre qui raconte le parcours d’une patiente, Mary Barnes, qui avait suivi une thérapie à Kingsley Hall avec le psychiatre Joseph Berke et sous la direction de Ronald David Laing. Le livre « Un voyage à travers la folie »<ref>Barnes, M.(1976). Un voyage à travers la folie. Paris: Editions du Seuil</ref>, écrit en 1976 par Mary Barnes avec la collaboration de Joseph Berke est un exemple du passage à travers la folie qui donne un point de vue différent: il valorise la personne et ses droits en tant que patient, l’importance de l'autodétermination personnelle et de l’intégration sociale. Le professionnel est vu comme témoin dans le parcours du patient. Il représente aussi un soutient au mouvement de l'antipsychiatrie.<ref>Barnes, M.(1976). Un voyage à travers la folie. Paris: Editions du Seuil. </ref>
Parallèlement, aux Etats-Unis, Erving Goffman publie en 1961 un ouvrage qui influencera aussi le courant de l'antipsychiatrie "Asiles, études sur la condition des malades mentales". L’auteur commence par donner une définition des « institutions totalitaires » qui se caractérisent par le niveau d’exclusion et de contrôle dans lequel se trouve le reclus. La vie dans de ce genre d’institution est décrite en négatif par comparaison avec le déroulement de la vie à l’extérieur. Une fois admis au sein de l'institution l'individu est mis sous tutelle et perd tous les droits dont il jouissait en tant que membre de la société et se trouve sous l'emprise du pouvoir du médecin <ref>Goffman, E. (1975). Stigmates. Les usages sociaux des handicaps. Paris: Les Editions de Minuit. </ref>. En 1963, avec son livre «Stigmate". Les usages sociaux des handicaps»<ref> Goffman, E. (1975). Stigmates. Les usages sociaux des handicaps. Paris: Les Editions de Minuit. </ref>, il continue à exprimer ses idées, selon lesquelles d'une manière indirecte, influenceront les droits de l’homme. Goffman donne une définition plus élargie du stigmate en mettant en évidence un ensemble des concepts sur «l'image social» des individus et ce qu'ils peuvent transmettre d'eux-mêmes aux autres en situations de confrontation.<ref>Goffman, E. (1975). Stigmates. Les usages sociaux des handicaps. Paris: Les Editions de Minuit. </ref> Aux Etats Unis, Thomas Szas, professeur en psychiatrie, ne préconisait pas les mêmes solutions. Szasz défend vivement les droits des malades mentaux et fait une double critique à la psychiatrie: la maladie mental n’est pas une vrais maladie, mais une justification légitimant, avec l’appui de médecins et des avocats, l’intervention du pouvoir pour protéger les gens contre eux mêmes. La psychiatrie est ainsi utilisée comme un outil de contrôle social à grande échelle, au nom du bien-être des « normaux ». Szasz décrit et dénonce dans son célèbre livre "Le mythe de la maladie mentale"<ref>Szasz, T. (1975). Le mythe de la maladie mentale. Paris: Payot.</ref>, paru en 1961, l’utilisation de la psychiatrie comme moyen du contrôle social, d'esclavage déguisé en thérapie.
En Italie, dans la même période, le mouvement trouve un autre représentant. Franco Basaglia, mène au niveau politique une lutte dans laquelle il revendique à haut voix les droits des patients ainsi que la fermeture des asiles (L'auteur de "L'institution en négation"<ref>Basaglia, F. (1970). L'institution en négation. Paris: Edition du Seuil. </ref>) - Basaglia critique l'enferment des malades mentaux comme n'étant pas une solution)<ref>Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires</ref>. Finalement la solution arrive en 1978, avec la Loi-180. La création de nombreux lieux alternatif, tels que de centres de jour, des foyer et d'autres formes innovatrices, ainsi qu'une participation nationale des syndicats, la partie communiste et le monde du travail, ont permis aux malades mentaux de réintégrer la vie en société.<ref> Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires </ref>. À noter, malgré ça, il y a des différences très importantes entre les régions les plus développées et d'autres régions italiennes. Cela a influencé la réintégration des patients psychiatriques.<ref>Basaglia, F. (1970). L'institution en négation. Paris: Edition du Seuil</ref><ref>Le sage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires</ref>
En ce qui concerne la France, plusieurs représentants ont pris parti au mouvement de l’antipsychiatrie. On y retrouve Roger Gentis, Félix Guattari, Robert Castel, ainsi que Michel Foucault.<ref>Le sage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires</ref>. Ce dernier, tout en étant en retrait par rapport aux autres praticiens, il offre dans son ouvrage « Histoire de la folie à l’âge classique », une représentation de comment la notion de folie, d’aliénation, de maladie mentale sont en relation très étroite avec le contexte. À travers une lecture historique de la folie, l’auteur met en évidence l’influence des normes, des valeurs et des croyances en rapport aux explications des causes de celle-ci. Le rôle social du « fou » dépend également de la vision que la société a sur la folie.<ref>Foucault, M. (1972/2013). Histoire de la folie à l’âge classique. Paris : Gallimard</ref>. Déjà en 1954, dans l'ouvrage « Maladie mentale et psychologie », Foucault met en évidence le fait que en Occident la folie a acquis le statut de maladie mentale très récemment, en devenant ainsi objet d’étude de la part de la psychiatrie. Les explications que l’on donnait auparavant à ce type de phénomène étaient du domaine de la magie et de la religion. Le contexte influence le regard que l’on pose sur une problématique.<ref>Foucault, M. (1954/2011). Maladie mentale et psychologie. Paris : PUF</ref>
Au niveau général, le mouvement essaye de se centrer dans l'application d'une thérapie dans le contexte du sujet (soit familial ou communautaire) et non pas dans le contexte clinique. Les trois thèses de l’antipsychiatrie (antinosographique, anti-institutionnelle, anti-thérapeutique) se manifestent comme une prise de conscience collective. La thèse antinosographique conteste l’appartenance des troubles psychiques au concept de maladie et la nécessité à n’importe quel type d’assistance psychiatrique et soutien que la classification des maladies mentales et le diagnostic donné constituent une forme d’étiqueter et de stigmatiser une personne. La thèse anti-thérapeutique est une réaction contre les mesures dures des traitements appliques aux malades psychiques (l’électrochoc, la médicamentation abusive et obligatoire, la privation de liberté) et encourage le traitement sans médicamentation, basé sur une communauté thérapeutique. La thèse anti-institutionnelle condamne les institutions en les nommant totalitaires car tout est enfermé, contrôle et obligatoire et propose de modifier la relation entre les psychiatres et les patients. Le mouvement de l’antipsychiatrie a contribué pour : la sensibilisation des autorités et l’opinion publique, le fait de non-être stigmatise pour les personnes avec de trouble psychique, l’influence et l’aide de mouvement pour les droits des patients, la reformation du système par l’introduction des lois qui ont comme but de protéger les droits et d’améliorer les conditions d’assistance psychiatrique.
Réalité des patients psychiatriques
Lois sur la psychiatrie
Le mouvement antipsychiatrique, comme mentionné au paravent, a été le premier à se battre pour la fermeture des asiles en s’opposant à la psychiatrie traditionnelle avec des idées, des interprétations de la maladie mentale et surtout des actions subversives. Au niveau législatif, cela s'est traduit par la Loi 180, qui a été la première et seule loi qui ordonne la fermeture des hôpitaux psychiatriques en Italie. Approuvé grâce au soutien de Franco Basaglia le 13 mai 1978 (elle est parfois appelée "loi Basaglia"), elle règle tous contrôles et traitements sanitaires volontaires et obligatoires pour des personnes avec une maladie mentale. Elle se base sur des principes tels que le respect de la dignité de la personne, des ses droits civils et politiques. Le droit de choisir librement son médecin et son lieu soin, ou encore le droit de communiquer avec qui ils désirent. Tous les traitements doivent être assurer par consensus et la participation de la personne. La "loi Basaglia" vise aussi à une "réforme sémiotique" des termes utilisés pour définir les patients psychiatriques. Elle supprime tout définition dans le code pénal comme "aliéné mental" ou "infirme mental". Il s’agit d’une loi qui agit sur plusieurs niveaux, que ça soit sur les droits de la personne, sur les institutions soignantes ou encore à niveau pénal. Elle représente une réforme sociale et politique.<ref>http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf</ref>
Droits des patients psychiatriques
Les droits des patients psychiatriques s'inscrivent dans les droits des patients en général, avec quelques différences qui est propre à cette population. Comme nous le verrons dans ce sous-chapitre, la nature de la maladie mentale peut impliquer des limitations au niveau juridique dans l’exercice de certains droits.
Les préoccupations concernant la protections des droits des patients psychiatriques est un fait relativement récent qui débute dans les années 1960 et qui prend plus d'ampleur dans les années 1970 au niveau national ainsi qu'international. Dans plusieurs pays on assiste à des modifications législatives, mais les questionnements concernant le traitement des maladies mentales s'opère aussi au niveau des droits internationales et de la liberté de la personne. <ref>Gendreau,C. (2005). Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d'une norme internationale. Montréal: Les Editions Thémis </ref>
En 1978, des personnes qui avaient connu l’expérience de l’institution psychiatrique s’adressent au réseau international d’alternative à la psychiatrie, qui avait organisé une rencontre à Genève, dans le but de créer un organisme capable de défendre les droits des usagers de la psychiatrie. Cette démarche s’inscrit dans un processus de médiatisation qui, depuis les années 1976-1977, avait porté au grand jour le fonctionnement du système psychiatrique genevois et les internements qualifiés comme abusifs.<ref>Desmonts, M. (1982). Torture psychiatrique à Genève. Lausanne : Editions d’en bas </ref>
C'est ainsi que, en 1979 à Genève, des personnes tels que médecins, psychiatres, psychologues, assistants sociaux, juristes et usagers de la psychiatrie fondent l’ADUPSY, l’association pour les droits des usagers de la psychiatrie. Une association dont le but est de lutter contre toutes discriminations en défendant les droits démocratiques fondamentaux des personnes psychiatriques.<ref>* http://www.rolfhimmelberger.ch/wp-content/uploads/2012/03/Adupsy-face-a-Revision-Loi-pers-atteintes-aff-mentales_1936_79.09.pdf</ref>
Face à la révision de la Loi sur le régime des personnes atteintes d’affections mentales du 1936, ils lancent des propositions qui viseront à combler les lacunes pratiques dont cette loi n’a pas su changer dans la pratique quotidienne de la prise en charge et de la reconnaissance de la personne psychiatrique. Comme par exemple recourir à l’internement lorsqu’il est réellement nécessaire, tandis qu’il s’agit encore d’une pratique naturelle, ordinaire à laquelle on recourt presque toujours, ou l’impossibilité du malade à faire recours lors de son internement ou au moment de la sortie, ou encore l’action faite par le Conseil de surveillance psychiatrique qui protège la société du malade mental en le stigmatisant encore plus ou lieu de protéger ce dernier. Ce sont tous des exemples de comment la loi ne s’est pas traduite en pratique selon ses principes.
L'Adupsy lance ses propositions en essayant de modifier la réalité psychiatrique. Elle revendique la suppression totales des internements visant une modification de toutes pratiques psychiatriques. Elle croit dans une nouvelle législation qui tiendrait en compte des modifications du Code Civile Suisse, des recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil d’Europe inhérent la situation des malades mentaux et des recommandations de l’OMS. Leurs propositions visent trois aspects principaux liés aux droits de la personne : l’admission, le droit de recours et les droits liés au traitement et à la participation à la recherche clinique.<ref>* http://www.rolfhimmelberger.ch/wp-content/uploads/2012/03/Adupsy-face-a-Revision-Loi-pers-atteintes-aff-mentales_1936_79.09.pdf</ref>
Il faut supprimer l’internement, l’admission doit être volontaire du début la fin du traitement, dans le sens que toute prise en charge ou action thérapeutique ne peut pas être efficace si le patient n’est pas d’accord. Le libre arbitre, le droit de choix ou de refus, une participation active sont des aspects nécessaires lors qu’on vise une prise en charge efficace, dans le respect de la personne.
Le droit de recours doit être une instance judiciaire. Dans ce sens là le Conseil de surveillance psychiatrique doit être remplacé par la Chambre de révision psychiatrique. La personne psychiatrique ne devrait plus être stigmatisée au tant que malade, elle n’est pas dangereuse et donc la société ne doit pas être protégée par ce dernier.<ref>* http://www.rolfhimmelberger.ch/wp-content/uploads/2012/03/Adupsy-face-a-Revision-Loi-pers-atteintes-aff-mentales_1936_79.09.pdf</ref>
Le troisième objectif concernant les droits liés au traitement et à la participation à la recherche médicale implique l’abolition de tout traitement médical sans le consensus du patient, il faut présenter au patient les implications du traitement, les alternatives et s’il veut il peut consulter un autre médecin de son choix. Ces trois aspects visent, comme écrit au paravent, une modification des conditions de prise en charge, des droits des patients en tant que personnes et du tout le système psychiatrique<ref>* http://www.rolfhimmelberger.ch/wp-content/uploads/2012/03/Adupsy-face-a-Revision-Loi-pers-atteintes-aff-mentales_1936_79.09.pdf</ref>.
La période comprise entre les années ’60 et ’80 est témoin d’une grand révolution vis à vis des droits des patients psychiatriques. Même si elle reste une révolution idéologique, car tous principes, toutes actions ne sont pas traduites en pratique pour l’instant, elle représente le précurseur pour un nouvelle réalité où on envisage une meilleure considération des droits de la personne au tant que tel et pas en tant que malade mentale, où on reconsidère la pratique psychiatrie à fin d’améliorer la prise en charge et les réponses aux besoins de ces personnes… À modifier, continuer….
La loi K 1 25 de 1979
Suite à deux cas d’internement qui avaient touché profondément l’opinion publique genevoise, ainsi que grâce aux mouvements militant pour une remise en question des traitements des patients psychiatriques, deux projet de révision ont été proposés au Grand Conseil concernant la loi du 14 mars 1936 sur le régime des personnes atteintes d’affection mentale. Selon la commission parlementaire la difficulté majeure est liée au fait qu’il faut renforcer les droits des malades mentaux tout en continuant de protéger le reste de la population de ces personnes. Un difficulté supplémentaire été due à la récente ratification (1974) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui interdisait toute forme d’internement administratif sans recours judiciaire. La loi du 1979 apporte des changements sur plusieurs niveaux. Tout d’abord l’application de la loi se limite aux personnes atteinte de maladie mentale dont l’état nécessite une prise en charge en hôpital psychiatrique. Avant la révision, la loi s’appliquait à toute personne atteinte de maladie mentale qui aurait pu compromettre la sécurité et la tranquillité publique, ainsi que leur propre sécurité. Deuxièmement elle impose aux établissements privé et publique un régime de surveillance des registres des entrées et de sorties. En outre cette loi renforce les droits des patients psychiatriques. Le patient acquiert l’accès à son dossier médical et ce dernier et sa famille doivent être informés de tous les droits dont ils disposent. De plus, la loi fixe les conditions d’admission des malades mentaux en faisant la distinction entre admission volontaire et involontaire. L’admission volontaire nécessite un certificat médical qui justifie l’admission du patient en raison de son état mentale. Etant donné que l’admission involontaire comporte une atteinte à la liberté de l’individu, elle peut être demandé seulement si ces trois conditions sont réunies :
- « Le malade présente des troubles mentaux
- Son état constitue un danger grave pour lui-même ou pour autrui
- Un traitement et des soins dans un établissement psychiatrique s’avèrent nécessaires. » (p.8)
Un examen ultérieur concernant les symptômes du malade, les motifs de l’hospitalisation et le dégrée d’urgence de la situation est nécessaire afin de confirmer ou annuler l’hospitalisation.<ref>Guillod, O., & Hänni, C. (2001). Les droits des personnes en psychiatrie. Les cahiers de l’action sociale et de la santé, 15</ref>
La capacité de discernement
Le discernement est définit dans l’article 16 du code civil et implique la capacité de pouvoir agir de façon raisonnable. On estime capable de discernement toute personne qui agit en connaissance de cause. Le code civil prévoit certaines situations dans lesquelles cette capacité peut être limitée dans l’intérêt de la personne concernée, notamment dans le cas de « maladie mentale » et de « faiblesse d’esprit ». La reconnaissance de cette capacité est la condition indispensable sans laquelle l’individu n’est pas en mesure d’exercer ses droits personnels. L’évaluation de la capacité de discernement se prête à controverse, notamment entre psychiatre et juriste, car il est impossible de poser un jugement objectif. Ceci est encore de nos jours source de malentendus et il semble très difficile qu’une réforme juridique puisse parvenir à éclaircir cette situation compliquée. Afin de limiter l’imposition d’une étiquette trop lourde, l’évaluation de la capacité de discernement s’opère toujours en relation à une situation précise. Une réévaluation s’impose donc face à toute nouvelle situation.<ref>Guillod, O., & Hänni, C. (2001). Les droits des personnes en psychiatrie. Les cahiers de l’action sociale et de la santé, 15</ref>
Privation de liberté à des fins d’assistance
En 1978, le Parlement fédéral a modifié le Code civil suisse en matière de privation de liberté à des fins d’assistance afin de rendre compatible le droit suisse avec la Convention européenne des droits de l’homme (ratifiée par la Suisse en 1974). Les causes permettant la privation de la liberté d’un individu prévues dans l’article 397a CC sont :
- La maladie mentale
- La faiblesse d’esprit
- La toxicomanie
- Le grave état d’abandon
Afin de limiter les abus, cette première condition doit s’accompagner de deux autres conditions. La privation de liberté est la seul solution possible afin d’assurer l’assistance nécessaire à la personne. Tous les autres possibles prises en charges (traitement ambulatoire, assistance de l’entourage,…) doivent être considérées comme des solutions inefficaces. En outre, la prise en charge doit être assurée par un établissement apte à fournir les prestations spécifiques dont l’individu a besoin.
Le droit fédéral impose des garanties minimales dans le but de protéger la personne privée de liberté à des fins d’assistance. Parmi les droit dont dispose l’individu on trouve :
- Le droit à l’information concernant le pourquoi de sa privation de liberté
- La demande de libération. Cette demande peut être également formulée par les proches.
- Le droit à l’assistance juridique
- Le droit d’être inétendue devant le juge
- … <ref>Guillod, O., & Hänni, C. (2001). Les droits des personnes en psychiatrie. Les cahiers de l’action sociale et de la santé, 15</ref>
La déclaration de Hawaï 1977
En 1977, L’association mondiale des psychiatres rédige une charte éthique concernant les pratiques, ainsi que les buts de la psychiatrie. Parmi les recommandations que l’on prône, on y trouve que le rapport entre le psychiatre et le patient doit être basé sur la confiance et le respect. Le psychiatre es au service du patient et ce dernier doit être considéré comme un partenaire. Le soignant doit privilégier les interventions thérapeutiques qui limitent le moins possibles la liberté du patient. Dans le cas d’incapacité de discernement, toute action thérapeutique doit être discuté avec la famille ou avec un représentant légal. Ce disposition vise le respect de la dignité humaine et les droits fondamentaux de l’homme.<ref>http://www.codex.vr.se/texts/hawaii.html</ref>
Méthodologie
Les méthodes d'entretien se distinguent par la mise en oeuvre des processus fondamentaux de communication et d'interaction humaine. Ces processus permettent au chercheur de retirer de ses entretien des informations et éléments de réflexion riches en nuances. Nous avons utilisé la variante entretien centré, avec une petite liste de questions-guides ouvertes afin que l'interviewé puisse parler ouvertement d'un événement ou d'une expérience précise à laquelle il a participé. En ce cas Alain Riesen, militant de l’antipsychiatrie à Genève.
L'entretien: la lutte contre les abus de la psychiatrie
Entretien avec M. Alain Riesen
Retour sur l'entretien
L’entretien avec M. Riesen nous a permis de prendre conscience de la réalité genevoise et internationale concernant les droits des usagers de la psychiatrie. Entre les année 1960-1980. En effet, il a participé en tant que militant à un moment de critique et changement très fort du fonctionnement de la prise en charge des patients psychiatriques. Ce changement s’inscrit dans un processus dynamique et globale de contestation des pouvoirs institutionnels qui a commencé avec mai 1968.
Son engagement débute après avoir terminé sa formation en ergothérapie, lors de ses stages à Belle-Idée il contribue à créer le CAS (Comité d’Action de Santé). Une année après il s’engage en psychiatrie institutionnelle et c’est là que la question qu’il s’interroge concernant les droits des usagers de la psychiatrie. Les conditions de vie des patients, l’internement non volontaire, la question de la sortie, les traitements imposés et la contention physique l’ont poussé à se questionner sur le fonctionnement de l’hôpital psychiatrique. En outre, la création du réseau d’alternative à la psychiatrie (dont M. Riesen faisait partie) permet la confrontation de plusieurs expériences provenant de différents pays. La variété des approches et des idées avait un point commun : la collaboration entre patients et professionnels de la psychiatrie visant une autre manière de pratiquer le soin. L’engagement plus spécifique dans la lutte pour les droits des patients se met en place lors des évènements concrets qui ont mis à la lumière l’ « arme psychiatrique » dans la ville de Genève, en particulier lors d’une tentative d’internement échouée d’une commerçante. Ces faits ont été très fortement médiatisés et l’opinion publique a commencé à s’intéresser à la problématique de la psychiatrie et le respect de la personne. Lors d’une dernière réunion du réseau d’alternative à la psychiatrie, sur demande d’un groupe de patients, on assiste à la création de l’ADUPSY. Cette association a été le fruit d’une alliance entre professionnels, avocats et patients et elle s’occupe de recueillir les demandes, les plaintes et les critiques des patients.
Suite à un nouveau drame, (la mort d’une patiente due à une cure de sommeils forcée), et sous le poids de l’opinion publique, des changements ont commencé à se produire à Genève : on commence à développer la sectorisation, on assiste à la naissance de groupes d’accompagnement et de soutien des patients psychiatriques, ainsi que de groupes autonomes de patients. Ce modifications ont été accompagné par des révisions au niveau juridique des droits des patients psychiatriques.
Au niveau des droits, M. Riesen met en évidence l’importance dominante de l’autodétermination de la personne, de la liberté, et de l’autonomie. L’idée sous-jacente a toujours été celle d’accompagner la personne dans un processus de vie qui puisse lui permettre de vivre aux mieux en améliorant constamment sa qualité de vie. M. Riesen nous fait remarque comme ces concepts d’autodétermination, d’autonomie et de liberté sont toujours à concevoir en interaction entre la personne, la société et le contexte.
En ce qui concerne la situation d’aujourd’hui, M. Riesen souligne que la lutte s’est un peu institutionnalisée et que le mouvement de contestation des formes traditionnelles de la psychiatrie est un peu diminué. Au niveau des régressions, on assiste à une stigmatisation, de la part des mouvements populistes et de l’extrême droite, des personnes qui sont handicapés psychiques et qui bénéficient de l’assistance. Le discours budgétaire se traduit aussi par rapport aux diminutions des subventions aux hôpitaux psychiatriques. De plus, au niveau de la population, il y moins de tolérance, moins d’acceptation des personnes ayant des troubles psychiques. Ceci est dû aussi à des évènements récents qui font resurgir le discours sécuritaire de protection de la population.
Conclusion et discussion
La période des années ’60-’80 constitue une époque de grands changements. Elle a été témoin d’une révolution idéologique, politiques, législative. Il s’agit principalement d’un mouvement général de contestation du pouvoir et des normes institutionnelles. Le mouvement de l’antipsychiatrie avant et du réseau d’alternative à la psychiatrie après, contribuent fortement à la lutte et aux débats contre l’institution totalitaire (Goffman), la violence institutionnelle. Spécifiquement au territoire de Genève, l’association de l’ADUPSY a contribué de façon important à tous ces changements. La cohésion entre les professionnels et les patients permet une action et une réflexion autour de la manière de pratiquer le soin, tout en considérant la question des droits des patients psychiatriques.
Avant les années ’60 les patients psychiatriques étaient, pour la plus parte, reclus, isolés, stigmatisés. La pratique du soin se faisait sous obligation, constriction où le pouvoir décisionnel était exclusivement dans les mains des médecins. Le patient n’avait aucune possibilité d’expression ou contestation, il subissait toute décision du corps médical, il était considéré comme une personne incurable, dangereuse, qui devait être hospitalisé à vie. Le patient vivait donc dans des conditions de vie précaires, où son identité était limité à une personne sans aucun droits.
Après les années ‘60 cette réalité voit un tournant important. Premièrement grâce au CAS, le Comité d’Action de Santé qui a mené une réflexion autour de la politique institutionnelle. Une politique de santé mentale se base sur l’institution, le dispositif institutionnel ; la théorie, la psychopathologie, dont dépend la manière de définir l’identité de la personne ; le corps des professionnels et la législation. Il y a eu une prise de conscience par rapport à la manière de considérer l’autre, on commence à se soucier des conditions de vie de ses personnes, on arrive à une nécessité de changer l’institution, de changer les lois, et les pratiques. Petit à petit on enlève les barreaux dans le dispositif institutionnel, on considère les professionnels comme des soignant et non plus comme des gardiens, progressivement on élimine les traitements de choc. Toute la question sur les droits des patients se révèle, la pratique du soin, la prise en charge des patients, la considération, reconnaissance de la personne voient une évolution importante. L’ADUPSY, l’Association pour les droits des usagers de la psychiatrie, contribue aussi à cette grande évolution, pendant plusieurs années elle a mené un travail pour accueillir les plaintes, les demandes ou encore les critiques des patients à fin de modifier la réalité qui les concernaient.
Les conquêtes, comme mentionné au paravent, ont étaient multiples. Néanmoins la question des droits des patients psychiatriques est toujours d’actualité. L’hospitalisation non volontaire et le type de traitement, liés au pouvoir médical ont encore une très forte influence dans la société de nos jours.
Notes et références
<references/>
Bibliographie / Webographie
- Barnes, M.(1976). Un voyage à travers la folie. Paris: Editions du Seuil.
- Basaglia, F. (1970). L'institution en négation. Paris: Edition du Seuil.
- Cooper, D. (1970). Psychiatry et anti-Psychiatry. Paris: Edition du Seuil.
- Desmonts, M. (1982). Torture psychiatrique à Genève. Lausanne : Editions d’en bas
- Foucault, M.(1964) Histoire de la folie à l'âge classique, Paris : U.G.E., coll. « 10/18 »
- Foucault, M. (1972/2013). Histoire de la folie à l’âge classique. Paris : Gallimard.
- Foucault, M. (1954/2011). Maladie mentale et psychologie. Paris : PUF
- Gendreau,C. (2005). Le droit du patient psychiatrique de consentir à un traitement : élaboration d'une norme internationale. Montréal: Les Editions Thémis
- Guillod, O., & Hänni, C. (2001). Les droits des personnes en psychiatrie. Les cahiers de l’action sociale et de la santé, 15'
- Goffman, E. (1975). Stigmates. Les usages sociaux des handicaps. Paris: Les Editions de Minuit.
- Szasz, T. (1975). Le mythe de la maladie mentale. Paris: Payot.
- Triunfo Digital (s.d.) Josep Berke: "La sociedad está enloqueciendo a sus miembros", Archives, Consulté le 8 Novembre 2013 "Triunfo Digital", p.1, p. 2, p.3, p.4
- Lesage De La Haye, J. (2010). La morte de l'asile. Histoire de l'antipsychiatrie. Paris: Editions Libertaires
- http://www.codex.vr.se/texts/hawaii.html
- http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_888_allegato.pdf
- http://www.rolfhimmelberger.ch/wp-content/uploads/2012/03/Adupsy-face-a-Revision-Loi-pers-atteintes-aff-mentales_1936_79.09.pdf
- http://www.jhberke.com/index2.html Site web du Dr. Joseph H. Berke.
- http://vimeo.com/38575546 Ici vous trouverez un entretien à Mary Barnes (langue anglaise).
Comment parle t-on des droits des personnes en situation de handicap, dans les années 1960-1980 à Genève?
Les décennies 1960 à 1980, à travers des mouvements de désinstitutionnalisation et d'anti-psychiatrie, ont vu l'émergence de droits fondamentaux: vote des femmes en Suisse en 1971, Convention des droits de l'enfant en 1989 notamment. Après les précurseurs revendiquant une éducation plus libre, plus juste, tel que Neill dont les "libres enfants de Summerhill" ont inspiré plus d'un pédagogue, se dessine une vague de revendications et de contestations des méthodes appliquées aux exclus du droit, ou aussi aux oppressés d'une société trop cadrante, sans marge de manoeuvre suffisante. Des auteurs imaginent ainsi "Une société sans école" (Illich, 1971), d'autres dénoncent "la condition sociale des malades mentaux" (Goffman, 1961), d'autres se battent pour désinstitutionnaliser, ou mettent "L'institution en négation" (Basaglia, 1970). Un mouvement prend forme, dans lequel s'inscrira progressivement les droits fondamentaux de la personne.
Il s'agit alors de combats pour les droits de ceux qui sont exclus, de ceux qui justement eux-mêmes ne sont pas en situation de se défendre ou de protester contre les injustices. Poussés ainsi par des valeurs humanistes, se lèvent alors les acteurs des droits de la personne en faveur des plus démunis. Le droit des personnes en situation de handicap représente ainsi le paroxysme des droits de la personne, et se trouve souvent être le parent pauvre et retardataire des combats. Alain Dupont, dont on verra plus avant le rôle pris dans ces années-là, confirme ce sentiment, en relevant que si les professionnels ne se portent pas garants de la défenses des droits de ses personnes, les personnes elles-mêmes n'ont pas les capacités de le faire. Par ailleurs, il souligne que dans les années 1960-1970, on ne parlait même pas de "personnes". On parlait de "handicapés", comme si, de par même le vocabulaire utilisé, on considérait ces personnes comme étant en dehors de la société, et donc en dehors du droit et du respect de la dignité qui en découle.
La loi sur l'AI (Assurance invalidité) de 1959, avec toutes les incidences consécutives à son introduction, marque un grand tournant dans la reconnaissance des droits pour les personnes en situation de handicap. Des parents d'enfants ou d'adultes en situation en handicap réclamant le droit à l'intégration (avec un paradoxe qu'est la création dans ces années-là d'institutions plutôt "ségrégatives") se constituent en association (APMH en 1959 devenu INSIEME). Ils se battent désormais pour faire reconnaître les droits (à l'éducation, à la santé, à la participation sociale) de leurs enfants. "Insieme suisse s'engage aujourd'hui à défendre, au niveau politique, les droits des personnes vivant avec un handicap mental et leur offrir les conditions d'une vie digne". Tels sont les mots que l'on peut lire sur le site http://insieme.ch/insieme/insieme-suisse/?lang=fr Il est intéressant d'aller plus loin dans la connaissance de cette association, afin de comprendre comment cette association s'est inscrite en actrice de la défense des droits des personnes en situation de handicap à cette époque.
Les droits des personnes en situation de handicap bénéficieront, quoique toujours avec un certain décalage, des mouvements de contestation des années 70 (désinstitutionalisation et antipsychiatrie notamment). La déclaration des droits des personnes handicapées de l'ONU, datant du 9 décembre 1975, précédée de la déclaration des droits du déficient mental (1971) en sont des exemples importants. On peut de plus citer l'année internationale du handicap, qui a permis de rendre plus visible certains aspects des prises en charge et de faire le point sur les avancées sociales, et légales. Elle avait pour but la promotion de la « pleine participation et de l'égalité », avec une sensibilisation du public et une meilleure acceptation sociale des "handicapés". A suivi un programme d'action de l'ONU, pour assurer une continuité après cette année importante, et enclencher une nouvelle forme de prise en charge. On y trouvera encore souvent le terme "handicapé", non précédé de "personne". Néanmoins, le changement est clair et les processus en faveur de la valorisation sociale et d'intégration des personnes est enclenché.
Cet article est l'occasion, de poursuivre le travail effectuée l'année précédente Article_2012/13 et de développer particulièrement la question des droits de la personne.
J'étudierai la question des classifications du handicap, qui sont à elles seules le reflet de l'évolution sociale et culturelle de la société vis à vis du handicap. De la création de la CIM (classification internationale des maladies et des problèmes de santé) en 1946, révisée en 1990, à la parution de la CIH (classification internationale des handicaps initiée par WOOD et adoptée en 1992), en passant par les différentes DSM (the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) dont la première publication DSM-I remonte à 1952. Je regarderai plus précisément les changements apportés en 1968 pour la DSM-II et en 1980 pour la DSM-III, qui sont les années qui nous intéressent. Ces deux dernières publications sont le reflet aussi du mouvement anti-psychiatrique étudié les années précédentes.
Bref historique et contexte international de la vision du handicap
L'évolution des classifications du handicap
Comme évoqué précédemment, il me semble important de relever certains points importants du contexte international en matière de droit des personnes en situation de handicap. En effet, les différentes classifications ont évolué et si elles ne sont pas directement liées au droit, elles effectuent néanmoins un changement dans les représentations du handicap, changement qui permettra alors une évolution dans la revendication de droits égalitaires pour ces personnes.
Si on s'autorise à remonter un peu le temps, on aura une meilleure appréhension des changements de ces années charnières. Au Moyen-Age, le handicap était attribué à diverses superstitions et générait de nombreuses peurs, de la méfiance et de la honte. Progressivement, on a vu l'émergence d'approches plus rationnelles. L’intérêt pour le handicap a été principalement médical : les médecins ont tenté depuis le 16ème siècle de trouver les causes et cherché les possibles guérisons ou soins.
Au courant du XVIIIème siècle, l'approche devient pédagogique. "Victor", l'enfant retrouvé dans la forêt, sans langage et abandonné, est pris en charge par Jean Itard, lequel mit alors en place différentes situations ludiques et pédagogiques pour faire progresser l'enfant. Une volonté naît de prendre en considération le développement de l'enfant et de le stimuler pour développer son potentiel, tout autant ou plus que la volonté de guérir ou de soigner.<ref>Aide avec le cours de Carolina Villiot, Déficiences intellectuelles lifespan</ref>. Le 19ème a vu la multiplication des traitements et de l'éducation spéciales créant des catégories de plus en plus fines séparant le normal du pathologique, alors que le 20ème siècle a vu l'émergence des experts de l'enfance anormale: psycho-pédagogue, médico-pédagogue, pédo-psychiatre, neuropsychiatre infanto-juvénile.
Dans les années 1960, apparaît la notion d'environnement du handicap et de situations handicapants. Les difficultés des personnes concernées ne sont ainsi plus uniquement dues à la personne elle-même, mais aussi au contexte dans lequel elles évoluent. La CIH (classification internationale du handicap) de Wood en 1980 promeut alors la question de l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Progressivement elle tendra vers une terminologie tentant d'éliminer au maximum la négativité du handicap.
Les droits de l'homme s'intéressent alors au handicap. L’intérêt est porté de plus en plus sur la participation sociale des personnes, et non sur leurs difficultés. La notion de relativité du handicap est née. Et suivront ainsi les combats pour faire valoir cette relativité et la prise en compte du contexte dans la notion de handicap.
Ces changements sont fondamentaux, car ils sont le socle sur lequel s’appuieront les acteurs militants pour les droits de ces personnes.
Ailleurs...
Dans ces années-là, on peut noter l'émergence de mouvements satiriques en faveur des droits de la personne en situation de handicap, comme le journal "handicapés méchants", journal satirique rallié aux mouvements politiques de gauche de l'époque en France (Front libertaire). Le mouvement vient d'étudiants paralysés, et soutiendra par exemple la lutte pour l'égalité de salaire dans certaines entreprises employant des personnes avec un handicap.
En Norvège, l'évolution des institutions (ségrégatives puisque mettant les enfants en situation de handicap dans des institutions séparées du cursus ordinaire) vers des écoles inclusives est en expansion. L'article résumant l'oeuvre de Siri Woarmnaes "Vers l'inclusion des enfants en situation de handicap" sera ici très intéressant pour aller plus loin dans les concepts émergents de normalisation et de désinstitutionnalisation.
Et tout proche, dans le canton de Vaud voisin, il faut relever que l'eugénisme, héritage des politiques nazies du milieu du siècle, persiste encore durablement dans ces années là. En effet, Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod et Jacques Gasser nous éclaire sur ce sujet dans leur ouvrage "Rejetées, rebelles, mal adaptées : débats sur l'eugénisme, pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse romande au XXe siècle"<ref>Rejetées, rebelles, mal adaptées : débats sur l'eugénisme, pratiques de la stérilisation non volontaire en Suisse romande au XXe siècle / Geneviève Heller, Gilles Jeanmonod, Jacques Gasser ; collab. de Jean-François Dumoulin, Genève : Georg, 2002 </ref>
On y relèvera le fait qu'il existait une loi sur la stérilisation des femmes, à visée eugéniste, qui ne fut abrogée qu'en 1985!
On remarque que les droits de la personne en situation de handicap s'inscrivent dans un mouvement large de revendications de la reconnaissance de celles-ci en tant que personnes. On veut reconnaître l'humanité de ces personnes, et non pas ne voir chez elles que leur handicap. La revendication de droits va de pair avec cette nouvelle philosophie naissante, dont on voit l'expansion dans tous les domaines étudiés ici ( droit des patients, droit des usagers de la psychiatrie, droit des prisonniers, droit des femmes, droit des enfants).
Et plus tard...
Les débats en faveur des droits des personnes en situation de handicap ont été plus vifs dans les années 1990-1995. On peut noter à ce moment là que les débats s'accentuent au niveau de l'égalité des droits pour tous, et particulièrement en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. Une initiative populaire prend forme, mais elle n'aboutira pas. L'historique de cette période est repris de manière précise sur le site http://www.freierzugang.ch/fr/index.html, dont je conseille la lecture.
On notera aussi la convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées de 2006, qui n'a toujours pas été ratifiée par la Confédération, bien que le processus soit aujourd'hui bien avancé. Un article très intéressant en fait état et met en perspective quelques points centraux de cette convention, et leur incidence potentielle sur la vie des personnes concernées. Il reprend en outre le fait que la bataille pour ses droits a vu le jour "au crépuscule du XXème siècle" et qu'elle se poursuit à "l'aube du XXIème" de qui confirme de manière poétique ce qu'on a vu précédemment, à savoir l'arrivée tardive de l'officialisation de ces droits. Fichier:Guerdan Revue 2012.02.pdf
Ainsi, le processus d'égalité, surtout en faveur des plus exclus, est un processus long et semé de retour en arrière, de peurs de l'inconnu, d'inquiétudes face à la différence. Il est à ce jour, toujours en avancement, et ne cessera, on l'espère, d'évoluer.
A Genève, dès les années 1960
Insieme Genève, un exemple d'association de parents
Insieme Genève est donc une association de parents fondée en 1958, laquelle s'est fortement imposée pour faire valoir et défendre les droits des personnes (enfants et adultes) en situation de handicap. Droit à l'intégration, droit au travail, droit à une place dans la société. Sur leur site http://www.insieme-ge.ch/documentation/historique.pdf, on trouve un historique très représentatif des différentes étapes de la construction de son combat. Voici la copie des premiers éléments, dont je n'ai conservé que les plus marquants pour notre recherche et que j'ai annoté en italique, afin de faire le lien et de mettre en exergue les concepts vus précédemment :
1958 Création à Genève de l'association de parents d'enfants inadaptés.
1959 Premier séjour de vacances pour 25 enfants mentalement handicapés organisé par l'apmh.
> droit à l'accès aux vacances
1960 Création de la Fondation et du Village d'Aigues-Vertes.
1961 L'association de parents d'enfants inadaptés devient l'association genevoise de parents d'enfants mentalement déficients.
> on retrouve le lien avec les classifications du handicap, et le changement sensible de point de vue, avec un glissement entre inadaptés : c'est la personne qui est inadaptée, et mentalement déficients : c'est un constat, mais il n'y plus ce décalage avec la normalité.
1962 L'atelier Bémont reçoit des personnes handicapées qui seront par la suite intégrées dans les ateliers protégés de la Société genevoise d'intégration professionnelle (SGIPA).
1967 Ouverture par l'apmh de Claire-Fontaine, home pour personnes handicapées de plus de 15 ans auquel vient s'adjoindre en 1978 un petit foyer.
En 2003, se sont rajoutés 5 appartements qui peuvent accueillir 24 personnes. Actuellement géré par la Fondation Ensemble.
1969 Création du jardin d’enfants spécialisé "la petite enfance", actuel jardin d’enfant Ensemble, géré par la Fondation Ensemble.
> on retrouve dans ces trois derniers évènements ce paradoxe entre la volonté d'intégration, et la création de structures ségrégatives. A cette époque, intégrer, c'est avoir le droit de sortir son enfant de chez soi, et de l'emmener passer sa journée à l'extérieur, même si cet extérieur est exclu du monde ordinaire
Création du Service éducatif itinérant (actuellement géré par l'Astural).
Création par la SGIPA du centre d'intégration socio-professionnelle (CISP).
1971 L'association genevoise de parents d'enfants mentalement déficients devient l'association genevoise de parents d'enfants handicapés mentaux.
> nouveau glissement sémiologique
1972 Ouverture de l'école de la Petite Arche, école spéciale pour enfants pluri-handicapés de 4 à 10 ans.
1980 Création de la fondation Cap Loisirs sous l'impulsion du Service des Loisirs et de l'apmh.
1981 Création de la Fondation "La Ferme" en faveur des personnes mentalement handicapées (à l'origine de l'Essarde).
1983 Ouverture d'un atelier de jardinage à la ferme (future Essarde).
1985 Ouverture par l'apmh de l'Essarde lieu de vie, de travail et d'apprentissages.
> Multiplication des lieux où peuvent se rendre les personnes avec handicap mental, pour y développer des activités, des compétences, et s'approcher de la notion de valorisation des rôles sociaux que l'on retrouve dans l'association Trajets.
Création du centre de formation continu (CEFCA) qui dépend de l'association pour la formation continue des adultes handicapés et de leurs proches.
> On retrouve le droit à la formation
L'Association genevoise de parents de handicapés mentaux devient l'association genevoise de parents et d'amis de personnes mentalement handicapées (APMH).
> élargissement du public, plus uniquement des parents
1986 Création par l'apmh de la Fondation Ensemble, chargée de gérer l'ensemble de ses institutions. Création de l'association genevoise d'insertion sociale (AGIS).
> notion d'insertion, que l'on retrouve chez Alain Dupont à travers la fondation Trajets.1988 Ouverture de l'Atelier, centre d'enseignement pratique pour adolescents.
1991 L'office de coordination et d'information pour personnes handicapées (OCIPH) devient le centre d'information et de coordination pour personnes handicapées (CICPH).
> développement des ressources, des informations, à destination des usagers
J'arrête ici cet historique, qui continue bien évidemment jusqu'à nos jours, et qui m'a permis de mettre en lumière ce développement progressif vers des structures de plus en plus inclusives, mais dont on sent qu'elles se heurtent à de nombreuses barrières. A l'heure actuelle, le processus est encore loin d'être achevé, et les associations de parents continuent à se battre pour faire reconnaitre les droits de leur enfant (intégration scolaire par exemple).
Parallèlement, l'association Trajets
Voici comment se raconte Trajets sur son site.
"L'histoire de Trajets: un défi permanent
«L'homme est capable de faire ce qu'il est incapable d'imaginer.» René Char
L'origine de Trajets remonte à l'animation d'un club et l'organisation de vacances avec des personnes déficientes intellectuelles et des personnes valides et une recherche de moyens pour permettre leur intégration à la vie de la cité.
Parallèlement, en 1976, la réflexion d'une équipe du centre psychosocial des Pâquis s'élargit sur les difficultés rencontrées par des personnes souffrant de troubles psychiques.
Pour une partie de sa clientèle, des personnes considérées comme malades chroniques, inactives, très isolées et marginalisées, le type de prestations proposées est inadéquat et incomplet. C'est ainsi qu'il est demandé au responsable de l'expérience réalisée avec les personnes déficientes intellectuelles de mettre sur pied un lieu d'accueil.
Ainsi «Le Quatre» est né, lieu d'accueil et de rencontres non médicalisé, afin d'offrir à cette population les services d'une approche nouvelle.
L'originalité s'appuyait sur un renouveau du regard posé sur ces personnes et sur la collaboration de bénévoles ainsi que des habitants du quartier. En juin 1979, de nombreuses activités d'intégration sont mises en place avec la naissance de l'Association Trajets, qui reprend l'ensemble des prestations, en dehors du lieu d'accueil qui rejoindra l'Association en 1994.
Depuis lors, l'Association Trajets s'efforce de satisfaire les demandes d'aide de personnes qui, en raison d'un handicap ou de difficultés psychologiques ou psychiatriques, souvent conjuguées à une dégradation de leurs conditions de vie, se trouvent mises à l'écart de la vie sociale.
L'Association a développé son action en lien avec le contexte socio-économique et l'évolution des besoins en santé mentale, défendant des valeurs liées à l'intégration sociale des personnes parmi les plus marginalisées."
On retrouve au départ de l'association cette envie d'offrir "des vacances", comme on l'avait vu chez INSIEME. Un "détail", le droit aux loisirs, aux vacances, fut ainsi le point de départ de nombreuses autres revendications.
Alain Dupont, acteur de son temps
Biographie résumée de l'article 2012-2013
Alain Dupont naît à Genève en 1946 de deux parents français réfugiés en Suisse pour fuir la Haute-Savoie. Il est élevé dans des valeurs catholiques d’entraide et de charité, se concrétisant dans son investissement du scoutisme et sa révolte précoce contre l’injustice.
Son enfance est marquée par la mise en danger de sa propre vie. Il est mordu par un chien à la joue, défigurant son visage et mettant en cause son diagnostic vital. Il en sort fort de la conviction que l’on peut combattre la mort et vivre avec un handicap. Il prend rapidement son indépendance vis-à-vis du scoutisme et du catholicisme, refusant toute forme d’exclusion (raciale, sociale, psychique,…), d’injustice ou d’enfermement. Parallèlement à ses études d’éducateur spécialisé à Lausanne, puis en sciences de l’éducation à la FAPSE de Genève, Alain Dupont connaît ses premières expériences professionnelles. Il travaille en tant que premier conseiller social dans un cycle d’orientation , fait des stages lors de sa formation dans des institutions spécialisées. Il constate la violence de ces institutions, l’injustice de certaines décisions et l’inégalité entre les enfants placés et le personnel encadrant.
Ces expériences l’on amené à choisir, après avoir hésité à partir faire de l’humanitaire, de rester à Genève, pour travailler et se battre pour une meilleure prise en charge des personnes en difficulté. En 1970, il devient directeur de Caritas jeunesse et crée trois ans plus tard un secteur pour personnes handicapées. Il est le témoin de plusieurs situations de crise menant à un enfermement psychiatrique et continue de mener des actions en faveur d’une amélioration de l’encadrement de ces personnes.
En 1972, sous l'aile d'Einsering, il monte un service de sociothérapie en déficience mentale. C’est l’apparition de son combat en faveur des droits des personnes en situation de handicap. Il devient militant pour la dignité des personnes, et combat vigoureusement l'enfermement. Il vise à faire changer les comportements face au handicap. Alain Dupont croit en l'éducabilité des personnes, et à leur capacité de faire des apprentissages. Avec Einsering, ils défendent le droit au logement pour les personnes avec une déficience. Mais ils veulent une réelle intégration, pas un lieu de soins et médicalisé. Cette initiative aboutit sur un projet d’appartements, qui se heurtera à une levée de boucliers.
En 1977, pour répondre à des réflexions d’équipes sur les besoins et difficultés des personnes souffrant de troubles psychiques, Alain Dupont inaugure «le Quatre », lieu d’accueil et de rencontres. Un lieu démédicalisé, désinstitutionnalisé, ayant pour but de proposer des activités de loisirs, de travail, d’occupation, d’animations et de repas. Cela aboutit en 1979 sur la naissance de l’association Trajets, toujours avec cette visée intégrative.
On sent derrière le discours et les actes d’Alain Dupont, l’envie de respecter les personnes et de défendre les droits fondamentaux qu’elles réclament : un travail, un appartement, des amis… Une prise en charge respectant la dignité et apportant du soutien pour l’intégration des personnes avec un handicap ou des souffrances psychologiques ou psychiatriques. La fondation Trajets sera créée en 2003, afin d’en pérenniser les activités. Alain Dupont exprime sa vision positive du handicap, l’importance de la valorisation des personnes par leur rôle social,. Il est un acteur de l’évolution de cette vision sociale du handicap. Il croit en l’éducation du public qui passe selon lui, par la rencontre.
Il notera cependant des limites au fonctionnement de trajets. Il parle alors du paradoxe de l’aide. L’aide devient un autre type enfermement : celle de la prise de contrôle sur la vie de la personne. C’est un forme d’assistanat, ce n’est pas une intégration « réelle ». Il veut passer de l’aide à l’accompagnement, et met en place les « projets de vie ». Il s’agit de mettre la personnes au cœur de son projet, c’est elle l’actrice de sa vie, et non les travailleurs sociaux gravitant autour d’elle. En réponse à l’éloignement de la Fondation par rapport à ses valeurs, Alain Dupont quitte trajets en 2002 et fonde l’Association T-Interactions. Il élargit le champ des personnes concernées, cherche l’autofinancement et l’indépendance vis-à-vis des subventions publiques. Il a pour objectifs de donner des réels rôles sociaux, avec un salaire, une reconnaissance sociale, une autonomisation des personnes.
Alain Dupont, défenseur des droits des personnes en situation de handicap
De ce résumé, on peut noter quelques éléments essentiels dans notre recherche. Porté par des valeurs au départ catholiques, concrétisées chez Alain Dupont très jeune dans le scoutisme, valeurs d'entraide, de charité, de partage, de protection des plus faibles et de justice, pour ne citer que celles-là, ces valeurs se sont inscrites ensuite dans le mouvement humaniste plus général.
Se battre alors pour autrui, pour ceux qui ne peuvent pas le faire, c'est être au plus haut dans la défense des droits de la personne, de toutes les personnes.
Si j'appuyais précédemment sur l'évolution des classifications du handicap, c'est qu'elles sont elles-même le reflet de l'acceptation progressive et non évidente, comme on pourrait le supposer aujourd'hui, que le "handicapé" est avant tout une personne. D'où l'évolution parallèle de la terminologie pour ces personnes. De "handicapé" à "personne en situation de handicap", en passant entre temps par "personne souffrant d'un handicap", "personne vivant avec un handicap", etc. qui montre la prise en compte de ces personnes en tant que tel, et non uniquement la prise en compte de leur handicap.<ref>Cours de Madame Wolf, Polyhandicap, librement cité.</ref>
Alain Dupont, dans ses actions en faveur de l'autonomisation des personnes, de leur valorisation en leur donnant un réel rôle social, s'inscrit dans ce mouvement général. C'est défendre le droit de ses personnes à jouir d'un certain contrôle sur leur vie, qu'on pourrait appeler autodétermination, et qui fait toujours partie des objectifs principaux dans la prise en charge de ces personnes aujourd'hui.
C'est défendre le droit à faire partie de la société, à prendre part à ses activités, à être considéré et à participer.
Entretien: l'histoire et l'actuel
On retrouvera l'entretien complet retranscrit dans le chapitre réservé à cet effet. Il me semble important de reprendre ici certains points centraux, et de voir comment Alain Dupont, à travers son discours, a pu répondre (souvent de manière indirecte) aux questions qui nous intéressent ici...
En ce qui concerne le mouvement général des droits de la personne, Alain Dupont confirme qu'il s'inscrivait bien dans un mouvement où toutes ces revendications émergeaient. Il notera néanmoins que dans le champ du handicap, cela a été plus tardif, et qu'il lui semble que ça l'est encore aujourd'hui... Le début de la lutte s'est fait pour lui en collaboration avec Einsering, qui avait monté un centre universitaire de soins et de diagnostic pour les personnes déficientes. Ils ont commencé ensemble la prise en charge individualisée des personnes. C'était peu après ses études d'éducateur, il était encore au début de sa carrière, et très jeune, mais déjà en révolte face à l'enfermement et aux injustices...
Pour lui, un "guide" pour sa conduite, et la suite de la carrière, fut la charte des droits des personnes handicapées de 1975Fichier:Déclaration des droits des handicapés, 1975.pdf. Tout y est, la dignité, le respect, les droits civiques,... Il met toujours en perspective les textes signés, les actes politiques, qui sont à son sens nécessaires, certes, mais insuffisants. La pratique doit prendre le relai et s'assurer de leur mise en œuvre au quotidien, et dans la durée.
Le temps des droits est un temps long, une lutte sur la durée, un combat presque sans fin... Les racines ont été prises dans ces années là, mais la lutte dure encore aujourd'hui.
Quelques grandes étapes sont à relever: la déclaration des droits des personnes handicapées de l'ONU en 1975, l'année du handicap en 1981, année qui a vu donc s'accélérer les articles sur ce domaine, et s'intéresser un peu plus le grand public,...
Alain Dupont est fort de valeurs, de justice, d'égalité, de respect des personnes, qui ont fait son engagement. Il exècre l'enfermement, et prône la liberté. C'est le départ de son combat.
Pour lui, il est du fait des professionnels de se porter garants du respect des droits des personnes en situation de handicap dont ils ont la charge. Même si aujourd'hui, certains progrès ont été faits, il n'y a aucune garantie que la prise en charge ne respecte, partout, ne serait ce que la charte de 1975. Il donne de nombreux exemples d'institutions actuelles, qui ne mettent en place qu'un "service minimum". Les personnels sont peu engagés et plus le handicap est lourd, plus la ségrégation reste vive. Aujourd'hui reste relié à hier: il a bénéficié de ses luttes, mais elles sont loin d'être achevées. Beaucoup reste à faire et ce sont les professionnels, nous, qui en portons la responsabilité. Donner des réels droits, des réels rôles sociaux, une réelle considération, tels sont les défis au quotidien à relever aujourd'hui, pour demain.
Une belle leçon d'humilité et une discussion qui renforce l'engagement actuel pour poursuivre le progrès dans ses valeurs humanistes d'acceptation et de respect de tous.
Conclusion
Cette étude du développement des droits de la personne dans les années 1960-1980 à Genève, par le biais de recherches sur internet, de lectures des articles parallèles dans ce wiki, de documents divers et de l'entretien d'un acteur de ce temps, m'a permis d'appréhender quelques concepts fondamentaux, pour une meilleure compréhension de cette histoire des droits. Le point de départ, de manière assez unanime, serait la déclaration des droits de l'homme de 1789. Autour de cette déclaration, se sont dessinés au fil du temps plusieurs combats spécifiques, qui ont pour certains aboutis à des conventions de droits spécifiques (déclaration des droits de l'enfant, déclaration des droits des handicapés, etc...). La question principale à se poser aujourd'hui serait la nécessité de ces conventions spécifiques. Les droits de l'homme, appliqués à tout être humain, sont suffisants. Finalement, le fait même de créer des conventions spécifiques, c'est traiter la population concernée comme hors du champ des droits de l'homme, donc hors du champ de l'humanité. Ces personnes ne font alors pas partie de l'humanité? Dans le champ du handicap, le terme même de "personne" est un concept en soi, qui est apparu tardivement. Comme me l'aura fait ressentir Monsieur Alain Dupont, qui a su transmettre les valeurs et l'importance de son combat, il est aujourd'hui de la responsabilité des professionnels de veiller à la considération de ces personnes en tant que personnes, et au respect et à la défense de leurs droits.
Webographie
Déclaration sur les droits des personnes handicapées
http://www.integrationhandicap.ch
http://www.freierzugang.ch/fr/index.html
http://www.egalite-handicap.ch/convention-realtive-aux-droits-des-personnes-handicapees.html
Notes et références
<references/>
Introduction
Dans le cadre de cet article, nous aborderons les droits des patients (en particulier à l'hôpital) tels qu'ils ont pris un essor, dans le contexte des droits démocratiques conduits par les droits de l'homme. La genèse de droits des patients se compose, entre autres, de la remise en question du monde hospitalier et du statut de patient, afin de le considérer plus humainement dans la prise de décision concernant sa propre santé, sa dignité humaine, le respect à sa personne, d'améliorer le rapport patient-médecin, d'assurer des soins dignes à l'hôpital, etc. Nous verrons que l'ouverture des hôpitaux permettra avec le temps de faire avancer la question de la santé publique ou de favoriser les premières consultations ambulatoires et plus tard l'ouverture des soins à domicile. Ces indices sont à la source de notre réflexion avant de parvenir à la problématique de cet article. Pour ce faire, nous attacherons pour cet article un regard sur la terre natale du Général Dufour en passant tout d'abord en revue l'historique de la naissance des hôpitaux en Suisse, les textes fondamentaux et particuliers à la source de droits de patients en milieu hospitalier pour ensuite développer la problématique ressortie. Pour ce faire, nous arriverons aux années '80 pour percevoir l'ère du militantisme découlant des droits de patients pour arriver à l'actuelle "charte de droits de patients" constituée par le droit à la confidentialité, à la liberté, à l'accès aux soins, etc. Notre article recevra les apports de l'entretien avec la conseillère nationale de Saint-Gall et Présidente de la Fondation de l'Organisation suisse des patients (OSP), Mme Margrit Kessler, ainsi que celui avec le médecin nechatelois, François Loew. Nous analyserons les interviews effectués dans le cadre de cette recherche et ferons appel à l'intelligence collective apporté à l'intérieur de ce wiki avant achever notre article par une conclusion.
Problématique - question historique initiale
Nous nous attacherons à questionner les droits des patients à travers la problématique du patient-cobaye : dans quelle mesure sous le couvert des droits des patients, la médecine mène-t-elle ses propres desseins scientifiques et considère le patient, comme un cobaye en fin de compte ? Cette problématique renvoie donc à la protection des personnes qui se prêtent ou pas à des recherches médicales, donc concerne le consentement du patient et les lois bioéthiques.
Les recherches médicales qui ont alerté l'opinion publique touchant l'expérimentation humaine et jugées à partir du le code de Nurenberg (1947) ont abouti à dix règles abordant l'expérimentation humaine. Ces règles furent appliquées pour juger les médecins nazis influencés par les précurseurs du racisme biologique, comme Joseph Arthur de Gobineau au 19e siècle et Houston Stewart Chamberlain, durant l'époque d'Hitler. Les expériences nazis revendiquaient la pureté de la race sur les races métissées. Ces expériences effectuées dans les Camp de concentration tels que Dachau, Auschwitz, Natzwiller, Buchenwald étaient évidemment en dehors de tout code de déontologie<ref>En Suisse, 1997,Qui gère le comportement des médecins, le devoir d'informer et de tenir un dossier médical (voir art. 10 "devoir d'informer "& art. 47 "sactions")</ref>, sans un apport fondamental pour la science. Ces expériences consistaient à des inoculations de germes mortels (exemple : typhus), de gaz de combats, de brûlures au phosphore ou alors agissaient sur l'alimentation, etc. Ces expériences ont touché les transsexuels et les handicapés allemands. Voir témoignage d'Irene Hizme (voir vidéo).
Il va s'en dire, qu'actuellement, les protocoles médicaux suisses tiennent compte du code de Nuremberg et des droits de l'homme. Notamment, ils demandent le consentement du patient, avant de pouvoir mettre en œuvre toute expérimentation sur ce dernier. Toutefois, il s'agit d'examiner dans quelle mesure, il reste des zones d'ombre permettant des dérives ou permettant au médecin de faire de la recherche médicale, implicitement, à l'insu du patient ou sous le couvert d'un consentement, soit disant "éclairé". Le rapport inégalitaire entre médecin et patient autant sur le plan médical que juridique semble être le plus souvent en défaveur de ce dernier.
Contextes historiques
Histoire des hôpitaux en Suisse
Autrefois, en Suisse, les autorités écclésiastiques s'occupaient des hôpitaux [3] soignant tout type de malades, puis les autorités communales ont repris ces responsabilités. Depuis le XIX siècle, les asiles et les hôpitaux sont devenus établissements du canton. Le dernier siècle verra de profonds changements dans le monde hospitalier, au sein du personnel s'occupant des malades : moins de religieuses d'abord au XXe siècle, et dès la fin du siècle plus d'ouverture à un personnel d'étrangers formés dans leur pays d'origine d'auxiliaires.
Dès 1850, l'essor de l’anatomie pathologique permettra aux médecins, par l'observation, de s'emparer de l'évolution de maladies. Ce qui engendrera "les critères médicaux" <ref>Critères qui plus tard seront développés pour l'examen médical</ref> utilisaient pour l'admission des patients dans les hôpitaux. Autrement dit, non seulement la médecine hospitalière progresse, mais encore plus la chirurgie. Du reste, l'utilisation de désinfectants, de l'asepsie, voire la narcose s'intensifie, pour procéder aux opérations chirurgicales. Les découvertes scientifiques du XIX siècle feront aussi avancer la médecine. Dans le milieu hospitalier et l'administration, les nouveaux médicaments ne se produisaient que dans les hôpitaux. La médecine moderne a commencé à pointer du nez avec l'utilisation des rayons X, des analyses de laboratoire, et l'utilisation du thermomètre [4]. Dès 1930 les hôpitaux répondaient déjà aux exigences de la médecine moderne, avec leurs équipement, mais pour des questions de santé publique, chaque canton se procurera un hôpital cantonal, puis un hôpital universitaire, où la recherche et l'enseignement sont prodigués. Au XX siècle, les hôpitaux suisses comptaient avec des appareils spécialisés le plus onéreux existants.
-Au début du XIII siècle, Aymon de Savoie fonda le premier hôpital appelé Notre-Dame ou Grand hôpital en Suisse.
-En 1236, à Villeneuve devenant le premier hôpital en Suisse à l'époque où une ville médiévale accueillait des malades, des pauvres et des pèlerins.
-En 1535, l'Hôpital Général à Genève voit le jour.
-En 1806, l'Hôpital de Notre-Dame devient l'Hôpital cantonal soignant les patients avec maladies graves, les patients psychiatriques et les détenus à Lausanne.
-En 1810, une loi sanitaire vaudoise décrète trois types d'Hospices. L'Hospice cantonal (soignant les patients atteints d'une maladie grave), l'Hospice des aliénés (soigne les patients atteints d'une maladie psychiatrique) et l’Établissement des incurables (hébergeant les patients atteints d'une maladie incurable).
-En 1856, l'Hôpital cantonal ouvre ses portes à Genève.
-En 1874, le Grand Conseil prévoit la construction d'un nouveau hôpital cantonal qui deviendra hôpital universitaire en 1890 et la même année la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne est inaugurée. Ceci sera le début de la conception d'une Cité hospitalière dès 1950.
-En 1875, Mise en place de la Maternité à Genève.
-En 1891 Le Professeur Henri Stilling obtiendra la première chaire d'anatomie pathologique de la Faculté de Médecine à Lausanne.
-En 1900, deux asiles "hors cité" sont nés : Loëx (destiné aux malades incurables et sans contagion) et Bel-Air (hébergeant les aliénés) à Genève.
-En 1930, nait l'association des hôpitaux publiques et privés, des cliniques, des sanatoriums et différents établissement de soins nommés Veska, pour prendre position lors de consultations fédérales ou pour négocier avec les assurances, les associations professionnelles, etc..
-En 1961, Ouverture de l'Hôpital des enfants à Genève.
L'Humanité, valeur fondamentale de La Croix rouge suisse
La Croix Rouge suisse (CRS) est fondée le 17 juillet 1866 à l'initiative du Général Guillaume Henri Dufour (voir vidéo) et du conseiller fédéral Jakob Dubs. Sa genèse est liée aux événements de la guerre civile suisse de 1847, appelée Sonderbundskrieg, montrant un général Dufour soucieux de protéger les vies humaines, tant des soldats que du peuple et soulignant ses valeurs . Sonderbundskrieg est la révolte de cantons catholiques alliés pour contrer la politique anticatholique des radicaux qui fermaient les couvents catholiques. Ces valeurs seront reprises dans les principes de la Croix rouge suisse en commençant par : « L'association a pour but essentiel de concourir par tous les moyens en son pouvoir au service de santé de l’armée suisse et à la protection des familles privées de (leur) soutien par l’appel sous les drapeaux en cas de guerre» [5]. Soigner 85000 soldats de l'armée française du général Bourbaki en pleine guerre franco-allemande fut la première prouesse de la CRS. Elle participera aussi à la fondation de l'Ecole de soins infirmiers et de l'Hôpital du Lincours. Durant les deux guerres mondiales, le CRS affirmera son rôle même au niveau international. Elle contribuera à l'expansion de l'hôpital en devenant l'hôpital ambulatoire en cas de guerre. Sur le plan national, la CRS a joué un rôle fondamental pour la mise en place aussi du système suisse de la santé publique et des affaires sociales. Elle a favorisé d'ailleurs entre autres, la professionnalisation des soins infirmiers. C'est ainsi que la valeur humanitaire promue par le Général Dufour a traversé les frontières en prenant un autre élan, celui d'un droit international humanitaire (DIH) qui protège les civils, les soldats, les blessés en cas de guerre [6].
Histoire des infirmières et des médecins en Suisse
L'origine des infirmières revient au XIX siècle, les religieuses prédominent dans la profession de soins de malades et laissent peu de place aux vocations laïques. En 1859, la première école laïque de gardes-malades de La Source est fondé préparant les femmes à l'ouverture d'une profession libérale, tâche difficile, car même les médecins optaient pour faire appel aux religieuses dans les hôpitaux cantonaux <ref>Qui deviendront les hôpitaux universitaires </ref>. C'est la Croix Rouge qui contribuera à l'ouverture des écoles d'infirmières de Berne et de Zurich, en 1899 et 1901 respectivement. Pour être près du malade dans les hôpitaux, la Croix Rouge suisse, organe de tutelle de soins infirmiers en Suisse, promulguera l'uniformisation des qualifications, vu l'avancement de la médecine et de la chirurgie; désormais plusieurs personnels soignants étaient présents : religieuses, samaritains, bénévole, diplômés Croix Rouge et le personnel laïque[7]. En 1901 à Genève, la doctoresse Marguerite Champendal fondera l'antenne sociale la Goutte de Lait, vu les nombreux enfants mal nourris. Quelques années plus tard, en 1905 ce fut la fondation de l'Ecole d'infirmière Le Bon Secours, puis de la Pouponnière. Au XX siècle, le secteur hospitalier subit une pénurie du personnel après la Deuxième Guerre Mondiale, conséquence d'un manque de perspectives pour offrir une place de travail plus digne aux laïques infirmières. En 1978, le secteur pédiatrique, maternité et psychiatrique des infirmières deviendra l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI). Les infirmiers(ères) sont interpelés ainsi à suivre une formation, pour répondre aux exigences d'un système de santé complexe, des nouvelles responsabilités et à certaines qualifications afin d'être près du patient.
A l'origine, au XVIe siècle, les médecins étaient des barbiers-chirurgiens. Les femmes n'entreront dans la profession que vers la fin du XIX siècle. Les médecins avait le prestige de jouir d'une belle position sociale mais leurs compétences professionnelles n'étaient guère reconnues. Entre les hommes de sciences renommés figurent : Paracelse, Felix Platter , Johann Jakob, etc. Cette profession dite libérale bénéficiera d'une grande autonomie et d'une considération singulière. Quelques faits historiques, tels qu'en 1686, les leçons publiques et en 1741 le théâtre anatomique désigneront l'intérêt des médecins pour l'anatomie. Plus tard, en 1782, l'institut médico-chirugical sera fondé à Zurich afin d'enrichir le bagage scientifique des médecins. La professionnalisation du métier de médecin sera plus vif lorsque les facultés de médecins seront établies, en Suisse romande par exemple, développant en particulier la clinique. L'Etat contribuera à cette évolution par l'instauration de la formation universitaire des médecins au XIX siècle [8]. En outre, les sciences naturelles demeurant dans la médecine ne se détacheront qu'au milieu du XIX siècle lorsque la formation professionnelle pour les médecin s'établit. Dès 1850, les médecins se tournent vers la recherche médicale en abandonnant pour certains leurs positions politiques. Finalement, en 1901, se crée la Fédération des médecins suisses (FMH) promulguant le droit pour les médecins d'exercer leurs métier dans toute la confédération helvétique.Le serment d’Hippocrate mondialement connu pour les médecins n'a pas de valeur juridique, il permet aux médecins de faire le passage d'étudiant à l'exercice de la profession. Ce serment, ne fait pas partie du code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH). Pour terminer, dans les années '90. les médecins suisses ont été malgré tout fortement critiqués pour bénéficier des honoraires très élevés.
- Ligne en retrait
Cette histoire n'est pas sans lien avec l'analyse et la critique de Foucault vis-à-vis des institutions et du pouvoir médical
Comme on le voit, cette évolution de la médecine est d'ordre historique et rejoint tout-à-fait l'analyse de Foucault, relative à la genèse de la clinique, dans son ouvrage "Naissance de la Clinique" :
- malades soignés dans leur famille
- soignés dans hôpitaux, essentiellement tenus par des religieux,
- passage à la science, à la connaissance clinique, au corps médical scientifique dans les hôpitaux
- création d'asiles pour contrôler la population et catégoriser des minorités (pauvres, mourants, personnes en situation de criminalité),
- émergence de la médecine anato-pathologique,
- émergence de la médecine technologique, etc..
Comme le dénote cet auteur, c'est un pouvoir policier assermenté et officialisé par les autorités et les élites suisses. Toutefois, son évolution ne se fera pas sans dérives, renvoyant à la problématique du patient-cobaye, mise en évidence par des associations, militant pour le respect des droits des patients, comme l'ADUPSY ou l'OSP (Fondation de l'Organisation suisse des patients).
Nous allons donc appréhender cette problématique du patient-cobaye, dans les chapitres qui suivent, ainsi que le combat militant pour le respect des droits des patients.
Contexte international des années 40 à 60 : apogée et visibilité de la problématique du patient-cobaye pendant la période nazie<ref>Terme employé pour le sujet soumis à des expériences médicales. Le terme cobaye est aussi utilisé pour les expériences sur les animaux</ref>
Apogée des droits de l'homme suite aux horreurs nazies
Les horreurs médicales nazies ont montré jusqu'où la science, sans conscience, pouvait mener l'homme. Le développement de lois relative aux droits des patients - sur la base des droits de l'homme - est arrivée à son <ref>Ponchon, F. (1999). Les droits des patients à l'hôpital. Que sais -je?. Paris : Editions Puf.</ref>apogée suite à la seconde guerre mondiale et à toutes les conséquences de la Shoa, auxquelles de nombreux médecins nazis ont pris part. Cette terrible page de l'histoire a montré que le pouvoir médical peut être la main droite de pouvoirs politiques, des dirigeants d'une Nation. De ce fait, si ceux-ci exercent un pouvoir dictatorial ou coercitif, non démocratique, sur la population, cela peut entraîner des "crimes contre l'humanité", des expérimentations médicales, notamment de nature eugénistes.
Un certain nombre de lois ont vu le jour après la Seconde guerre mondiale que l'on peut comprendre comme une volonté de mieux protéger les personnes. Soit:
Le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU stipule le droit de toute personne à avoir un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé (article 25). Au sortir de la deuxième guerre mondiale.
1950 : convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
1978 : Conférence internationale sur les soins, à l'OMS
1979 : charte du malade usager de l'hôpital, adoptée par le comité hospitalier de la communauté économique et européenne à Luxembourg...
1994 : Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe: cadre commun d'actions pour améliorer les relations entre soignants et patients. On y trouve essentiellement du droit des patients (information et consentement, respect du secret et de la vie privée, droit aux soins et au traitement…).
Or, les lois ne mettent pas à l'abri de pratiques abusives. Des médecins peuvent-ils contourner ou jouer discrètement avec ces droits démocratiques, afin de mener des recherches scientifiques, repoussant de plus en plus les limites acceptables de l'éthique? Même si les limites de la médecine moderne ne le permettraient pas, il n'est pas impossible que des recherches scientifiques illicites se produisent. Alors, comment protéger les droits des patients : l'éthique, la voie pénale, les propres patients, l'Etat ? L'éthique a remporté une multitude de victoires, sur la maladie, reconnues et acceptées par bon nombre de citoyens. L'éthique ne devrait-elle pas apporter les indications nécessaires aux médecins, pour agir sur un champ pratique, gardé par les frontières des droits des patients ? Tel est notre question.
Les années 60 à 80 une période opaque, succédant à la visibilité des horreurs médicales nazies
Des mouvements critiques, en Europe, remettent en question la légitimité des institutions hospitalières. Elles dénotent l'aspect construit, historique et parfois contingent (surtout au niveau psychiatrique) de la connaissance médicale. En Suisse, entre 1960 et 1980, on ne trouve pas visiblement, à Genève, des associations puissantes de patients faisant état d'horreurs médicales, de cas de patients-cobayes, sauf peut-être, en ce qui concerne l'ADUPSY qui relate des dérives au niveau psychiatrique. Comme le dénote Michel Foucault, la psychiatrique reste catégorielle. En fonction de ses catégories, elle se permet d'enfermer des patients dans des asiles. L'enfermement est au risque de l'abus de pouvoir médical, caché de surcroît par le "secret médical". La lutte dans ce domaine est d'autant plus difficile. L'association a justement observé des cas d'internement forcés, abusifs, qui ont beaucoup de conséquences négatives sur des patients psychiatriques.
Au niveau de la défense de patients, en général, nous avons aussi recensé l'OSP (Fondation de l'Organisation suisse des patients), avec sa fondatrice Mme Margrit Kessler, actuellement conseillère nationale, que nous avons interviewée. C'est une militante, travaillant dans le domaine éthique, qui a justement lutté contre les dérives médicales, notamment au niveau d'expérimentations sur des patients, dont elle a été témoin, qui ont eu des effets néfastes sur leur santé, même la mort, comme nous le dénoteront dans les paragraphes qui suivront.
La remise en question des institutions hospitalières à l'étranger et à Genève
Entre les années 60 à 80, un mouvement critique remet en question la légitimité des institutions, notamment hospitalières. Michel Foucaultretrace notamment cette histoire, dans son ouvrage Naissance de la Clinique, en faisant prendre conscience des mythes médicaux qui se sont construits socialement au fil du temps. La clinique prend une évolution importante vers le XVIII ème siècle où a lieu une spatialisation des malades dans les hôpitaux qui deviennent un centre de savoir. Le regard médical est connaissance et il nécessite pour cela un malade et un hôpital, comme lieu de savoir. Déjà à cette époque, nous retrouvons cette recherche de connaissance et de pouvoir de la médecine qui est encore actuellement, mais aussi dans les années 60 à 80, en pleine vigueur. Le patient n'est pas considéré comme personne, mais est un objet de savoir. Ainsi aux soins s'ajoutent de la recherche médicale. Et même si les conséquences pour la santé du patient peuvent être positives, ce dernier reste, tout de même, en fin de compte, l'objet de recherches, même implicitement.
En Italie, dans la même mouvance, des auteurs engagés comme Franco Basaglia mènent sur le plan politique une lutte pour le respect absolu des droits du patient, ainsi que pour la fermeture des asiles psychiatriques. De telles luttes aboutissent à la création de nombreux lieux alternatifs. Dans son ouvrage, l'institution en négation, Basaglia accorde aux malades un statut social nouveau. Il leur accorde une nouvelle vie, afin de lutter contre la déshumanisation des malades; notamment en remettant en question la nosologie psychiatrique et l'étiquetage abusif de la psychiatrie, enfermant les hommes dans des classifications réductrices et négatives, pour donner souvent un peu d'espoir. Là encore la catégorisation est toujours au risque de cloisonnement et d'exclusion, même d'enfants, comme des historiennes telle Martine Ruchat <ref>Ruchat, M. (2011). Signes et significations du "crétin" et de l'"idiot" dans la clinique médicopédagogique et psychopédagogique en Suisse. Alter, European Journal of Disability Research, 5, 59-68. </ref> l'ont relevé dans le champ de l'histoire de l'éducation spécialisée. Le risque est aussi possible, vu le flou et le manque de vérifications dans ce domaine de la médecine, de faire de la relation entre patient et médecin, le lieu d'un pouvoir et pour le patient d'être traité comme un "cobaye".
Il peut être utile de rappeler les nombreuses erreurs et dérives médicales et psychiatriques, relevées par ADUPSY. Il s'avère, en fin de compte difficile de déterminer, dans cette voie médicale, quelle est la frontière entre soins, recherche clinique et recherche pharmacologique.
Les droits des patients dans les années 60 à 80 en Suisse ne lèvent pas cette opacité
Les lois qui suivront sont des lois fédérales respectant les principes des droits de l'homme. Certaines sont même antérieures au XX ème siècle, mais sont toujours valables actuellement (ex. code civil ou pénal), ainsi que dans les années 60 à 80.
Un des premiers droits est l'Accès équitable aux soins
Selon ce principe tout patient a le droit de bénéficier de soins de qualité, compte tenu des ressources à disposition. Il est question de ce droit dans l'article 3 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans l'article 41, al. 1, lettre b de la Constitution suisse.
Droit à la confidentialité
Tout patient-e-s a le droit au respect de sa vie privée. Ainsi les informations qui le concernent doivent être confidentielles, donc protégées par le secret professionnel. Il en est question dans plusieurs articles de loi: l'article 8 de la Convention européenne sur les droits de l’homme, l'article 13 de la Constitution suisse, les articles 320 et 321 du Code pénal suisse et l'article 35 de la Loi fédérale sur la protection des données. Sans le consentement du patient, le professionnel de la santé ne pourra pas divulguer les informations touchant le patient, même après son mandat, sauf si la loi l'autorise (code pénal art. 321). Si un autre professionnel de la santé souhaite avoir des informations sur un patient auprès d’un confrère, ce dernier ne pourra pas les transmettre sans le consentement du patient. La confiance entre patient et professionnel de la santé est une priorité pour protéger celui-ci. Tout membre de la parenté du patient souhaitant être informé par le médecin, de la maladie chronique, des causes du décès ou tout autre information liée à la santé du patient signifie pour ce faire, soit une autorisation du patient, soit pour le médecin traitant de demander de se faire « délier du secret professionnel par l’autorité compétente du canton ». En cas de manque de discernement, le médecin ne pouvant pas transmettre au patient les informations concernant son état de santé ou des décisions à entreprendre de sa part, pour améliorer son état de santé; le médecin pourra à ce moment-là transmettre ce type d'informations au tuteur, sinon avertir l’autorité concernée.
Droit à l’information
Les patient-e-s ont le droit de recevoir une information objective, claire et complète relativement :
- à leur état de santé,
- mais aussi en ce qui concerne les soins et les traitements qui leur sont proposés,
- sur les risques qu'ils encourent,
- les effets secondaires éventuels et les risques financiers éventuels.
Il en est question dans les articles 5 et 10 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine; ainsi que dans diverses dispositions spécifiques dans les différentes Lois cantonales sur la santé. Il s’agit pour le patient (e) de consentir un traitement médical une fois qu’il a pris connaissance de toutes les informations concernant le traitement. Il peut aussi le moment venu, poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre ces informations. Renoncer aux informations n’est pas pareil à renoncer aux soins médicaux. Dans ce cas le médecin est limité à donner les informations nécessaires au patient. Quant aux soins, des dispositifs particuliers s’appliquent. En Suisse et selon les établissements, les prestations et les coûts concernant les patients sont présentés par écrit aux personnes avec discernement ou pas. Le droit d’information permet aussi aux patients de solliciter « un deuxième avis médical » à savoir consulter un autre médecin, pour obtenir plus d’informations et décider de la mise en place d’un traitement médical.
Droit à l’autodétermination et consentement libre et éclairé
Après avoir reçu des informations, les patient-e-s, en capacité de discernement, sont en mesure de refuser des soins et des traitements. Il est question de ce droit dans l'article 5 de la Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine ; ainsi que dans l'article 10 de la Constitution suisse; l'article 16 à 19c du Code civil ; de même différentes Lois cantonales sur la santé.
Par contre, en cas d’incapacité de discernement, les patient-e-s peuvent transmettre leurs souhaits avec l'aide d’un-e représentant-e thérapeutique. Il en est question dans les articles 370 à 373 du Code civil suisse. En l'absence de cela, le consentement peut-être donné par le curateur qui a pour tâche de représenter le patient dans le champs médical ou par les proches. L’article 378 du Code civil suisse en fait mention.
Mesures de contrainte et traitements « quasi-contraints »
Parallèlement, à ces droits, dans les années 60 à 80, d'autres clauses juridiques, du droit civil et pénal, traitent à propos de contraintes du patient, laissant ainsi la place à des dérives médicales. Cela est d'autant plus frappant que le droit, justement, envisage tout de même des mesures de contraintes et des traitements « quasi-contraints », alors que dans la législation, la frontière entre recherche clinique et soins n'est pas clairement explicitée. Comme l'a noté Foucault, le regard médical est connaissance. De ce fait, un médecin mène implicitement une recherche, ne serait-ce au niveau clinique, quand il soigne un patient. Nous pouvons ainsi nous demander, dans quelle mesure des dérives sont possibles, dans cet espace de vision du médecin ?
En effet, en contre partie des droits explicités dans la partie précédente, il y a des mesures de contraintes qui peuvent être subies par le patient ; notamment lors d'un placement impératif à des fins d’assistance ou de traitement sous contrainte. Or, ces mesures, visant la survie de l'individu, peuvent constituer une atteinte à la liberté personnelle qui est un droit fondamental garanti par la Constitution suisse et d'autres instruments de droit international. Cependant la contrainte n'est légitime que si elle est impérativement nécessaire, proportionnelle au but visé et lorsqu’une base légale le prévoit. Elle est couplée à des voies de recours de la part de la personne qui est objet de cette mesure.
Les principales mesures de contrainte sont les suivantes : Le placement à des fins d’assistance n’est possible qu’en présence d’un trouble psychique, d’une déficience mentale, ou d’un grave état d’abandon. Il implique également que l'aide ne peut être fournie qu'au patient d'une manière moins invasive (principe de proportionnalité).
Un tel placement ne peut être prononcé que par une autorité de protection de l’adulte ou par des médecins désignés par les cantons. Malheureusement, dans le cadre d'un tel placement, il est possible d’imposer un traitement contre la volonté de la personne concernée, toutefois uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
- lorsqu'il y a un risque vital ou que l'intégration corporelle d'autrui est en danger;
- lorsqu’un défaut de traitement met gravement en péril l'intégrité corporelle du patient;
- lorsque la personne concernée n'a pas suffisamment de discernement pour saisir la nécessité du traitement et qu'il n'existe pas de traitement moins invasif.
On parle notamment de ces dispositions dans les articles 426 à 439 du Code civil suisse.
En cas d’infraction pénale, des soins peuvent être également imposés à une personne en ambulatoire ou en internement, quand de telles mesures sont prononcées par la justice pénale. Cela peut d'ailleurs aboutir à un placement résidentiel. Par exemple, cela peut avoir lieu lors de situations de diminution ou privation de liberté relative à des crimes dans une situation d’addiction, également s'il y a crime. Il est question de ces dispositions dans les articles 60 et 63 du Code pénal suisse.
Des traitements "quasi" contraints peuvent être prononcés, en sursis d’une mesure pénale, civile (par ex. mise sous tutelle), administrative (ex. retrait de permis). Dans ce cas, il peut être demandé à l'autorité concernée de fournir un certificat attestant de l’assiduité aux soins, de la part du patient.
Que retenir de ces informations sur les traitements contraints ?
L'ADUPSY, dans les années 70, à Genève, a relevé des cas où des individus on été internés et traités par la psychiatrie, contre leur gré, dans des établissements psychiatriques. Des cocktail de médicaments ont été administrés, par la psychiatrie genevoise, à certains patients, causant même la mort très controversée d'un des militants de l'ADUPSY.
C'est pourquoi sa devise est la suivante :
L'ADUPSY est contre toute forme de contrainte en psychiatrie. De principe, elle est en faveur de la suppression complète des internements, ce qui devrait aussi conduire à une modification radicale de la pratique de la psychiatrie.
Vu le secret médical en vigueur, le fait que le patient doive prouver objectivement ses accusations, la dissymétrie d'expertise entre ce dernier et le médecin, la protection politique des institutions hospitalières, entre autres psychiatriques, qui à priori peut être tout-à-fait pertinente, la complexité des théories médicales, peut-on vraiment être sûr, en toute garantie, qu'aucune recherche, même implicite, n'a été menée sur des patients souffrant de troubles dits "psychiatriques", devenant ainsi, dans un certain sens une sorte de cobaye ?
Mise à part l'ADUPSY, nous avons également noté l'OSP(Fondation de l'Organisation suisse des patients), avec Margrit Kessler, dans les années 80, sa fondatrice qui s'est battue des années, en justice, suite à la mort d'une patiente, à qui l'on avait inoculé certains produits chimiques, probablement dans une optique clinique, donc en fin de compte de recherche, même si le but était de guérir.
Nous trouvons aussi d'autres associations, comme Insieme, une association de parents, qui existe depuis les années cinquante, qui s'est battue pour le droits des personnes en situation d'handicap. Sur son site nous trouvons la phrase suivante :
Insieme demande une protection élevée des personnes mentalement handicapées dans la recherche. Il est exclu qu’elles soient contraintes de participer à des projets contre leur volonté.
Sur leur site, on trouve un historique très représentatif des différentes étapes de la construction de son combat. Combat tout-à-fait légitime, puisque que comme le dénote Martine Ruchat, en décrivant l'histoire de l'éducation spécialisé, entre 1912 et 1958, notamment à Genève : <ref>Ruchat, M. (2006), L'émergence de la figure de l'enfant-problème dans le "champ" de l'éducation et de l'enseignement spécialisé: une construction sociale handicapante (Genève, 1912-1958). Traverse, 3, 100-112.</ref>:
Le « champ » de l'éducation spécialisée offre certes des innovations pédagogie individualisée, consultation, laboratoire, classe spéciale, institut médico- pédagogique, atelier), mais il s'inscrit aussi dans une tradition séculaire de mise à l'écart qui va des pestiférés aux criminels, en passant par les tuberculeux, les alcooliques et les enfants vicieux, et qu'on peut apparenter au XXe siècle à une forme d «eugénisme » scolaire et social, puisque sont exclus du lieu de la norme scolaire qu'est la classe ordinaire tous ceux qui ne peuvent être reconnus comme répondant aux normes.
Sur ces enfants, comparables à des cobayes, les médecins mettaient en œuvre, officiellement, des recherches sur le plan nosologique, afin de prouver leur différence, selon leurs constructions et interprétations, et donc légitimer leur exclusion. Comme le dénote l'auteure, on voit bien que ces constructions nosologiques, ayant un ressort social et historique, peuvent devenir caduques à une époque donnée : par exemple dans les siècles passés, les enfant exprimant inconsciemment leur sexualité étaient considérés, en quelques sortes, comme dégénérés. Ce qui est parfaitement absurde maintenant.
Les années 80 à 90 : l'émergence des nouvelles technologies médicales
Bioéthique en Suisse, notamment à Genève
Dans les années 80, les nouvelles technologies médicales (génétique, technologie médicale, robotique, etc.) prennent un essor considérable: c'est l'âge d'or. En 1980, l'éthique biomédicale en Suisse, notamment à l'Université de Genève, dans la recherche clinique, est enrôlée dans "la pratique médicale" et "les droits de patients". Des problématiques ont émergé peu à peu à cette époque tels que : "le système de la santé, l'accès aux soins, l'assistance au suicide, les nouvelles technologie dans les sciences du vivant (clonage, cellules souches embryonnaires, organismes génétiquement modifié,etc), ainsi que la naissance de neurosciences. Ceci représente la complexité de l'éthique biomédicale touchant la Suisse.
A la même époque, un scandales à Tuskegee aux Etats-Unis provoquera dans le monde la fondation des premiers centres académiques de bioéthique. Une étude sur les êtres humains pour traiter la syphilis mettra en lumière la mauvaise information des patients. Ces patients noirs, pauvres et illettrés suivront durant 40 ans (1932 - 1972) des expériences sur eux. Une bonne partie succombera aux effets de la maladie. <ref>Campus 100, "Bioéthique : la fin des généralistes" Biologie/Bioéthique, Université de Genève</ref>.
C'est en 1989 que naît en Suisse "La Société suisse d'éthique biomédicale" (SSEB). Suivant la vague américaine de "la professionnalisation de la bioéthique", la bioéthique se développe en Europe. Elle est la source source de débats autour du "génie génétique", du "clonage" et des "cellules souches". Cette société veille aux questions liées à l'éthique dans le cadre des recherches biomédicales. L'expérience scientifique sur les malades pose à nouveau la question de ses droits. Un sujet qui entraine moult débats et ne cesse pas d'attirer les critiques<ref>lire "Demi-dieux en noir et en blanc" de Margrit Kessler </ref> au niveau politique. Ces expériences ont, selon l'éthique protégeant le patient, besoin du "consentement de la personne". La communication du diagnostique et les résultats de l'expérience devraient être connus du patient, s'il a donné son consentement, mais c'est un sujet délicat et subordonné à des lois fédérales.
Pour les expériences scientifiques, le traitement proposé peut avoir comme source "les cellules souches embryonnaires" qui seront appliquées sur les patients malades avec l'espoir de trouver la guérison. Toute expérience devrait se faire d'abord sur les animaux puis sur l'homme, mais ce processus a soulevé aussi les protestations de certaines ligues de protection pour les animaux telle que La Ligue suisse contre la vivisection (LSCV) fondée en 1883 conformément à l'article 60 du code civil. Cette dernière propose l'abolition totale de ces expériences sur les animaux pour faire appel à toute méthode substitutive et alternative à l'expérimentation animale.
En 1990, on découvre "le génome humain"<ref>Qui est l'ensemble du code génétique humain</ref> et d'autres organes vivants. La technologie découvre qu'il serait possible de séquencer des brins d'ADN pour reconnaître ainsi l'unité de base du code génétique. Désormais on peut aussi stocker les informations génétiques, mais son dépouillement a tardé à se faire. En réalité même si le génome humain a permis à la biologie d'avancer, elle n'a rien révélé de fondamental, si ce n'est d'alimenter l'espoir à faire des expériences sur l'être humain : " [...] on n'a plus besoin d'animaux pour comprendre la biologie." <ref>Campus 100, "Le génome humain, un outil trop formidable"</ref>
Dans ces années, d'autres questions émergent donc il est extrêmement difficile de relever des données historiques, des associations combattant les excès de la recherche médicale en terme de génétique, de robotique humaine, de transhumanisme par exemple, sur l'être humain, notamment en Suisse. Premièrement, le développement de telles technologies demande des fonds économiques conséquents, une collaboration accrue entre experts dans différents domaines et une protection institutionnelle ou organisationnelle. Comment dès lors, des patients tout venant, des associations externes, comportant même des médecins, ont-elles les ressources nécessaires pour s'opposer contre de telles recherches, vu l'opacité de ses champs et le secret médical institutionnalisé, bénéfique pour le patient ? Toutefois, au niveau médiatique, on peut tout de même relever de nombreuses manifestations, autant aux Etats-Unis, qu'en Europe, contre la procréation médicalement assistée, dont en fin de compte il est difficile d'évaluer les effets à long terme. Encore une fois, les besoins en procréation assistée, existent dans la société. Mais ces technologies médicales demandent tout un savoir, un savoir-faire de la part du médecin. Vu le secret médical, il n'y a pas donc à disposition de revendications d'associations de patients, à même de faire reculer les autorités, ceci même en Suisse. Or, vu le secret médical nécessaire pour le patient, il est difficile d'étudier historiquement ces pratiques : il s'avère ardu pour des non-médecins ou non-scientifiques de questionner ces pratiques. C'est pourquoi, la période des années 80 à 90 qui a vu l'éclosion de la technologie médicale, est une période qui s'est opacifiée encore une fois, même internationelement. Suite aux expériences de la syphilis aux Etats-Unis, il fallait par exemple réglementer les expériences sur l'être humain à l'échelle mondiale. Les révélations du procès de Nuremberg montrant les horreurs de l'aire nazie, les crimes contre l'humanité dont les expériences faites sur les prisonniers juifs, montre à quel point le patient peut devenir une victime encore aujourd'hui.
Première émergence d'une association militante pour tous les patients, l'OSP (Fondation de l'Organisation suisse des patients) :
En 1981, à la même époque de la professionnalisation de la santé, Charlotte Häni s'engage pour les droits des patients suite à la mauvaise expérience vécue dans une clinique privée à Zurich où elle dénonce le non-respect de l'obligation d'informer le patient, le manque de soins et le constat de l'arrogance de médecins. Au fils des années, l'OSP a renouvelé sa mission pour parvenir à protéger les patients tant au niveau juridique, politique et social. En 1988, grâce à son intervention, l'OSP arrive, suite à la révision de la loi Lamal, à obtenir un droit de codécision pour les patients. De plus, en 1993, l'OSP assiste les femmes porteuses des prothèses mammaires en silicone, résultat du scandale mondiale initié aux Etats-Unis, en tout 1,000 femmes ont été prises en main par le groupe d'entraide. En outre, en 1993, l'OSP apporte son conseil à la demande de l'OFSP et de l'OFAS pour certaines publications officielles. Dans le monde pharmaceutique, en 2004, l'OSP défend des patients victimes du Vioxx (voir vidéo) du laboratoire Merck Sharp & Dhome Chibret qui produisait des infartus. L'OSP a fourni à l'opinion publique et aux autorités une remise en question au sujet des primes très hautes des assurances maladies, des prestations de soins et milite pour une médecine orientée vers le patient et pour que son opinion soit prise en compte concernant sa santé.
Convention sur les droits de l'homme et biomédecine, dans les années 90
Les progrès médicaux, technologiques et informatiques ont pris une grande ampleur ces dernières décennies. Au niveau européen, divers pays, dont la Suisse, ont dû, de ce fait, se concerter afin de poser des gardes fous, au niveau juridique, à l'avancée dans le domaines des sciences biomédicales; et par la même une protection accrue des patients est devenue davantage nécessaire en Europe. Suite à tous ces combats légitimes, les pays européens ont décidé de contracter une convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, à laquelle la Suisse a pris part. Il devient nécessaire d'internationaliser les droits, ainsi que des organes de contrôle, tout en prenant en compte le local, pour protéger l'homme contre ce types d'abus médicaux. En effet, il peut s'avérer très simple, au niveau Européen, de se rendre dans un pays afin de contourner les interdictions dans un autre pays. D'où la nécessité de la Convention européenne du 4 avril 1997 sur les Droits de l'Homme et la biomédecine <ref>voir aussi, la ratification de la Suisse, le 24 juillet 2008 [9]</ref>. Cette loi concrétise les droits fondamentaux à prendre en compte dans la médecine humaine. Relativement à cela elle concerne notamment :
- l’interdiction du clonage<ref>voir aussi, la ratification de la Suisse, le 24 juillet 2008 [10]</ref>
- la transplantation<ref>voir aussi, la ratification de la Suisse, le 10 novembre 2009 [11]</ref>
- la recherche biomédicale<ref>voir aussi, la Suisse n'a pas ratifier le nouveau protocole, elle se basse seulement sur l'art. 118b de la Constitution fédérale [12]</ref> et
- les tests génétiques<ref>voir aussi, la Suisse n'a pas ratifié ce protocole, elle se base à la loi fédérale sur l'analyse génétique humain (LAGH) [13]</ref>
En outre, le Conseil de l’Europe a formulé trois recommandations sur :
- la recherche utilisant du matériel biologique d'origine humaine<ref>voir ces recommandations en détails [14]</ref>
- la protection des droits de l'homme et de la dignité des malades incurables et des mourants et
- la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux.
Malheureusement, contrairement aux points précédents, ces recommandations n’ont pas de caractère contraignant au niveau juridique. En Suisse, à la fin des années 90, un projet de loi adopté par le parlement et voté en 2004, a permis désormais de créer des lignes de cellules souches à partir d'embryons humains surnuméraires issus des programmes d'insémination artificielles <ref>Campus N° 100 Les cellules souches embryonnaires à la source de l'humain. Biologie cellules souches. Université de Genève</ref>. Ces cellules permettraient de songer à soigner des maladies connues telles que le diabète, l'Alzheimer, le Parkinson, la tétraplégie, etc. et donne des espoirs à tant de malades. La Confédération suisse définit les informations concernant ce type de recherche sur l'être humain comme lacunaires même si une loi et les ordonnances sur l'article constitutionnel 118b, accepté par le peuple en 2010, entre en vigueur le 1 janvier 2014 !
Entre outre, des chercheurs ont réussi, sans faire la une des journaux, à remplacer les cellules souches à partir de cellules de la peau (les fibroblastes)pour faire des expériences scientifiques, à partir des IPS (Induced Pluripotent Stem Cells). Enfin, cette découverte pourrait permettre, pour des questions d'éthique, de renoncer à extraire des cellules souches, à partir d'embryons<ref>ampus N° 100 Les cellules souches embryonnaires à la source de l'humain. Biologie cellules souches. Université de Genève</ref>.
Quant aux médecins, à travers le FMH, le code de déontologie prévoit dans ses annexes des restrictions concernant l'expérimentation sur les être humains suivant les directives de l'Académie suisse des sciences médicales
Retour sur les entretiens
Pour porter la casquette de chercheur et explorer le thème des droits de la personne, nous avons choisi de procéder à des entretiens semi-directifs sur deux témoins de l’institutionnalisation de droits de la personne notamment des patients et qui ont œuvré dans une période de l'histoire pouvant nous raconter aujourd'hui leurs expériences. Comme pour tous les chercheurs de notre communauté de travail, nous avons posé les mêmes questions. Dans notre cas, nous avons fait parvenir ce canevas de questions à l'avance pour garder un cadre, et préparer nos témoins à revenir sur le passé, un passé si riche et vaste puis pouvoir ainsi se raconter avec des souvenirs plus précis. L'un de nos témoins, Mme Margrit Kessler (voir Index), a répondu spontanément à nos questions par écrit. Ses réponses nous ont permis d'anticiper et de préparer des questions de relance. L'interview se faisait en allemand, à Zurich<ref>au siège de l'OSP, adresse : Häringstrasse, 20 - 8001 Zurich</ref>, et méritait de préparer ces questions de relance à l'avance car l'entretien allait devenir de toute façon extrêmement long, si on traduisait au fur et à mesure chacune des réponses en français. De plus, une femme si engagée depuis une trentaine d'années pour les droits de patients et qui milite dans la politique, pour l'éthique, dans les associations, dans les commissions législatives, n'allait sûrement nous concéder énormément de son temps. Cette étape préalable, nous a donc permis de voir que Mme Kessler nous a offert plus de temps que nous l'avions pensé. Mme Kessler a répondu toujours avec clarté, précision, authenticité et énergie.
En ce qui concerne, M. François Loew , avoir les questions à l'avance (voir Index)lui a permis de corroborer son témoignage en revenant sur les premiers souvenirs qui lui sont venus librement, lorsqu'il a lu les questions. Il a pu ainsi déployer son témoignage encore plus que prévu, car il revenait sur ses traces écrites, souvent pour rajouter un autre fait. Son témoignage qui a eu lieu dans les locaux de l'Université de Genève a eu curieusement, comme étape préalable, un retour spontané sur l'histoire de patients durant la 2ème guerre mondiale. Puis petit à petit, nous sommes revenus sur les années de 80. C'est là où nous avons pu commencer l'interview. Le va-et-vient des questions ont fait que nous, collecteur-trice revenions sur nos souvenirs de statut de patient ou celui de nos proches.
Mise en relation de deux entretiens
Pour ce qui est l'analyse des entretiens de Mme Magrit Kessler et de M. François Loew, nous allons procéder à une mise en lumière en lumière des thématiques communes et divergentes en les renvoyant à chacune des cinq questions posées lors de l’interview.
Début de l'engagement pour les droits des patients (propos des réponses à la question 1)
D'emblée, nous avons constaté que les contextes de travail pour les interviewés diffèrent. Nous pouvons apercevoir ainsi que l'un, le Dr. Loew s’engage de près avec le contexte gériatrique, en tant que médecin chef adjoint à la policlinique de gériatrie (dirigé par le Professeur Rapin) de l’HUG. C’est à partir de son travail de certification et à la suite d’une formation en éthique qu’il s’est intéressé aux « directives anticipées ». Ses préoccupations pour le respect des droits des patients s’initient en 1997-1998. Médecin d’expérience, il s’est occupé de Président et la commission d’éthique d’Etablissements médico-sociaux (EMS) dans le canton de Genève. De surcroît, il est actuellement formateur en éthique auprès des médecins. Tandis que Mme Kessler a débuté son engagement en tant qu'infirmière. Dans le cadre de ses fonctions durant les années 90, elle était témoin des expériences illicites sur les patients à l'hôpital de Saint-Gall <ref>à l'encontre du Professeur Jochen Lange</ref>. Dès 1990 alors, elle devient directrice pour la SPO. En 1996, elle a assumé le rôle de conseillère et Vice-Présidente de la SPO. Puis à nouveau elle s’enrôle dans le poste de Présidente de la SPO. Plus tard, en 2011, elle est élue conseillère nationale de Saint-Gall pour le parti vert. C’est au niveau fédéral qu’elle milite toujours auprès des autorités en les sensibilisant aux violations des droits des patients.
L'expérimentation médicale sur les patients (propos des réponses pour la question 2)
Mme Kessler était marqué par un événement dramatique dans sa vie de militante, le fait de devenir témoin des expériences illicites sur des patients de l’hôpital de Saint-Gall en Suisse durant les années 90 et de constater la mort d’une patiente. Cette expérience transgressant la loi, lui a valu dix ans de procédure à l’encontre du médecin-chef de l’hôpital de Saint-Gall pour avoir appliqué une substance toxique. La patiente morte suite aux essais médicaux, était affectée d’une occlusion intestinale et avait reçu lors de son opération, 120 ampoules du bleu de méthylène dans le ventre. La perspective du médecin était que la patiente n’ait plus ces occlusions intestinales. Il a fallu que la presse apprenne les événements pour que cela devienne un scandale et que la procédure s’ouvre à l’encontre du médecin-chef. Dans ce cas, la patiente morte suite aux séquelles de l’essai n’était pas du tout informée, il lui a été dit simplement qu’un liquide bleu allait lui être appliqué. C’est pourquoi après 10 ans de procédure, l’OSP milite pour que les patients soient informés. A la fin du procès Mme Kessler a été condamnée par les chefs d’accusation pour dénoncer ce médecin-chef. Mme Kessler donne l’impression d’avoir tiré une leçon ou plutôt un constat. Elle dit : « vous savez il a plus d’argent et qui c’était plus fort c’était le professeur, moi j’étais une soignante et j’ai eu l’insolence de mettre en doute ses expérimentations » . Cependant, Mme Kessler fait un autre constant par la suite que si elle n’était pas intervenue, les expériences ne se seraient pas arrêtées. D’ailleurs, elle a soulevé des incongruences dont le parlement où une motion était déposée. La réponse du Parlement était que ce type de cas ne rentrerait pas dans la loi sur la recherche d’êtres humains. Alors, elle se demande « à qui appartient de voir de près ce cas ? » Or, c’est plutôt l’académie suisse qui a établi une directive adressée aux sujets succombant aux expérimentations illicites et qui est en consultation actuellement pour être publiée l’année prochaine. Mme Kessler ressort une conclusion paradoxale comme est-ce que la ELGK (Commission fédérale des prestations générales et des principes), en tant que commission d’éthique malgré qu’elle l’avait condamné, lui a octroyé aujourd’hui sa confiance d’autant plus quand elle est devenue membre de cette commission d’éthique fédérale.
En parlant de ces expériences, le Dr. Loew commente qu’il existe la recherche de mieux soigner à savoir « la recherche de l’amélioration de la personne » dans laquelle le médecin va offrir au patient toujours le mieux possible. A commencer par, « s’il existe une nouvelle technique, un nouveau médicament qui a été validé du point de vue scientifique d'une étude ou de plusieurs études qui montrent depuis, que le médicament a été accepté, dans la liste des médicaments officiels », il sera proposé au patient. La recherche du mieux soigné serait une « tendance naturelle des médecins de toujours proposer quelque chose » et sa limite serait « l’obsession des médecins». Dans ce sens, « l’acharnement »serait de proposer à tout prix un traitement, pour se donner bonne conscience, mais il pourrait être inefficace. Le Dr. Loew revient à nouveau sur ce type de recherche et le besoin de « communiquer » avec le patient et surtout « la manière de proposer quelque chose » pour ainsi garantir l’obtention d’« un consentement libre et éclairé ».
Le rôle de consultants en matière de droits du patient, les directives anticipées et les protocoles (propos réponses élargissement à la question 2)
Dans le contexte de son rôle en tant que consultant de l’OSP, Mme Kessler nous parle des protocoles au sujet des expérimentations sur l’être humain. Elle nous mentionne qu'ils existaient depuis 1990 seulement, en attendant la loi pour une commission d'éthique pour chacun des cantons, née en 1992. Ces commissions allaient analyser les protocoles propres à leur canton. Pourtant avant cette période, c’était l’Académie suisse de médecine "qui avait une espèce de commission d’éthique et lorsque des questions survenaient elle les traitait mais c’était seulement des professeurs dans leur "tour d’Ivoire"". Un aspect positif de cette académie suite aux événements de Saint-Gall a été d'établir une directive au sujet des expérimentations illicites qui est actuellement en consultation et à publier l’année prochaine. Ce type de directive est défendue par les tribunaux qui d'une autre façon défend aussi ardument le droit d’être informé, au sujet des patients. De manière semblable, pour le Dr. Loew, le contexte de son rôle en tant que consultant repose sur les directives anticipées . Ces directives sont « une extension du droit fondamental de la personne à disposer d'elle-même ». La personne va indiquer par écrit « ce qu’elle veut ou ne veut pas dans les soins. Ceci dans le cas où elle n’aurait pas sa capacité de discernement ». C’est en réalité le consentement informé, libre et éclairé du patient pour qu’un acte médical sur lui soit fait. Acte médical qui est « une atteinte à l’intégrité physique ». Ces directives reposent sur le consentement de la personne qui peut être d’ailleurs « tacite » par exemple quand le patient suit des soins dans un cabinet. Il est entendu implicitement que si le patient arrive dans un cabinet pour se soigner, le médecin ne lui demandera pas son consentement et appliquera par exemple une piqûre. Ces directives ont vu le jour car avant on s’en passait du consentement du patient. Vu « l’attitude paternaliste » du médecin dans les années 40-50 car on ne mettait pas en cause le bien-fondé de cette pratique où s’aller de soi, que les médecins soignent sans poser la question aux patients. Le médecin, en demandant le consentement du patient, ce dernier donne son accord pour se faire soigner. C’est dans ce socle que les directives anticipées se sont reposées car il s’agit d’un droit, celui d’écrire son consentement, si par hasard la personne tombait dans le coma par exemple. Dans le milieu gériatrique, ces directives interpellaient le Dr. Loew car il y avait des conflits concernant les représentations de médecins et des proches pour les directives concernant un patient. Ces directives auxquels, le Dr. Loew a pu être témoin prétendent protéger les patients en évitant « l’acharnement des médecins ». Cependant, ces directives sont loin d’être « un outil de promotion des droits ».
Apprentissage des droits de patients aux médecins (propos réponses élargissement à la question 2)
Pour commencer, les droits des patients ont tardé à être préservé par la Commission d'éthique notamment quant aux expérimentations faites sur l'être humain en Suisse. Dans la même mesure, Mme Kessler a révélé que les droits des patients ne sont pas internationaux par un concours de circonstances. Ce sujet vaut la peine d'élucider dans un autre travail pour comprendre ses incidences sur le plan national. C'est en revenant sur le territoire helvétique qu'il pourra être observé qu'en Suisse malgré tout, les droits de patients sont renforcés, , en comparaison aux autres pays d'Europe. Puis de voir que dans la formation des médecins, il est devenu d'actualité d'inclure dans leurs formation les thèmes concernant : l'éthique, l'information aux patients, le consentement du patient, etc. En Suisse, l'OSP sous la direction de Madame Kessler propose ces thèmes, en formant médecins, infirmières et même les représentants des assurances de santé. C'est pourquoi le corps médical fait confiance à l'OSP et sa réputation continue à s'élargir. Cette institution persévère et milite pour les droits de tous les patients du pays.
Pour ce qui est les dimensions des droits de patients, telles que "l'acharnement ", le Dr. Loew nous remarque que ce sujet n'est pas inclue dans le cursus de formation de médecins. Cet "acharnement" spécificité déjà dans ce texte,et de près géré par "l'écoute" attentive prêtée par les médecins aux patients leurs des consultations. A contrario, les valeurs tant personnelles comme institutionnels sont travaillées par le Dr. Loew lors de ses cours aux médecins afin de les lier aux représentations provenant de la part du patient. Ce médecin sensibilise énormément les médecins en formation continue aux gestes appliqués sur les patients à partir du moment où le médecin les touche pour par la suite leur apprendre à attacher de l'importance à la relation médecin-patient. Il est recommandé aux médecins de poser les questions adressées à l'état physique du patient et à ses ressenties pour mieux se représenter sont état de santé.
Des changements liés aux engagements communs de nos deux interviewés : l'éthique, "le consentement" et "l'information" aux patients (propos des réponses à la question 3)
En premier lieu, la première commission d'éthique nationale en Suisse qui d'après Mme Kessler existe depuis très tard, seulement en 2002 au même temps que "la loi sur les médicaments" et "la loi sur les essais de médicaments", tandis que dans les cantons ces commissions existaient auparavant. La commission d'éthique cantonale veille ainsi à ce que les protocoles de recherche sur l'être humain soient respectés donc toute expérience a besoin de l’aval de la Commission d’éthique cantonale avant de débuter une expérience quelconque.
En deuxième lieu, l'information aux patients est selon Mme Kessler l'un des changements le plus importants dans l'histoire du patient. C’est dû principalement au fait que ce sont les médecins qui ont le fardeau de la preuve. Si on revient en arrière, durant les années 60 - 80, les patients n'étaient pas informés de soins à suivre que lorsque des grands blessures avaient lieu. Néanmoins, elle souligne que certains patients étaient encore opérés sans leur consentement. Ce qui n’est plus le cas à présent. Informer le patient fait part des protocoles d'éthique et le médecin est conscient qu'il est pénalisé s'il ne respecte pas cette instruction. Le fardeau de la preuve revient au médecin c’est-à-dire prouver qu'il n'a pas fait le contraire à savoir la non-information au patient de soins à suivre. Paradoxalement, si le traitement se passe mal alors le fardeau de la preuve revient au patient. Ce qui est extrêmement difficile, car devant les tribunaux il faut des preuves, des faits prouvés pour accuser un médecin. Ce qui est difficile ! C’est pour cette raison que l'OSP se bat pour que le patient en cas d'expériences médicales sur lui soit informé par deux voies, la voie écrite et la voie orale et seulement une fois qu’il a pris conscience du type d’expérience qu’on fera sur lui, le traitement, le diagnostic alors à ce moment-là il peut accepter ou pas. C’était d’ailleurs, le manque d’information au patient qui poussera la fondatrice de l’OSP, Mme Charlotte Häni a fondé une association fédérale pour militer pour les droits des patients. en Suisse.
En troisième lieu, pour ce qui est le Dr. Loew, l’un des changements importants pour les droits des patients d’après son expérience était l’obsession de la part des cadres, des professionnels responsables du respect de la volonté de la personne » . Certains médecins informent d’une manière catastrophique les patients, en ne se préoccupant pas de ce que la personne connaissait déjà ou ses inquiétudes. Pour donner un exemple : « voilà je vous propose une oeso grastro duodénoscopie, ça dure tant de temps, ça permet de voir ceci cela, ça permet peut-être de lever l'obstacle, il y a quand même un risque de faire une péritonite biliaire, il y a quand même un risque de ceci cela, voilà est-ce que vous êtes d'accord ? », le médecin a respecté la loi certes mais la manière de dire les choses font que le consentement du patient soit atteint à tel stade qu’il n’est plus libre et informé parce qu’on n’a pas pris en compte la dimension psychologique de la personne.
Une autre dimension est la clarté du discours du médecin qui n’est pas simple et accessible. Les patients peuvent avoir l’impression d’avoir compris mais en réalité ils sont besoin des explications et d’ailleurs, un médecin peut se tromper. Quant à ce sujet, si on expose des cas peu connus, le médecin peut se trouver face à une incertitude diagnostique souvent en lien au série des manifestations du patients et qui même aux yeux de plusieurs médecins, les avis seront divergents. Plusieurs médecins peuvent contrairement à ce qu'on pense, être malheureux « surtout pour certains cancers » car en termes de guérison ou de stabilisation il y a peu d’espoir.
En quatrième lieu, le Dr Loew nous parle du développement des soins palliatifs, le corps médical a été formé pour arrêter de dire : « maintenant c'est fini, on ne peut plus rien pour vous » et aussi pour connaître les traitements stabilisant, le cancer et les métastases mais également pour « proposer des médicaments » limitant les douleurs, les nausées. Ceux-ci visent à calmer les symptômes. Ces soins permettent aux patients en fin de vie de « régler des problèmes avec ses proches, être entouré » par des gens qu’ils aiment, etc. Tout ceci suit le mouvement des hospices anglais en Angleterre, durant les années 80, que ces derniers traitaient les douleurs et contrario les hôpitaux traditionnels où les gens avaient mal, on ne soignait pas la douleur.
Des valeurs mises en première ligne (propos des réponses pour la question 4)
La conseillère nationale a avoué que la valeur qu’elle a tissé « c’est la confiance de la population ». Confiance qui ressort dans le travail fourni aux patients par l’OSP dont elle est Présidente. Par ailleurs, la conseillère nationale met en pratique par le biais de sa fonction en tant que Présidente de l’OSP des valeurs qu’elle appellera « des piliers » telles que le conseil au patient, l’information (conférences, cours…) et la représentation des patients devant la ELGK (Commission fédérale des prestations générales et des principes), la commission fédérale pour les médicaments, la commission d’éthique où une organisation militante comme l’OSP peut siéger. Ces piliers ont des limites, ceux de constater que les questions de santé est une affaire vaste et d’ailleurs cantonal, c’est pourquoi l’OSP par exemple n’arrive pas à répondre à tous les cas-problèmes des patients. La valeur d’entraide aux patients est passée même à soulager les frais des tribunaux produits par les procès. Un dernier constat pour la conseillère nationale est de voir que la confiance vient ne seulement des médecins et des patients sinon également des autorités.
L’un des valeurs mis en première ligne pour le Dr. Loew était d’apporter « une grande importance à l’écoute des gens, à écouter ce qu’ils disent » avant de leur parler. Pour ce médecin de longue carrière, il nous dit que « pour communiquer avec quelqu’un il faut d’abord écouter ». Cela ne va pas de soi car pour écouter le patient, il y a besoin de « prendre le temps » nécessaire. Ecouter veut dire savoir ce que la personne pense sur son état, sur ce qu’elle souhaite, sur ce qu’elle ressente de son corps. C’est une condition pour avoir la confiance du patient, se donner le temps de l’écouter et de laisser la manière « technologique et classique » de proposer les traitements. A propos de « l’écoute », le médecin pourra en l'appliquant connaître même les représentations du patient quant à « l’acharnement », le pourquoi de son attitude, le souvenir d’une expérience passée, etc. En fait, il s’agit de savoir quel sens donne ce patient derrière le mot acharnement. Ceci est possible dû au temps d’écoute apporté par le médecin, en sus, en lien avec « l’histoire personnelle du patient » et ses mots. Laisser parler le patient permet de voir pour un médecin ce qui correspond le mieux pour son traitement. En outre, l’écoute quand il s’agit d’une équipe de soins, ses membres doivent s’écouter. Cette écoute conduit à « la démocratie délibérative » qui consiste à prendre en compte chacune des observations des membres du personnel soignant pour y réfléchir ensemble au traitement du patient.
D’autres valeurs pour ce médecin, étaient le respect de la personne, le respect de soi, la connaissance de soi. Ceci dit que les médecins doivent être clairs avec soi-même, avec ses valeurs avec le respect à autrui pour être de bons professionnels. Les médecins et les patients rentrent dans une espèce de négociation commune qui est la confrontation des valeurs qui a deux sens. Le médecin est satisfait et le patient aussi quand ils sont vraiment d’accord. Nous citons que des valeurs travaillaient par le Dr. Loew dans les formations professionnelles des médecins sont les valeurs personnelles , les valeurs professionnels , les valeurs de l’institution , etc.
Les combats en tant que militant (propos de réponses pour la question 5)
Même si la lutte est très dure pour Mme Kessler, elle et son association continuent de se battre pour les droits des patients. Au sein du parlement, elle souhaite continuer à s'investir. Autrement, un autre de ses derniers combats, c'est la donation d'organes. Mme Kessler, nous témoigne qu'il s'agit des mesures chirurgicales préparatoires appliquées sur les patients mourants avant le prélèvement d’organes. Elle dénonce que les donateurs d’organes ne sont pas au courant vraiment sur quoi ils s’engagent lorsqu’ils acceptent de céder ses organes. Sur le carnet de donateur, ils cochent une croix, certes, mais à l'intérieur de ce carnet il n'est pas explicité, le type de traitement chirurgical qui suivra pour maintenir les organes en vie. En effet, le patient est débranché et la mort cérébral arrive cependant les médecins souhaitent faire le prélèvement que quand quelques vaisseaux irriguent encore le cerveau c'est pourquoi: "ils veulent faire des perfusions, introduire des tubes, afin qu’ils puissent brancher une machine de manière à préserver les organes" mais Les patients sont encore mourantes. Qui peut déterminer alors qu’on n'applique pas une souffrance à ces êtres humains ? car ces gens ne sont pas encore morts cérébralement. Mme Kessler avertie qu’on pense plus aux donateurs sinon plus aux receveurs d’organes. C’est en constatant que même les proches du donateur ne peuvent pas empêcher l’acharnement qui peut avoir sur le corps du patient, qu’elle a décidé de continuer à s’investir pour la révision de la loi sur les transplantations. Mme Kessler constate encore une fois que si cette affaire de la donation d’organes s’est faite public, le lendemain, il n'aurait plus de donateurs d’organes, vu les conditions dans les lesquels les mesures chirurgicales préparatoires ont lieu.
Un fuite en avant plutôt qu’un retour en arrière (propos de réponses pour la question 5)
Pour un autre pionnier de l'histoire des patients,le Dr. Loew, il nous fait part de sa réflexion sur la technologie qui a amené à croire au progrès éternel. Nous serions à son avis, comme dans une science fiction où il y a une fuite en avant et on se perd, on ne sachant pas où on va. Les gens veulent vivre plus longtemps même jusqu'à 100 ans. Il y a même des gens qui réalisent tard l'envie de vivre et déjà âgé veulent vivre plus longtemps. Cependant, à présent, pour le Dr. Loew "les droits de gens" sont mieux respectés" mais ces personnes ne connaissent pas le sens de leurs droits. Si on revient vers l'attitude paternaliste citée plus haut et si nous regardons le présent, nous constatons que les patients ont d'autres questions. Ces questions touchent par exemple le sens de la maladie et les personnes aperçoivent que la vie est limitée. Puis il y a une fin même si difficile à accepter pour nous tous, les patients!
Mise en relation avec les droits de la personne
L'engagement d'une femme infirmière face à la médecine : donc l'engagement d'une double minorité symbolique, c'est-à-dire une femme, hiérarchiquement en-dessous des médecins
Nous pouvons dès à présent mettre en lien ce qui précède avec d'autres articles concernant les droits de la personne. Premièrement, nous remarquons avant tout que les droits de la personne émergent véridiquement du combat de minorités. Par exemple, notre première interviewée, Madame Margrit Kessler, en tant que militante pour les droits des patients, a dû se battre contre des médecins, hiérarchiquement au-dessus d'elle, médicalement parlant, une opacité y régnant, masquant même des dérives éthiques au niveau de l'expérimentation sur l'humain. Ce qui n'a pas été observé par notre premier interviewé M. Loew, ancien médecin, progressiste en matière de droits des patients. Elle exerçait, dans le domaine de la santé, la fonction d'infirmière, avant d'atteindre des sommets comme conseillère nationale. En plus de cela, il faut noter qu'en tant que femme, elle était déjà très sensibilisée aux inégalités sociales. Ceci n'est pas sans lien avec l'article sur les droits des femmes qui s'est davantage centré sur la lutte qu'elles ont partiellement remportée, pour le droit à l'avortement et plus largement pour le droit à leur intégrité physique.
Les patients psychiatriques sont très souvent des patients enfermés dans des hôpitaux. Cette situation d'enfermement est d'ailleurs vécue également par les prisonniers
Quant aux droits de patients psychiatriques, l'ADUPSY (voir droits des patients psychiatriques) est née à Genève pour protéger des patients dans les années 70, contre les dérives psychiatriques. C'est au niveau des patients psychiatriques que les dérives médicales ont été davantage visibles, dans la période opaque des années 60 à 80. Autant, suite à la deuxième guerre mondiale, les horreurs médicales nazies ont éclaté au grand jour; autant dans cette période opaque, c'est au niveau psychiatrique, que les dérives institutionnelles se sont révélées les plus saillantes. Ces dérives institutionnelles sont d'ailleurs critiquées par des auteurs militants comme Foucault. Il nous montre que le fou est une figure inquiétante dans la société. Il esquisse les grandes étapes du rapport de la raison à la folie, de la fin du Moyen Age, jusqu'à la naissance de l'asile au XIXème siècle. Le fou à cette époque remplace le lépreux du Moyen Age. Il devient un personnage social majeur inquiétant. Après la Renaissance, laissant une certaine liberté de parole au fou, ce dernier sera réduit au silence à l'âge classique. Il est ainsi interné aux côtés des inactifs, des délinquants, des criminels, des marginaux dans des centres d'isolement et de travail. Les droits des prisonniers ont donc un lien étroit avec la problématique des droits des patients à l'hôpital : le criminel est mis de côté et contrôlé dans un lieu fermé. L'internement n'a donc pas uniquement des motifs d'ordre médicaux, mais aussi sociaux et économiques. Mais ce contrôle social, vers la fin du XVIIIème siècle, s'avère tout de même coûteux, autant pour la société que pour ces individus marginalisés. Les asiles vont désormais accueillir que des malades mentaux. C'est donc l'émergence de la notion de "maladie mentale". Le fou n'est plus un délinquant et va se trouver enfermé seul. A ce sujet, Foucault reproche à la psychiatrie d'être qu'un monologue de la raison sur la folie.
En ce qui nous concerne, actuellement, au XXIème siècle, nous avons retenu ce passage de l'article parlant des droits des patients psychiatriques : " le troisième objectif concernant les droits liés au traitement et à la participation à la recherche médicale implique l’abolition de tout traitement médical sans le consensus du patient. Il faut présenter au patient les implications du traitement, les alternatives et s’il veut il peut consulter un autre médecin de son choix".
Le patient : une minorité symbolique, tout comme l'enfant ou la personne en situation d'handicap
Nous pouvons affirmer suite à l'entretien à Zürich, avec la conseillère nationale Margrit Kessler, que les patients ne sont pas protégés, en fait, contre les expériences médicales, au niveau juridique. Récemment en Suisse, il y a eu, devant les instances juridiques, une procédure pénale pour l'utilisation d'une substance toxique sur des patients, donc des expériences médicales illicites menées sur eux. Le médecin qui était accusé est sorti indemne, car le fardeau de la preuve appartient au patient et non pas au médecin. Entre le médecin et la patient, il y a donc dissymétrie d'information, de connaissance et de protection des autorités, en faveur de l'expert médical. Comparé au médecin, le patient est une minorité symbolique, tout comme les femmes comparées aux hommes, les marginalisés, les patients psychiatriques comparés aux psychiatre. Comme nous l'avons vu, il en est de même pour les enfants, évoluant dans la société ou à l'école, ainsi que les personnes en situation de handicap:
- enfermement et surmédicalisation d'enfants en situation de handicap,
- ergonomie des villes non adaptée aux personnes en situation de handicap,
- besoin élémentaires, comme la sexualité, non satisfaits pour des personnes en situation de handicap.
Conclusion
L'usage de wiki c'est avéré fort heuristique :
- parce qu'il nous a permis de nous insérer dans une démarche d'intelligence collective appréhendant le droit des personnes.
- parce qu'il nous a permis de communiquer nos pensées, et même d'échanger, autant avec les autres groupes d'étudiants, qu'avec un grand nombre d'internautes.
- parce qu'il nous a permis d'archiver un grand nombre de documents.
Suite à nos recherches historiques, au travers des lois, des différents documents de différentes associations, de nos entretiens, nous sommes arrivés à la conclusion que la législation en vigueur ne permet pas de lever l'opacité sur les expérimentations médicales. L'entretien de Mme Kessler, conseillère nationale et militante pour les droits des patients, a bien montré qu'actuellement encore des patients ont été traités comme des cobayes au sein de l'hôpital. Il suffit de regarder, le téléjournal télévisé, pour comprendre que l'industrie pharmaceutique est très puissante et que sous couvert de guérir l'homme. Elle procède à des expérimentations sur les humains, non sans risque de dérives. Les médecins eux travaillent souvent avec ces industries et donnent leurs médicaments aux patients. Rien qu'à ce niveau c'est ambigu ! Comment freiner ces dérives ? Foucault disait qu'auparavant les malades étaient soignés dans leur maison familiale. Maintenant, les patients nécessitant des soins massifs sont soignés dans les hôpitaux, où sont très souvent présents des chercheurs en médecine ou en biologie. Comme le dit l'auteur, le regard du médecin est connaissance, dès lors même un médecin qui soigne un patient dans un hôpital peut s'engager, intérieurement, dans une phase de recherche médicale implicite. Le patient ne peut pas lire dans ses pensées, l'intention du médecin à son insu pour mener une recherche scientifique.
Quelle solution peut-on envisager ?
La dissymétrie d'informations et de connaissances entre le médecin et le patient, au profil du premier, étant réelle, le patient tient en quelque sorte une figure de minorité dans la société, si l'on considère l'état de minorité, comme une faiblesse ou une inégalité construite, instituée et acceptée socialement, en tout cas tolérée. Tout comme la femme, l'enfant, le patient psychiatrique, le patient est encore minoritaire en Suisse, comme nous avons pu le constater en lisant les articles des autres groupes. Pour reprendre la vision d'Illich, un gros effort éducatif et informatif s'impose, destiné à tout le monde, en dehors de structures stigmatisantes et inégalitaires, ceci globalement, au niveau de toute la société, même au niveau mondial, afin que l'homme se réapproprie cette connaissance sur lui-même.
Notes et références
<references/>
Voir aussi
Droits des patients psychiatriques
Droits des personnes en situation de handicap
Bibliographie / Webographie
- Besnier, J-M. (2011). « Les nouvelles technologies vont-elles réinventer l'homme ? », Études, vol. 414, no 6, p. 763-772.
- Basaglia, F.(1970). L'institution en négation. Paris: Edition du Seuil.
- Castel, F. (1976). L'ordre psychiatrique : L'âge d'or de l'aliénisme. Paris : Minuit.
- Cooper, D. (1970). Psychiatrie et anti-psychiatrie. Paris: Du Seuil.
- Duruz, N. (1994). Psychothérapie ou pychothérapies ?. Neuchâtel : Delachaux et Nestlé.
- Foucault, M. (1963). Naissance de la Clinique. Paris : PUG.
- Foucault, M. (1975). Surveiller et punir. Paris : Gallimard.
- Illitch, Y. Une société sans école (1971). -> Résumé
- Kessler, M. (2009)."Halbgötter in Schwarz und Weiss", Rückblick auf einen Medizinskandal, der zum Justizskandal wurde. Zurich : Editions Xanthippe.
- Ponchon, F. (1999). Les droits des patients à l'hôpital. Que sais -je?. Paris : Editions Puf.
- Recueil de droit fédéral suisse : http://www.admin.ch/bundesrecht/00566/index.html?lang=fr
- Site internet de l'ONU, déclaration universelle des droits de l'homme : http://www.un.org/fr/documents/udhr/
- Site de la Confédération Suisse => convention européenne sur les droit de l'homme et la bioéthique : http://www.ejpd.admin.ch/content/ejpd/fr/home/themen/gesellschaft/ref_gesetzgebung/ref_abgeschlossene_projekte0/ref_biomedizin.html
- Wikipédia : droit de l'homme au niveau Européen : http://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_europ%C3%A9enne_des_droits_de_l'homme
- Wikipédia : transhumanisme => http://fr.wikipedia.org/wiki/Transhumanisme
Que sont les droits de la personne entre 1960-1980?
En conclusion, nous pouvons constater que les droits de la personne dans des domaines différents se sont construits socialement et historiquement à partir de revendications de minorités (ou des porte-parole de minorités dans le cas des enfants ou des personnes qui n'auraient pas leurs responsabilités juridiques), respectivement:
- les enfants
- les femmes
- les prisonniers
- les patients psychiatriques
- les personnes en situation de handicap
- Les patients dans les hôpitaux (victimes d'abus d'expérimentation).
Des acteurs se sont donc mobilisés pour que ces personnes puissent acquérir les mêmes droits proclamés d'abord dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, puis dans différentes lois, règlements et chartes. Les différents chapitres écrits par notre communauté de travail montrent tous que les personnes militantes se sont mobilisées pour le droit à l'intégrité physique (femmes, prisonniers, patients) mais aussi pour le droit à l'autodétermination (personne en situation de handicap et patients psychiatriques) et également pour le droit à la parole, à l'écoute ou à une place reconnue dans la société (notamment pour les femmes – droit de vote et les enfants – droit à la parole –). C'est d'abord un traitement égal que ces minorités veulent obtenir, lequel suppose l'émancipation et la reconnaissance de leurs droits, en tant que personnes, en tant qu'êtres humains avec les valeurs qui s'incarnent dans des pratiques relationnelles (le respect, la transparence, l'égalité, etc.).
Souvent, ces revendications ont été faites suite à une remise en question des institutions ou plus globalement de la société.
Les années 60-80 témoignent de changements importants. Bien évidement leurs prémisses remontent en-deça de cette période comme c'est le cas des droits de l’enfant en tant que personne. Le chemin vers son individualisation a été bien avant 1968, une devise dans le travail éducatif et juridique de Jean-Pierre Audéoud lequel, avec une participation active de sa femme, a pu l’appliquer durant son parcours professionnel. Mais l’histoire retrace également la construction des droits des femmes, lesquelles, encore aujourd'hui, revendiquent leur droit à l’avortement ou à des salaires égaux à celui des hommes. Leurs rôles sociaux, loin du stéréotype de la mère au foyer, font leur chemin. La lutte pour l’égalité des femmes est en perpétuelle évolution, et encore au XXIème siècle. L’entretien avec Amélia Christianat en est une preuve. Son parcours militant en faveur des droits des femmes impressionne. Un combat important qui vise, comme dans le cas des droits de l’enfant, une reconnaissance non seulement tout à fait méritée, mais juste.
Il faut dire que la reconnaissance en matière des droits des personnes est un processus long et complexe. Notre société accepte certains changements et s’oppose à d'autres. Cela a été le cas durant les deux décennies prises en compte par notre recherche pendant lesquelles d'autres droits sont revendiqués tels que les droits des patients ou patients hospitaliers, des prisonniers et des personnes en situation de handicap . Tout individu avec son identité propre avec ses forces, ses faiblesses, ses différences, doit se battre afin d’être accepté à part entière par la société dont il fait partie
: c'est cela les droits de la personne.
Néanmoins, un certain nombre de constats peuvent être relevés:
- Pour avoir des droits, il faut se battre pour les obtenir; c'est une lutte permanente; ce n'est jamais acquis.
- Le temps de la construction des droits est un temps long pour les promoteurs, mais un temps court dans l'histoire de la démocratie et de l'humanité (1789).
- l'égalité des individus quelques soient leur situation comme personne (droit à la parole, droit à l'intégrité physique, droit de vote, dignité, consentement, participation, etc.) demande une prise de conscience du public: ce n'est pas évident (notamment pour des populations incarcérées).
- la revendication de droits pour des populations "marginalisées" (patients psychiatriques, handicapés, prisonniers) demande un changement de "posture" épistémologique, idéologique, politique.
- les droits de l'homme et du citoyens représentent les prémisses des droits accordé à l'être humain. Puis, il a eu les droits envers des populations spécifiques, plus ou moins dans cet ordre dans ceux que nous avons traité: enfants, femmes, prisonniers, patients psychiatrique, handicapés, patients à l'hôpital. On peut penser que cette revendications de droits spécifiques est dû au fait que les droits de l'homme ne suffisaient pas à soutenir les réalités de vie des populations citées, d'où les luttes pour faire valoir leurs droits particuliers. Ainsi, peut-être sommes-nous passés des droits de l'être humain aux droits de la personne?
- L'importance de faire valoir ses droits (les connaître, les faire respecter, participer à leur application).
- Sur la question des droits, le risque est toujours présent de régression.
Le contexte: climat économique, contingence sociale et politique, "esprit du temps" de l'après-guerre. Quid d'aujourd'hui ?
A travers nos différents chapitres sur les droits des personnes, nous avons constaté que toutes les mobilisations ont émergé à la suite de la seconde guerre mondiale. En effet, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (10 décembre 1948), a permis de lutter contre les injustices qui se faisaient à l'encontre des populations marginalisées (enfants, femmes, prisonniers, personne en situation de handicap, patients psychiatrique et patient à l'hôpital). Plus particulièrement, le jugement de Nuremberg a joué un rôle fondamental, lorsque les médecins nazis ont été condamnés pour avoir causé l'humiliation, la séquestration, l'expérimentation médicale et la mort de minorités. D'ailleurs l'action de la population juive a été déterminante dans la promotion des droits humains. L'émergence des revendications de l'après-guerre en matière d'égalités des femmes, de protection de l'enfant, de droit des patients en psychiatrie, ainsi que de droits des prisonniers prennent pour cible la société de type capitaliste, inégalitaire – et dans laquelle les écarts socio-économiques tendent à se creuser – et ses institutions, dites alors "totalitaires".
Le contexte de l'époque était favorable à des revendications, manifestations et soulèvements de populations pour les droits des opprimés. D'ailleurs, la bonne croissance économique y a beaucoup contribué, car lorsque tout va bien pour les gens ne sont-ils pas prêts à aider les plus démunis ? Certains témoins interrogés laissent entendre que lorsque la société est en période de crise, les droits des personnes acquis durant cette période (1960-1980) tendent à régresser.
La lutte pour le droit des personnes (enfants, femmes, prisonniers, patients ...) a duré pour la plupart plus de trente ans. Parfois les acteurs se sont investis du début jusqu'à l'acquisition de ce droit ; dédiant une grande partie de leur vie à ce projet. C'est pourquoi, marquée de luttes, la construction des droits de l'homme est un temps long pour ces promoteurs, mais si nous le plaçons sur un axe temporel plus large, ces luttes ne constituent qu'une courte période dans l'histoire de l'humanité.
C'est en fait la lutte d'associations de minorités qui va être à l'origine de la reconnaissance de ces droits. Sans cette lutte point de progression pour l'humanité. Nous remarquons, plus que jamais, aujourd'hui, que cette lutte est permanente et n'est jamais acquise. Plusieurs acteurs, que nous avons eu la chance d'écouter, nous ont rappelé l'importance de se mobiliser pour que ces droits restent actuels. Pour eux, la lutte ne doit cesser puisque sans une mobilisation de notre part, les droits qu'ils ont acquis durement, vont rapidement régresser.
Les femmes comme populations dites « marginalisées », ont pu être sensibles à d'autres problématique comme celles du droits des patients puisque ce sont des femmes qui ont fondé la première association des droits de patients en Suisse. Ce sont elles qui se sont questionnées, elles qui ont de près vécu des situations d’injustice. Voir que le médecin décidait à la place du malade leur apparaissaient non pas seulement anodin, mais injuste. Souvent c'est lorsque l'on est touché personnellement que vient la conscience des manquements aux droits, au contournement des lois et c'est souvent lorsqu'une "affaire" se fait publique que les autorités réagissent pour calmer le scandale.
Aujourd'hui, en pleine crise économique, les mentalités se transforment. Passant d'un "Je vais bien, il faut que j'aide l'autre" à un "Je vais mal, c'est la faute de l'autre". Néanmoins, d'autres militants partent au combat.
Comme il a été remarqué avec les droits des patients à l'hôpital ou le droit des prisonniers, une régression est toujours possible, généralement marquée par une stigmatisation de ces minorités ou une volonté d'en contrôler la dynamique. En effet, il y a quelques mois, après l'affaire du meurtre d'Adeline M. à la pâquerette,le gouvernement a eu une volonté de durcir encore davantage les conditions des prisonniers afin de calmer la population qui criait au scandale. Pour ce faire, Yvonne Bercher nous a informé qu'ils ont enlevé tout droits de sortis à tous les prisonniers de Champ-Dellon sans prendre en considération la nature des crimes de chacun ce qui, selon nous, représente une forme de régression.
Pour rester sur la thématique des prisonniers,nous pouvons également noter que défendre de tels droits n’est toujours pas quelque chose de facile puisque l’importance de cette lutte n’est pas encore très démocratisée et comprise par l’ensemble de la population. En effet, la prison demeure encore un lieu où l’on a de la difficulté à considérer les criminels comme des êtres humains. De ce fait, les prisonniers ont encore beaucoup de mal à exister en tant que personnes à part entière mais davantage comme des individus morcelés et éclatés. Par ailleurs, l’humiliation et le non respect de la dignité semble toujours très présents en prison. Par conséquent, nous pouvons nous demander quelle est la véritable place à accorder aux droits de l'être humain dans un contexte carcéral si difficile. Nos constatations nous amène à réfléchir sur l'avenir : que faut-il faire maintenant pour améliorer le respect des droits des détenus? A cette question, les divers textes que nous avons pu lire ainsi que nos deux entretiens se rejoignent tous sur un point : il faut rendre la prison plus visible. En effet, comment agir pour les détenus si personne ne sait exactement comment ils sont traités? Reste maintenant à savoir si la population est véritablement désireuse de rendre le traitement des prisonniers plus transparents. Dans une démocratie, il revient au peuple de faire des choix quant aux droits et devoirs des citoyens qui la composent. Sommes-nous alors prêts à assumer notre responsabilité dans le traitement des personnes déviantes? Ou préférons-nous occulter cette zone d'ombre de la société et l'enterrer au plus profond de nos esprits?
Pour ce qui est du droit des femmes, un léger retour en arrière peut également être observé quant à l'avortement. En effet, ce dernier est actuellement en train de faire débat, puisqu'une votation aura lieu d'ici quelque mois sur le non-remboursement par les caisses maladies de celui-ci. Nous risquons de revenir vers un statut des opprimés dans une société qui par ailleurs valorise l'individu, la personne. Le cas récent de l'Espagne illustre parfaitement la possibilité de régression. Dans la majorité des pays de l'Union Européenne, l'avortement est autorisé. L'Espagne vient tout juste de sortir de cette majorité en modifiant la loi sur l'avortement. Désormais, l'avortement est interdit sauf dans quelques cas :
- en cas de danger physique encourus par la femme. Ce point devra avoir été vérifié par deux médecins différents et étrangers à l'établissement où prendra place l'avortement.
- en cas de viol mais à condition que la femme ait porté plainte.
- en cas de malformation fœtale.
Enfin, pour qu'une mineure puisse avorter, l'accord des parents sera nécessaire.
Il est certain que, malheureusement, toutes les revendications finissent par s’essouffler. Les gens ne peuvent se battre pour une cause indéfiniment. Au bout d'un certain temps, on se convainc que ce que l'on a obtenu est suffisant et on arrête de se battre. Ou on arrête parce qu'on est fatigué. Et la relève n'est pas toujours là. Par contre, du moment qu'un mouvement militant s'essouffle, il y a des chances pour que le parti opposé se relève et effectue le combat inverse.
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, si l'on en croit le discours des acteurs des années 1960-1980, le combat est loin d'être achevé. A l'heure où l'école s'ouvre à l'intégration, où l'on parle d'inclusion de tous les élèves, des institutions ségrégatives continuent de se développer, et la réalité du terrain est encore très éloignée des lois (loi sur l'intégration LIJBEP, 2008). Le temps où l'on cachait les enfants porteurs d'un handicap semble révolu, et pourtant, quand on travaille dans ce milieu, les regards réprobateurs ne sont pas rares, et rappellent le chemin qu'il reste à parcourir. A l'Université, nombre de cours nous forment à considérer ces personnes en tant que "personnes" justement, comme si cela n'était pas une évidence. C'est donc que l'on peut encore douter du statut de cette population. En bref, la question aujourd'hui pourrait se résumer ainsi, en termes politiquement incorrects: la société, en temps de crise, peut-elle s'offrir le luxe de se préoccuper des plus démunis? Citons ici Charles Fourier "On mesure le degré de civilisation d'une société au sort qu'elle réserve aux plus démunis".
Qu'en est-il des droits de l'enfant aujourd'hui? En Suisse, nous avons pu voir à travers l'entretien avec M. Audéoud et sa femme, que la considération des mineurs a changé dans le domaine éducatif. On peut penser que les mentalités et valeurs ont été modifiées entre les années 60 et la fin du siècle ainsi que les instances rattachées à l'enfant, tel que le Tribunal des mineurs ou l'école. Le Tribunal des mineurs a évolué dans ce sens, avec une attention particulière à l'enfant ou adolescent, à ce qui serait le plus favorable pour lui. Quant à l'école, on peut voir que la pédagogie s'attache désormais plus à la participation de l'enfant, au respect de son rythme, entre autres nombreux aspects. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore à faire dans le sens du respect des droits de l'enfant. En effet, la sensibilisation des enfants quant à leurs droits reste d'actualité, d'où le travail dans les écoles sur ceux-ci, présentés aux enfants de manière simplifiée. Même si sur le versant visible, la Suisse, comme pays "développé", a mis en place des dispositions juridiques relatives aux droits de l'enfant, il demeure que dans le privé il existe toujours des cas que l'on pourrait appeler de maltraitance envers les enfants.
Sur le plan international, bien que la quasi totalité des Etats reconnus pas l'ONU aient ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, son application fait encore largement défaut dans certains pays. L'UNICEF met en lumière quelques chiffres mondiaux très parlants quant aux principes fondamentaux de la CIDE (droit à la santé, à l'éducation, à une identité, à la protection et à la participation) dans un dossier de 2008. Par exemple, en ce qui concerne le droit à l'identité de l'enfant, "51 millions de naissances ne sont pas enregistrées", tandis que "24'000 enfants âgés de moins de cinq ans meurent chaque jour de malnutrition et de maladies qui, dans la plupart des cas, pourraient être évitées" alors que le CIDE accorde à l'enfant le droit essentiel à la santé. Bien que la nécessité et le droit de l'enfant à l'éducation soient inscrite dans ce texte, "101 millions d’enfants ne sont pas scolarisés" dans le monde et "158 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent" malgré la reconnaissance des Etats de leur droit à la protection. Pour ce qui est du droit à la participation des enfants, il n'est pas évident d'y associé un chiffre, mais on peut tout de même aisément penser que bon nombre d'enfants n'ont guère possibilité d'expression et sont certainement peu, voir pas écoutés. Il y a donc encore bien du chemin à parcourir encore pour faire valoir et respecter les droits des enfants, avenir de notre société, dans le monde.
En ce qui concerne les droits des patients psychiatriques en Suisse, l’on peut remarquer comme des amélioration ont été apportées grâce aux revendications des groupes militants. Néanmoins certaines problématiques sont toujours d’actualités et il semble difficile d’y trouver des solutions. Comme nous l’avons pu remarquer à travers l’entretien avec Monsieur Riesen et lors de nos recherches, l’évolution des droits des patients psychiatriques se confronte à des impasses au niveau juridique. Tout d’abord il est difficile de limiter le pouvoir médical. En effet, lorsque un médecin se prononce en faveur d’un internement, motivant sa décision par la possible dangerosité du patient, personne ou peu de monde ose s’y opposer. De plus, la nature de la maladie mentale empêche le patient psychiatrique de pouvoir jouir pleinement des droits des patients. Si d’un côté les lois visent la tutelle de cette type de population perçue comme étant plus vulnérable, ces mêmes lois sont responsables de la limitation de ces personne dans l’exercice de leur droits. C’est le cas par exemple de la lois sur la privation de liberté à des fins d’assistance qui reste dans l’ambiguïté face à la Convention européenne des droits de l’homme (ratifiée par la Suisse en 1974). En effet, on peut interner une personne contre son gré si on estime que cela soit la seule façon d’assurer son assistance. Une autre difficulté se trouve dans l’évaluation de la capacité de discernement. Le code civil prévoit certaines situations dans lesquelles cette capacité peut être limitée dans l’intérêt de la personne concernée, notamment dans le cas de « maladie mentale » et de « faiblesse d’esprit ». La reconnaissance de cette capacité est la condition indispensable sans laquelle l’individu n’est pas en mesure d’exercer ses droits personnels. L’évaluation de la capacité de discernement se prête à controverse, notamment entre psychiatre et juriste, car il est impossible de poser un jugement objectif. Ceci est encore de nos jours source de malentendus et il semble très difficile qu’une réforme juridique puisse parvenir à éclaircir cette situation compliquée. En outre, on assiste aujourd’hui à une forme de stigmatisation, de la part des mouvements populistes et de l’extrême droite, des personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui bénéficient de l’assistance. Le discours budgétaire se traduit aussi par rapport aux diminutions des subventions aux hôpitaux psychiatriques. De plus, au niveau de la population, il y moins de tolérance, moins d’acceptation des personnes ayant des troubles psychiques. Ceci est dû aussi à des évènements récents qui font resurgir le discours sécuritaire de protection de la population.
Et les sciences de l'éducation dans tout ça?
Les rencontres que nous avons faites avec ces militants d'une autre époque nous ont permis d'alimenter nos réflexion sur le domaine des droits de la personne entre 1960 et 1980. Nous avons surtout relevé la fougue et la passion de ces militants en faveur d'autrui. C'est une belle leçon d'humanité que nous avons eue, puisque par leur mobilisation ils ont pu faire changer les conditions des personnes marginalisées. Nous qui avons choisi une filière sociale et qui souhaitons plus tard intervenir auprès de personnes fragilisées, cette expérience nous a appris qu'il faut s'engager "à fond" pour la cause que nous défendons si nous voulons qu'il y ait du changement.
Nous avons également pu comprendre que le droit à l'autodétermination des personnes en situation de handicap - que nous voyons dans le cadre de notre formation - est un droit qui a été avant cela revendiqué par d'autres personnes ; les enfants, les femmes, les prisonniers, les patients psychiatriques et les patients à l'hôpital. Tout ceci nous a donc expliqué que l'acquisition des droits de la personne prend du temps puisque pour la plus part, il a fallu se mobiliser pendant vingt ans pour voir des changements dans la société.
Les sciences de l'éducation prennent une place dans la lutte a poursuivre pour certains de ces droits, leur connaissance et leur maintien. On peut notamment penser aux populations des enfants et des personnes en situation de handicap avec qui nous travaillerons. Il est ainsi important de continuer à faire valoir leurs droits, leurs applications et la connaissance de ceux-ci par les populations concernées.
De plus les sciences de l’éducation doivent promouvoir une réflexion constante autour des populations les plus démunies, afin de permettre une remise en question des concepts qui encore aujourd’hui limitent la reconnaissance et l’exercice des droits de ces personnes. Pour que des changements au niveau juridique et des politiques publiques s’opèrent, il est nécessaire un changement de mentalité de la part de la société.
Des auteurs, comme Illich, préconisaient une société sans école, où l'on apprendrait, directement d'autrui, inséré dans un réseau, au gré de nos besoins éducatifs. La personne irait trouver les connaissances dont elle a besoin dans un réseau de connaissances et d'individus, pédagogues, comme elle, en puissance. Nous constatons, également, que dans une même revendication d'égalité et de remise en question des institutions, des auteurs comme Foucault dénoncent l'autoritarisme d'institutions comme la médecine qui en fait exerce un vrai pouvoir policier sur les personnes. Toute institution se construit socialement. Il en est de même pour la médecine qui s'éloigne volontairement du patient, en adoptant une posture d'expertise. Ce dernier ne construit pas le savoir médical avec le médecin, il ne connait souvent pas les méthodes de recherches concernant cet art. Or il pourrait, en aller autrement, notamment en permettant aux hommes d'apprendre davantage sur la médecine et ses méthodes de construction du savoir. Le patient est avant tout une personne, comme l'est d'ailleurs le médecin. C'est pourquoi cette dyade doit s'évertuer à construire ensemble un savoir médical compréhensible par tout-un-chacun. Telle est la condition, telle que visionnée par Illich, pour que l'homme se connaisse davantage lui-même, c'est-à-dire se réapproprie ce regard sur lui-même qui sait aujourd'hui en lien avec les autres dans des relations qui soient productrices de respect et de compréhension réciproque.